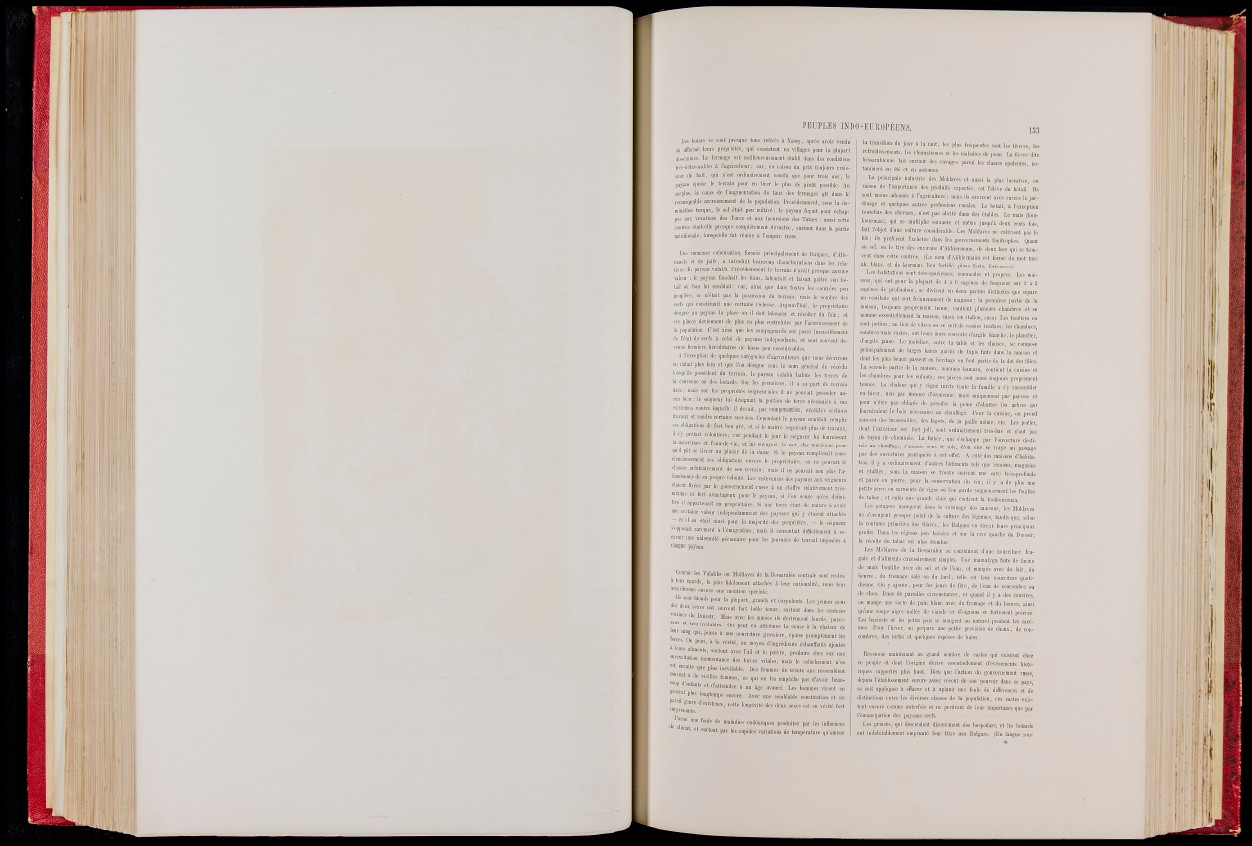
bi
P E U P L E S INDO-EUROPÉENS.
fi
•t 'f"
fliîtf
r
Les boiars se sont presque tous rctii-és à Yassj', après avoir veiulu
ou aiïeniié leurs propriétés, qui consistent en villag:es pour la plupart
dissémines. Le fermage est malhenreusement établi dans des conditions
ti'ès-cIéfavoi-ablGS à ragrieulteur; car, eu raison du prix toujours croissant
till bail, (jui n'est ordinairement conclu que poui- trois ans, le
paysan épuise le terrain pour en tirer le plus de proflt possible. An
surplus, la cause tie l'augmentation du taux des fermages gît dans le
remarquable accroissement de la population. Précédemment, sous la dorainatiou
turque, le sol était peu cultivé ; le paysan fuyait pour échapper
aux vexations des Turcs et aux incursions des Tatars : aussi cette
contrée était-elle pj-esque complètement dévastée, surtout dans la partie
lucridiouale, lorsqu'elle fut réunie à l'empire rnsse.
Une immense colonisation, formée principalement de Bulgars, d'Alleiiiauds
et de juifs, a introduit beaucouji d'améliorations dans les relations
dn paysan valaldi. Précédemment le tei rain n'avait presque aucune
valeur : le paysan fauchait les foius, labourait et faisait paître son bétail
où bon lui semblait ; car, ainsi que dans toutes les contrées peu
peuplées, ce n'était pas la possession du terrain, mais le nombre des
serfs qui constituait une certaine richesse. Aiijourd'liui, le propriétaire
désigne au paysan la plaee oii il doit labourer et récolter du foin ; et
ces places deviennent de plus en plus restreintes par l'accroissement de
la population. C'est ainsi que les campagnards ont passé insensiblement
de l'état de serfs à celui de paysans indépendants, et sont souvent devenus
fermiers héréditaires de biens peu considerables.
A l'exception de quelques catégories d'agriculteurs que nous décrirons
en détail plus loin et que l'on désigne sons le uom général de rézéchi
lorsqu'ils possèdent du terrain, le paysan valalcli habite les terres de
la couronne ou des boïards. Sur les premières, il a sa part de terrain
llxée; mais sur les propriétés seigncnriaies il ne pouvait posséder aucun
bien; le seigneur lui désignait la portion de terre nécessaire à son
esisleuee, contre laquelle il devait, par compensation, exécuter certains
travaux et rendre certains services. Cependant le paysan semblait remplir
ces obligations de fort bon gré, et si le maître l'cqnérait ¡¡lus de travaux,
il s'y prêtait volontiers ; car pendant le jour le seigneur lui fournissait
la nourriture et l'ean-dc-vie, et lui envoyait, le soir, des ninsiciens pour
ipi'il put se livrer an plaisir de la danse. Si le paysan remplissait consciencieusement
SCS obligations envers le propriétaire, on ne pouvait le
classer arbitrairement de son terrain ; mais il ne pouvait non plus l'abaudonner
île sa propre volonté. Les redevances des paysans anx seigneurs
étaient fixées par le gouvernement russe ¡i un chiffre relativement trèsminime
et fort avantageux pour le paysan, si l'on songe qu'en définihvc
il appartenait au propriétaire. Si une terre était de nature il avoir
nue certaine valeur indépendamment des paysans qui y étaient attachés
— et il en était ainsi pour la majorité des propriétés, — le seigneur
s'opposait rarement il l'émigration ; mais il consentait difficilement à recevoir
une indemnité pécuniaire pour les journées de travail imposées h
eliaquc paysan.
Couime les Valakhs ou Moldaves de la Bessarabie centrale sont restés,
îi tons égards, le plus fidèlement attachés à leur iiatioiialite, nous leur
accorderons encore une mention spéciale.
Ils sont blonds pour la plupart, grands et corpulents. Les jeunes gens
K deux sexes ont souvent fort belle tenue, surtout dans les contrées
«isnies dn Dniestr. Mais avec les années ils deviennent lourds parcs-
«"X et très-irritables. On peut en attribuer la cause it la chaleur de
cui sang qui, jointe à une nourriture grossière, épuise promptemcnt les
On peut, à la vérité, au moyen d'ingrédients échanlfants ajoutés
' '»nrs alnnents, surtout avec l'ail et le poivre, produire chez eux une
surexcitation momentanée des forces viUales, mais le relâchement n'en
ensuite que plus inévitable. Des femmes de trente ans ressemblent
«éii'' l", " "" "8= •»'••»'«•" f-M hommes vivent en
MICT " "'"= semblable constitution et un
" eenre d'existence, cette longévité des den.v sexes est on vérité fort
«"•lircnante.
'Hi^'cliiuàt""" «' " ' = " " 9 " « produites jiar les iullucnccs
mu , et surtout par les rapides variations de température qu'amène
133
la transition du jonr l'i la nuit, les jilns fréquentes sont les lièvres, les
refroidissements, les rhumatismes et les maladies de peau. La fièvre dite
bessarabicnne fait surtout des ravages parmi les classes opulentes, notamment
en été et en automne.
L a principale industrie des Moldaves et aussi la pins lucrative, en
raison de rimportaucc des produits exportés, est l'élève du bétail.' Ils
sont moins adonnés à l'agriculture ; mais ils exercent avec succès le jardinage
et quelques autres professions rurales. Le bétail, à l'exception
toutefois des chevaux, n'est pas abrité dans des établcs. Le maïs (koukourouza),
qui se multiplie soixante et même jusqu'à deux cents fois
f a i t l'objet d'une culture considérable. Les Ifoldaves ne cultivent pa.s le
blé ; ils préfèrent l'acheter dans les gonvernemeuts limitrophes. Quant
au sel, on le tire des environs d'Akticrmaun, de deux lacs qui se trouvent
dans cette contrée. (Le nom d'AIckiermann est formé du mot turc
afc, blanc, et de kicrman, lieu fortifié, place forte, foiteressc).
Les habitations sont très-spacieuses, commodes et propres. Les maisons,
qui ont pour la plupart de 4 à 0 sagèncs de longueur sur 2 à 3
sagènes de profondeur, se divisent en deux parties distinctes que sépare
nu vestibule qui sert fréquemment de magasin ; la première partie de la
maison, toujours proprement tenue, contient plusieurs cliambrcs et se
nomme essentiellement la maison, cassa (en italien, casa). Les fenitres en
sont petites; au lieu de vitres on se sert de vessies tendues; les chambres,
sombres mais vastes, ont leurs murs couverts d'argile blanclic, le planclicri
d'argile jaune. Le mobilier, outre la table et les chaises, se compose
principalement de larges bancs garnis de tapis faits dans la maison et
dont les plus beaux passent en héritage ou font partie de la dot des filles.
L a seconde partie de la maison, nommée kamara, contient la cuisine et
les cliambrcs pour les enfants; ces pièces sont aussi toujours proprement
tenues. La chaleur qui y règne invite toute la famille it s'y rassembler
en liivcr, non par mesure d'économie, mais uniquement par paresse et
ponr n'être pas obligée de prendre la peine d'abattre les arbres qui
fourniraient le bois nécessaire au chauffage. Ponr la cuisine, on prend
souvent des broussailles, des fagots, de la paille même, etc. Les poêles,
dont l'extérieur est fort joli, sont ordinairement très-bas et n'ont pas
de tnyau de clicminée. La fumée, qui s'échappe par l'ouverture destinée
au cliaiiffage, s'amasse sous le toit, d'oii elle se fraye nu passage
par des ouvertures pratiquées cet effet. A côté des maisons d'habitation
il y a ordinairement d'autres bâtiments tels que remises, magasins
et étables; sons la maison se trouve souvent nue cave très-profonde
e t pavée en pierre, pour la conservation du vin ; il y a de plus une
p e t i t e serre en sarments de vigne oii l'on garde soigneusement les feuilles
de tabac ; et enfin une grande claie qui contient la konkonrouza.
Les potagers manquent dans le voisinage des maisons, les Moldaves
ne s'occupent presque point de la culture des légnmes, tandis que, selon
la coutume primitive des Slaves, les Bulgars en tirent leurs principaux
profits. Dans les régions peu boisées et sur la rive gauche dn Dniestr,
la récolte du tabac est plus étendue.
Les Moldaves de la Bessarabie se contentent d'une nonrriture frugale
et d'aliments excessivement simples. Une mamalyga faite de farine
de maïs bouillie avec du sel et de l'eau, et mangée avec du lait, du
b e u r r e , du fromage salé on dn lard, telle est leur nourriture quotidienne.
On y ajoute, pour les jours de fête, de l'eau de concombre ou
de chou. Dans de pareilles circonstances, et quand il y a des convives,
on mange une sorte de pain blanc avec du fromage et dn beurre, ainsi
qu'une soupe aigre mêlée de viande et d'oignons et fortement poivrée.
Les haricots et les petits pois se mangent au naturel pendant les carêmes.
Ponr l'hiver, on prépare nue petite provision de choux, de concombres,
des nèfics et quelques espèces de baies.
Revenons maintenant au grand nombre de castes qui existent chez
ce peuple et dont l'origine dérive essentiellement d'événeincnts historiques
rapportés plus haut. Bien que l'action du gouvernement russe
depuis l'établissement encore assez récent de son pouvoir dans ce pays,
se soit appliquée à eifacer et à aplanir une foule de différences et de
distinctions entre les diverses classes de la population, ces castes existent
encore comme autrefois et ne perdront de leur importance que par
l'émancipation des paysans serfs.
Les princes, qui descendent directement des hospodars, et les boïards
ont indubitablement emprunté leur titre aux Bulgars. (En langue rou-
V
' ! L I