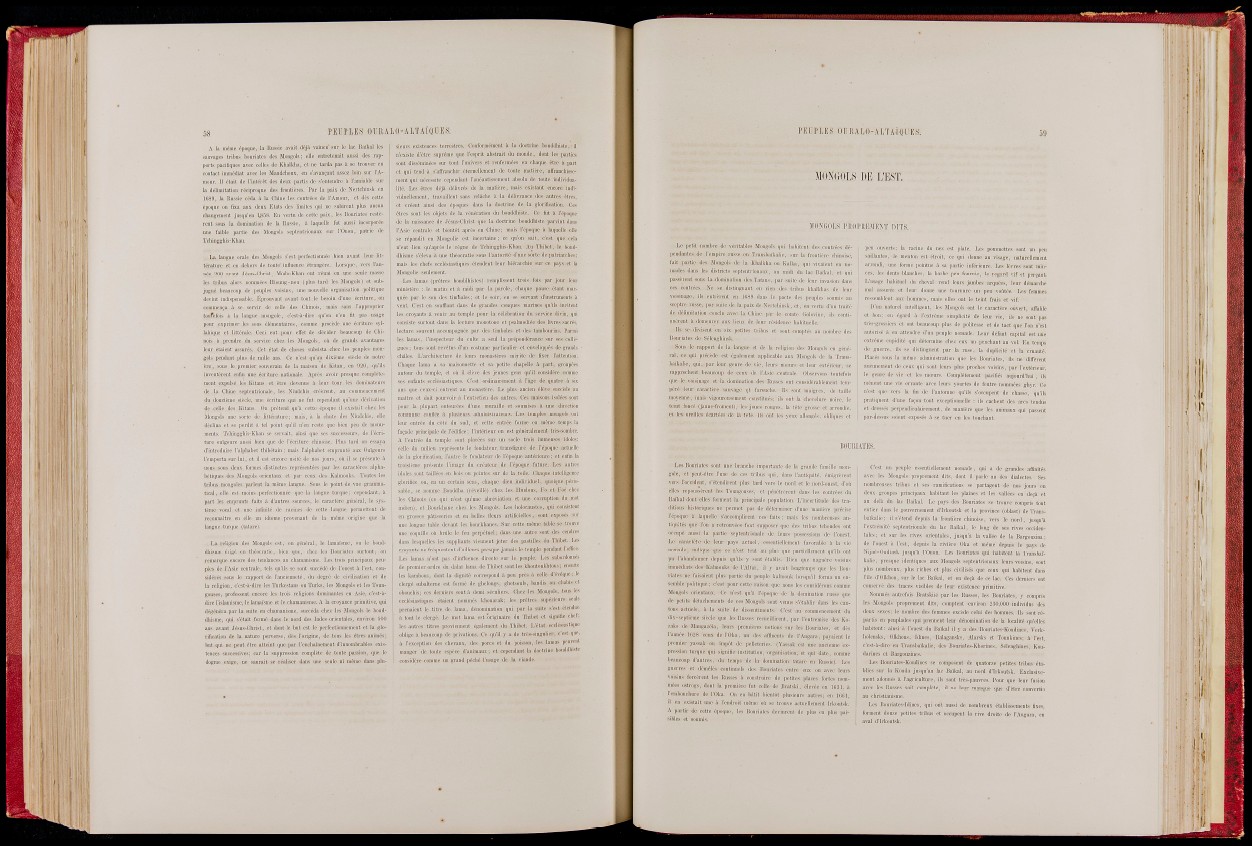
P E U P L E S OURALO-ALTAÏQUES.
A la niûme époque, la Russie avait dójà vaincu' sur le lac Baikal les
sauvages ti-ilius boiiriatcs des Mongols; elle ciiti-eteiiait aussi des rapjiorts
paciliqucs avec celles de Khalklia, et ne tarda pas se trouver en
contact immédiat avec les Maniiclioux, en s'avançaiit assez loin sur l'Amoui,
11 était do l'intérôt des deux partis de s'enteiulre l'aïuiable sulla
delimitation réciproque des frontières. Par la paix de Nertcliinsk en
1C80, la llussie céda h la Cliine les contrées de l'Amour, et dès cette
époque on Hxa aux deux Etats des limiles qui ne snbiroiit plus aucun
cliangemeiifc jusqu'en 1858. Kn vertu de cette paix, les Bouriates restèrent
sous la domination de la Russie, il laquelle i'nt aussi incorporée
une faible partie des Mongols septentrionaux sur l'Ouon, patrie de
Tchinggliis-Khaii.
L a laiigue orale des Mongols .s'est perfectionnée bien avant leur litt
é r a t u r e et en dehors de toute'iuHucnce étrangèi'C. Lorsque, vers l'année
200 avant Jésus-Chi'ist, Modo-Khan eut réuni en une seule masse
les tribus alors nommées llioung-nou (plus tard les Mongols) et subj
u g u é beaucoup de peuples voisins, une nouvelle organisation politique
devint i lul i s pensable. Éprouvant avant tout le besoin d'une écriture, on
oonnnença à se servir de celle des Cliinois, mais sans Fappi-oprier
tonfofciis h la langue mongole, c'est-à-dire qu'on n'en lit pas usage
pouj' exprimer les sons élémentaires, commc procède une écriture syllabique
et littérale. Ceci eut pour effet de décider beaucoup de Chinois
à prendre du sci-vicc chez les Mongols, où de grands avantages
leur étaient assurés. Cet état de choses subsista chez les peuples mongols
pendant plus de mille ans. Ce n'est qu'au dixième siècle de notre
è r e , sous le premier souverain de la maison de ICitan, eu 920, qu'ils
inventèrent enlin une écriture uationale. Après avoir presque complètement
expulsé les Kitaus et être devenus à leur toni' les dcnninateui-s
de la Chine septentrionale, les Nindchis créèrent, au commencement
du douzième siècle, une écriture qui ne fut cependant qu'nue dérivation
de celle des lutans. On prétend qu'à cette époque il existait chez les
Mongols une sorte de littci'atni-e ; mais, à la chute des Xiudchis, elle
déclina et se perdit ii tel point qu'il n'en reste que bien pou de monnnients.
Tcliinggliis-Ivhan se servait, ainsi que ses successeurs, de l'écrit
u r e ouïgonre aussi bien que de l'écriture chinoise. Plus tard on essaya
d'introduire l'alphabet thibétain; mais l'alphabet emprunté aux Ouïgouvs
l'emporta sur lui, et il est eucoj'c usité de nos jours, où il se présente à
nous sons deux formes distinctes représentées par ies caractères alphabétiques
des Mongols orientaux et par ceux des Kalraouks. Toutes les
t r i b u s mongoles parlent la môme langue. Sous le ])oint de vue grammat
i c a l , elle est moins perfectionnée que la langue turque; cependant, à
p a r t les emprunts fait,s ii d'autres sources, le caractère général, le système
vocal et une infinité de l'acines de cette langue permettent de
rcconnaîti'o en elle un idiome pi'ovenant de la même origine que la
langue turque (tatare).
L a religion des Mongols est, en général, le lamaïsme, ou le bouddhisme
érigé en théocratie, bien que, chez les J^ouriates surtout, on
remai'que cncoi'c des tendances au chamanismo. Les trois principaux peuples
de l'Asie centrale, t;cls ([u'ils se sont succédé de l'ouest à l'est, considérés
sous le l'apport de l'ancienneté, du degré de civilisation et de
la religion, c'est-à-dire les Turkestans ou Turks, les Mongols et les Toungouses,
professent encore les trois religions dominantes en Asie, c'est-àdire
l'islamisme, le lamaïsme et le chamanisme. A la croyance primitive, qui
dégénéra par la suite en chamanisme, succéda chez les Mongols le bouddhi.^
me, qui s'était formé dans le nord des Indes orientales, environ fjOG
ans avant Jésus-Christ, et dont le but est le ])crfectionneme]it et la glorification
de la nature pervei'se, dès l'oi'igine, de tous les êtres animés;
but qui ne peut être atteint que par renchainement d'innombrables exi.stences
successives; car la suppression complète de toute ])assion, que le
dogme exige, no saurait se réaliser dans une seule ni métne dans plusieurs
existences terrestres, Conformément à la doctrine bouddhiste, il
n'existe d'être suprême que l'espi'it abstrait du monde, dont les parties
sont disséminées sur tout l'univers et renfei'mécs en chaque être à part
e t qui tend à s'affranchir éternellement de toute matière, alTranchissement
qui nécessite cependant ranéantissement absolu de toute individualité.
Les êtres déjà délivrés de la matière, mais existant encore individuellement,
travaillent sans l'clàchc à la délivi'ance des autres êtres,
et créent ainsi des époques dans la doctrine de la glorification. . Ces
Ctres sont les objets de la vénération du bouddhiste. Ce fut à l'époque
de ia naissance de Jésus-Christ que la doctrine bouddhiste parvint dans
l'Asie centrale et bientôt après en Chine; mais l'époque à laquelle elle
se répandit en Mongolie est incertaine; ce qu'on sait, c'est que cela
n'eut lieu qu'après le règne do Tchingghis-Khan. Au 'Thibet, le bouddhisme
s'éleva à une théocratie sous l'autoi'ité d'une sorte de patriarches;
mais les chefs ecclésiastiques étendent leur hiérarchie sur ce ])ays et la
Mongolie seulement.
Les lanms (prêtres bouddhistes) rem|)lisseni trois fois pai' jour leur
ministère : le matin et à midi par la parole, chaque pause étant marquée
par le son des timbales; et le soir, en se servant d'instruments à
vent. C'est en sontllant dans de grandes conques marines (¡u'ils invitent
les croyants h venir au temple pour la célébration du service divin, qui
consiste surtout dans la lecture monotone et psalmodiée des livres sacrés,
lecture souvent accompagnée par des tinvbales et des tambourins. Parmi
les lama-s, l'inspecteur dn culte a seul la prépondérance sur ses collèg
u e s ; tous sont revêtus d'un costume particulier et enveloppés de grands •
châles. L'architecture de leurs monastères mérite de fixer l'attention.
Chaque lama a sa maisonnette et sa petite chapelle à part, groqiécs
autour du temple, et où il élève des jeunes gens qu'il considère commc
ses enfants ecclésiastiques. C'est ordinairement à l'âge de quatre à six
ans que ceux-ci entrent au monastère. Le ])his ancien élève succède au
m a i t r e et doit pourvoir à l'entretien des autres. Ces maisons isolées sont
pour la jiluiiart entourées d'une muraille- et soumises à une direction
commune confiée Ji plusieurs administrateurs. Les temples mongols ont
l e u r entrée dn côté du sud, et cette entrée forme en même temps la
façade principale de l'édifice; rintérieur en est généralement très-sombrc.
A l'entrée du temple sont placées sui' un socle trois immenses idoles;
celle du milieu représente le fondateur, transfiguré de l'époque actuelle
de la glorification, l'autre le fondateui' de l'époque antérieure; et enfin la
troisième présente l'image du créateur de l'époque future. Les autres
idoles sont taillées en bois ou peintes sur de la toile. Chaque intelligence
glorifiée ou, en un certain sens., chaque dieu individuel, quoique périss
a b l e , se nomme Bouddha (réveillé) chez les Hindous, Fo et Foé chez
les Chinois (ce qui n'est qu'une abréviation et une corruption du mot
indien), et Boni'khane chez les Mongols. Les holocaustes, qui consistent
en gro.sses pâtisseries et en belles fleurs artificielles, sont exposés sur
une longue table devant les bourkhanes. Sur cette môme table se trouve
une coquille oii bride le feu perpétuel ; dans une autre sont des cendres
dans lesquelles les suppliants viennent jeter des pastilles dn Thibet. Les
croyants ne fréquentent d'ailleurs presque jamai s le temple pendant l'oliice.
Les lamas n'ont pas d'influence directe sur le peuple. Les subordonnés
de premier ordre du dalaï lama de Tlùbct sont les khoutoukhtous ; ensuite
les kambous, dont la dignité correspond à peu près à celle d'évôque; le
clergé subalterne est formé de ghelongs, ghetsouls, bmidis ou cliabis et
obouchis; ces derniers sont à demi séculiers. Cliez les Mongols, tous les
ecclésiastiques étaient nommés khoiiarak; les prêtres supérieurs seuls
prenaient le titre de lama, dénomination qui par la suite s'est étendue
à tout le clergé. J.e mot lama est originaire du Tliibet et signifie chel;
les antres titres proviennent également du 'J'hibet. L'état ecclésiastique
oblige à beaucoup de in-ivations. Ce iju'll y a de très-singiilier, c'est que,
à l'exception des chevaux, des ])orcs et du poisson, les lamas jiouvent
manger de toute espèce d'animaux ; et ceiicndant la doctrine bouildhiste
considère comme un grand jiéclié l'usage de la viande.
P E U P L E S OURALO-ALTAÏQUES.
i[()X(ï()L8 DE 17EST.
^lONdOLS 1MU)1'RETIENT IMTS.
Le petit nombre de véritables Mongols qui habitent des contrées dépondantes
(le l'ompii'o russe ou Transbaïkalie, sur la frontière chinoise,
f a i t ])artic des Mmigols de la Kbalkha ou Xallca, qui vivaient en nomades
dans les districts septentrionaux, au midi du lac Baikal, et ((ui
pa.ssèrent sous la domination desTatans, |)ar suite de leui' inva-sion dans
ces contrées. Ne se distinguant en rien des tribus khallchas de leur
voisinage, i!s onti-èrent on IfiSO dans le pacte dos peuples soumis au
sceptre russe, par suite de la paix Ao Nortchinsiv, et, en vertu d'un traité
do délimitation coiicUi avec la'ciiine par le comte Golovine, ils continuèrent
à demeurer aux lieux do leiu' résidence habitu(dIo,
Ils se- divisent eu six ])etifcs tribus et sont comjités au nombre des
Honriates de Sélenghin.sk.
Sous le i-apport de la langue et de la religion des Mongols en génér
a l , ce qui précède est également applicable aux Mongols de la Transbaïkalie,
qui, par leui- genre de vie, leurs moeurs et leur extérieur, se
ra])prochciit beancoup de ceux do l'Asie centrale. Observons toutefois
(|ue le voisinage et la domination des Russes ont considérablement tempéi'é
leur caractèi'o sauvage Qt farouche, lis sont niaigres, de taille
moyenne, mais vigoureusement coustitiuis; ils ont la clievelure noire, le
teint foncé (¡aune-froment), les joues rouges, la tète grosse et arrondie,
e t les oreilles écartées de la tète. Ils ont les yeux allongés, obliques et
pou ouverts; la racine dn nez est plate. Les pommettes sont un peu
•saillantes, le mouton est étroit, ce qui donne an visage, naturellement
ai'rnndi, une forme pointue à sa partie inférieure. Les lèvres sont minces,
les dents blanches, la barbe peu fournie, le regard vif et perçant.
L'usage habituel du cheval rond leurs jambes arquées, leur démarche
mal assurée et leur donne une tournure un ]ieu voûtée. Les femmes
ressemblent aux hommes, mais elles ont le teint frais et vif.
D'un naturel intelligent, les Mongols ont le caractère ouvert, affable
e t bon; eu égard à l'extrême simplicité de leur vie, ils ne sont pas
très-grossiers et ont beaucoup plus de politesse et de tact que l'on n'est
aiU(n-isé à en attondi'C d'un peuple nomade. J.eur défaut capital est une
extrême cupidité qui dét:crmine chez eux un penchant au vol. J'in temps
de guerre, ils se distinguent par la ruse, la duplicité et la cruauté.
Placés sous la même administration que les Bouriates, ils ne diffèrent
aucunement de ceux qui sont leurs iilus proches voisins, par l'extérieur
le genre de vie et les moeurs. Complètement ])acifiés aujourd'hui , ils
mènent une vie errante avec leurs yourtes de feutre nommées ghyi-. Ce
n'est que vers la fin de l'automne qu'ils s'occupent de chasse, qu'ils
p r a t i q u e n t d'une façon tout exceptionnelle : ils cachent des arcs tendus
et dressés perpendicnlaireinciit, de manièi-e que les animaux qui passent
par-dessus soient exposés à se tuer en les touchant,
BOURl.VÏES.
Les Bouriates sont nne branche importante de la grande famille mongole,
et peut-être l'une de ces tribus qui, dans l'antiquité, émigrèrent
vei'S l'occidejit, s'étendirent plus tard vers le nord et le noi'd-ouest, d'où
elles repoussèrent les Tonngouses, et pénétrèrent dans les contrées du
Baïkal dont elles forment la principale ])opulation. I>'incertitiule des traditions
historiques ne permet pas de déterminer d'une miinière précise
l'époque h laquelle s'accomplirent ces faits; mais les nombreuses anti(
iuités que l'on a retrouvées font sujiposor que des tribus trhoudes ont
occui)é aussi la partie septentrionale de leurs possessions de l'ouest.
J^e caiactè!-o de leur pays actuel, essentiellement favorable à la vie
nomade, indique que ce n'est tout au jilus que partiellement qu'ils ont
pu rabandonner d(>pnis qu'ils y sont établis. I^ien que naguère voisins
immédiats des Kalmouks de l'Altaï, il y avait longtomjis que les liuuriatos
ne faisaient plus partie du peui)le kalmouk lorsqu'il forma un ensemble
politique; c'est. p(uir cette raison que nous les considérons commc
Mongols orientaux. Ce n'est qu';-|, l'époque de la domination ru.ssc que
de petits détacliements do ces îlongols sont venus s'établir dans les cantons
actuels, h la suite de dissentiments. C'est au commenceinent du
d i x - s e p t i è m e siècle ([ue les Russes recueillirent, par l'entremise des Kozaks
de Mangazéia, leurs premières notions sur les .Bouriates, et dès
l'ann(>c 1028 ceux de l'Oka, un des atliuents do l'Angara, payaient le
!)remior yassak ou impôt de pelleteries. (Vassak est une ancienno expression
turque qui signifie institution, organisation, et qui date, comme
beaucoup d'autres, du temps de la domination latare en Russie). Los
g u e r r e s ot démêlés continuels des lionriates entre eux ou avec leurs
voisins forcèrent les Russes il consfi'uii-e de petites places fortes nommées
ostrogs, dont la première fut celle de ]h-atski, élevée en IGSI, h
rembonchnre du l'Oka. On on bâtit bientôt plusieurs autres; on 16<il,
il on existait une à l'endroit même oii se trouve a(d.uelloment lrkonf;sk.
A iiartir de cette époque, les Hunriates devinrent de ¡¡lus en plus paisibles
et soumis.
C'est un peuple essentiellement nomade, qui a de grandes aflînités
avec les Jlongols proprement dits, dont il parle un des dialectes. Ses
nombreuses tribus et ses ramifications se partagent de nos jours en
deux groupes principaux habitant les plaines et les vallées en deçà et
au delà du lac Baïkal. Le pays des Bouriates se trouve compris tout
entier dans le gouvernement d'Irkontsk et la province (oblast) de Transb
a ï k a l i e ; il s'étend depuis la frontière chinoise, vers le nord, jusqu'à
l ' e x t r é m i t é septentrionale du lac Baïkal, le long de ses rives occident
a l e s ; et sur les rives orientales, jusqu'à la vallée de la fkrgouzina ;
de l'ouest à l'est, depuis la rivière Oka et même depuis le pays de
Nijné-Oudinsk jusqu'à l'Onon. Les Bouriates qui habitent la Transbaïkalie,
presque identiques aux Jlongols septentrionaux leurs voisins, sont
l)lus nombreux, plus riches ot plus civilises que ceux qui habitent dans
l'ilo d'Olkhon, sur le lac Baïkal, et en deçà de ce lac. Ces derniers ont
conservé des traces visibles de leur existence primitive.
Nommés autrefois Bratskiié par les Russes, les Boui'iates, y comjiris
les Mongols proprement dits, comptent environ 230,000 individus des
deux sexes; le nombre dos femmes excède celui des hommes. Ils sont rép
a r t i s on peuplades qui |>rennent Icuj- dénomination de la localité qu'cdles
h a b i t e n t : ainsi à l'ouest du Bciïkal il y a des Bnuriates-Koudines, Verkholensks,
Olkhons, Idines, Balagansks, Alarsks et Tounkines; à l'est
c ' e s t - à - d i r e en Transbaïkalie, des Bouriates-Khorines, Sélenghines, Koudarines
et Bargouzines.
Les Bouriates-Koudines se composent de quatorze petites tribus établies
sur la Kouda jusqu'au lac Baïkal, au nord d'Irkoutsk. Exclusivement
adonnés à l'agriculture, ils sont très-pauvres, l'onr que leur fusion
avec les Russes soit complète, il ne leur manque que d'être convertis
au christianisme.
Les Bouriates-Idines, qui ont aussi de nombreux établissements fixes,
forment douze petites tribus et occupent la rive droite de l'Angara, on
aval d'Irkoutsk.
t
•;1
M /