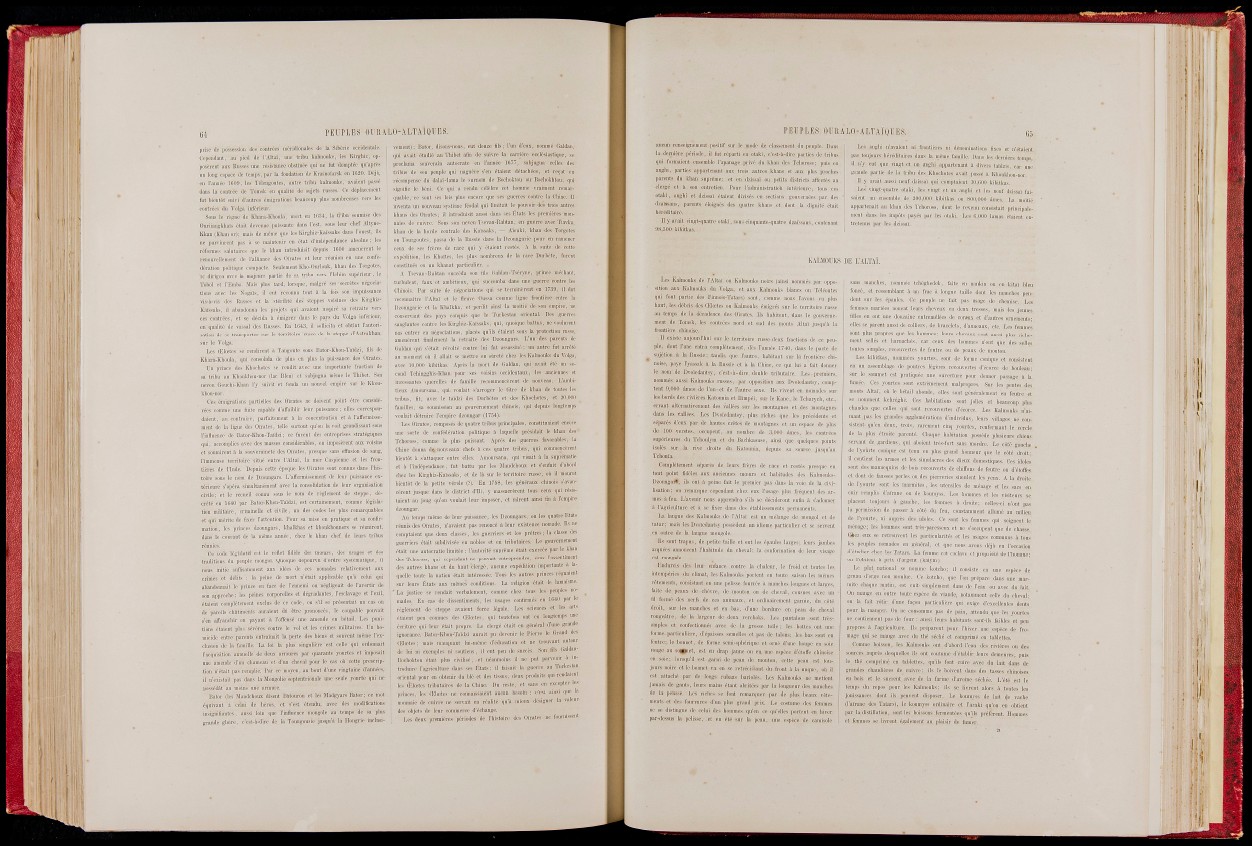
M i l
I >
' i j : ;
I¡ :i
I .
i
I M
i It
t. ; l (
6'l
P E U P L E S 0 r R A 1 , 0 - A L T A Î Q U E S.
)iriso de posscssiuii ilcs cootrées miiklioimles ile la Sibiiic occiilciitnlc.
Ucpciiiiuit, iiu pied lie l'Altaï, uuc triliii talmoiikc, les Kirghiz, opposircnt
aux Eusses une rÉsistmicc obstinée qui ne fut domptée qu'après
un long espace de temps, par la fondation de KrasnoSarsk en 1620. Déjà,
eu l'année IGOO, les Télcngontes, autre tribu kalniouke, avaient passé
dans la contrée de Tomsk en qualité do sujets russes. Ce déplacement
fut bientôt suivi d'autres émigrations beaucoup plus nombreuses vers les
contrées du Volga inféric
Sons le régne de Kliar
Kboula,
Onriiangkliaïs était dever
¡ puissante da
Kki Klu or); s de
éme que le:
parvinrent pas a se maintenir e
•éformcs salutaires que le kban int
renouvellement de l'alliance des Olr
dération politiqm
se dirigea avec 1.
Tobol et l'Eniba
tions avec les Nog
vis-ii-vis des tinsse;
lia.Issaks, il abandor
ces contrées,
en qualité de
saticn de se t
sur le Volga.
Les (Eloete
•t en 1034, la tribu soumise des
, sons leur cbef Altync-
Kirgliiz-Kaïssaks dans l'ouest, ils
. état d'indépendance absolue ; les
odulsit depuis ICOO amcuérent le
ites et leur réunion en une confiv
compacte. Seulement Kbo-Ourlouk, khan des Torgotes,
majeure partie de sa tribu vers l'Icbim supérieur, le
Mais |dns tard, lorsque, malgré ses secrètes négociait
reconnu tout a la fois son impuissance
stérilité des' steppes voisines des Kirgliizle
1 les projets qni av
it se décida à émigrcr dar
vassal des Unsscs. lin 1643;
iporte:
rend
Kbara-Kh
Un pri'
sa tribu
neveu Go
khon-nor.
Ces én
rées
n Kbcu
cbi-liha
sur le tcrritoii
rent il Tangout
iolida de plus
otes se rendit
lor (lac B1
suivit et fonda
dent inspire sa retraite vcn
! le pays du Volga inférieui'
il sollicita et obtint l'antorissc
de la steppe d'Astrakhan
rs Bator-Kbon-Taïdz: de
plus la [
Il et subjn
;e des Oïrates.
mportante fraction de
même le Thibet. Son
empire sur le Xkouigrations
partielles des Oïrati
le une fuite capable d'affaibli
s ne doivent point être
• lenr puissance ; elles a
considérrespondaient,
an contraire, parfaitement ä la concentration et il l'affermissement
do la ligue des Olrates, telle
l'influence de Bator-Khon-Taidzi ; ci
omplies c des : lasses considé
;t soumirent ii la souveraineté des Oïrati
'immense territoire situé entre l'Altaï
ide. Depuis cette époque 1
nom de Dzoungars. L'affermissement de 1
iia simultanément avec la consolidation de
t i i r e s de l'I
toire sous le
térieure s'op
urtont qu'on la voit grandissant sous
furent des entreprises stratégiques
idérables, en imposèrent aux voisins
i, presque sans effusion de sang,
la mer Caspienne et les fron-
3 Oïrates sont connus dans l'hispnissance
exsatioi
civile; et le recueil connu s
crété eu 1040 par Bator-Kbo
tlon militaire, criminelle et i
et qui mérite de fixer l'attenti
mation, les princes dzoungar
dans le courant de la môme
réunies.
Ce
tradit
JUS le nom de règlement de steppe, déi
Taïdzi, est certainement, comme législaivile,
un des codes les plus remarquables
on. Pour sa mise en pratique et sa contir-
;, khalkhas et kbonkhounors se réunirent,
innée, chez le khan chef de leurs tribus
Dde législatif est le reflet fidèle des moeurs, des usages et des
ns du peuple mongol. Quoique dépourvu d'ordre systématique, il
nous initie suffisamment aux idées de ces nomades relativement aux
crimes et délits : la peine de mort n'était applicable qu'a celui qui
abandonnait le prince en face de l'ennemi on négligeait de l'avertir de
son approche ; les peines corporelles et dégradantes, l'esclavage et 1'-"
étaient compléti
de pareils cliàti
s'en affranchir
tions étaient pl
micide entre pi
elusion de la ù
l'acqnisition annuelle de deux a
une amende d'un chameau et d
tion n'était pas remplie, l'ar ce
il n'existait pas dans la Mongol
possédïit au moins une armure.
.ment exclus de ce code, ou s'il se présentait un cas oii
ments auraient dit être prononcés, le coupable pouvait
;n payant à l'offensé une amende en bétail. Les puniis
sévères contre le vol et les crimes militaires. Un liorents
entraînait la perte des biens et souvent même l'exmille.
La loi la pins singidièrc est celle qui ordonnait
Hires par q
n cheval po
loycn, au bc
septentrion,
Bator (les llandcbonx disent Bat
équivaut il celui de héros, et s
insigniliailtes, aussi loin que l'inlli
grande gloire, c'cst-il-dire de la T
arante yourtes et imposait
r le cas oii cette prcscripit
d'une vingtaine d'années,
le une seule yourte qni ne
urou et Ics Madgyars Bator ; ce i
>st étendu, avec des modificati
enee mongole au temps d
ungonsic jiisq^à la Ilongr
plu
iclu
veinent); Bator, disons-nons, eut douze lils ; l'un d'eux, nommé Galdan,
qui avait étudié au Thibet afin de suivre la carrière ecclésiastique, se
proclama souverain autocrate en l'année 1677, snbjngna celles des
tribus de son peuple qui naguère s'en étaient détachées, et reçut en
récompense du dalaï-lama le surnom de Bocbokton ou Bocbokbtou, qui
signifie le béni. Ce qui a rendu célèbre cet liommc vraiment remarquable,
ce sont ses lois plus encore que ses guerres contre la Chine. Il
inventa un nouvean système féodal qui limitait le pouvoir des trois antres
kliaiis des Olrates; il introduisit aussi dans ses États les premières monnaies
de cuivre. Sous son neven Tsevan-Eabtan, en guerre avec Tiavka,
khan de la horde centrale des Kaïssaks, — Aïonki, kban des Torgotes
ou Tourgoutes, passa de la Russie dans la Dzoungaric poui' en ramener
ceux de ses frères de race qui y étaient restés. A la suite de cette
cxpéditioo, les Kholtes, les plus nombreux de la race Durbète, furent
constitués en un khanat particulier. .
A Tsevan-Rabtan succéda son fils (laldan-Tsérync, prince méchant,
turbulent, faux et ambitieux, qui succomba dans une guerre contre les
Chinois. Par suite de négociations qui se terminèrent en 1739, il dut
reconnaître l'Altaï et le ficuvc Oussa comme ligne frontière entre la
Dzoungaric et la Khalkha, et perdit ainsi la moitié de son empire, ne
conservant des pays conquis que le ïuikestan oriental. Des gnerres
sanglantes contre les Kirghiz-Kaïssaks, qni, quoique battus, ne voulurent
pas entrer en négociations, places qu'ils étaient sous la protection russe,
amenèrent finalement la retraite des Dzoungars. L'un des parents de
Galdan qui s'était, révolté contre lui fut assassiné ; un autre fut arrêté
au moment où il allait se mettie en sûreté chez les Kalmouks du Volga,
avec 10,000 kibitkas. Après la mort de Galdan, qui avait été un second
Tcbingghis-Kban pour ses voisins occidentaux, les anciennes et
incessantes querelles de famille recommencèrent de nouveau. L'ambitieux
Amoursana, qni voulait s'arroger le titre de khan de tontes les
tribus, fit, avec le taïdzi des Durbètes et des Khochotes, et 20,000
familles, sa soumission an gouvernement chinois, qui depuis longtemps
voulait détruire l'empire dzoungar (1754).
Les Oïrates, composés de quatre tribus principales, constituaient encore
nue sorte de confédéi'ation politique ii laquelle présidait le khan des
Tchoross, comme le plus puissant. Après des guerres favorables, la
Chine donna de nouveaux cbcfs iv ces quatre tribus, qui commencèrent
bientôt à s'attaquer entre elles. Amoursana, qui visait à la suprématie
et à l'indépendance, fut battu par les Mandchoux et s'enfuit d'abord
chez les Kirghiz-Kaïssaks, et de lii sur le territoire russe, oii il mourut
bientôt de la petite vérole (?). En 1758, les généraux chinois s'avancèrent
jusque dans le district d'Ili, y massacrèrent tous ceux qui résistaient
an joug qu'on voulait leur imposer, et mirent ainsi lin à l'empire
dzoungar.
Au temps même de leur puissance, les Dzoungars, ou les quatre Etats
réunis des Olrates, n'avaient pas renoncé a leur existence nomade. Ils ne
comptaient que deux classes, les guerriers et les prêtres ; la classe des
guerriers était subdivisée en nobles et en tributaires. Le gouvernement
était une autocratie limitée ; l'autorité suprême était exercée par le khan
des Tchoross, qui cependant ne pouvait entreprendre, sans l'assentiment
des antres khans et du haut clergé, aucune expédition importante i laquelle
toute la nation était intéressée. Tous les autres princes régnaient
sur leurs États aux mômes conditions. La religion était le lamaïsme.
• La justice se rendait verbalement, comme chez tons les peuples nomades.
En cas de dissentiments, les usages confirmés en 1640 i)ar le
règlement' de steppe avaient force légale. Les sciences et les arts
étaient peu connues des (Eloetes, qui toutefois ont eu longtemps une
écriture qui leur était propre. Le clergé était en général d'une sramlo
iguoi'ance. Bator-Kbon-Taïdzl aurait pu devenir le Pierre le Grand des
(Eloetes; mais manquant Ini-même d'éducation et ne trouvant autour
de lui ni exemples ni soutiens, il eut peu de succès. Son fils Galdanliochoktou
était jilns civilisé , et néanmoins il ne init |)arvcnir ii introduire
l'agriculture dans ses Etats; il faisait la guerre au Turkestan
oriental pour en obtenir du blé et des tissus, deux pi'oduits qui rendaient
les (iîloetcs trlbntaircs de la Chine. Du reste, et sans en excepter les
princes, les lEIcctes ne connaissaient aucun besoin : c'est ainsi (|nc la
monnaie de cuivre ne servait en réalité qu'à mieux designer 11
-alci
des objets de leur conimercc d'échange.
Les deux premières iiériodes de l'histoire des Oïrates ne foi
P E Ü P L E S OüRALO-ALTAlüCES.
aucun renseignoinent positif sur le mode de classement du peuple. Dans
la dernière période, il fut réparti en otaki, c'est-à-dire parties de tribus
qui formaient ensemble l'apanage privé du khan des Tchoross; puis en
anghi, parties appartenant aux trois autres khans et aux pins proches
parents du kban suprême; et en dzissaï ou petits districts aff'cctés an
clergé et à son entretien. Pour l'administratloii intérieure, tous ces
otaki, angbi et dzi.ssaï étaient divisés en sections gouvernées par des
dzaïssans, iiarents éloignes des quatre libans et dont la dignité était
llércditairé.
Il y avait viiigl-qaatrc otaki, sous cinquante-quatre dzaïssans, contenant
98,300 kibitkas.
Les angbi n'avaient ni frontii
pas toujours héréditaires dans la
il n'y eut que vingt cl un angli
grande partie de la tiibii des Kliocbotcs
1 ni dénominations lixcs et n
iliie famille. Dans les derniers
ppartenant à divers taïdzis, i
11 y avait aussi neuf dzissaï qni comijti
l.es vingt-quatre otaki, les vingt et un
saiciit un enscnilile de 200,000 klbitlias
appartenait au kban des Tel
ment dans les inipéts payés
tretenus par les dzissaï.
it liasse à Kboukboii
it 10,000 kibitkas,
igbi et les neuf dzis
800,000 âmes, I,a
i , dont le levenii consistait ])rl
les otaki. Les 6,000 lamas étai
KAI.ilOCKS lllî 1,',\1,TAÏ.
par oppo-
Tcléoutcs
IS vu plus
Les Kalmouks de l'Altaï ou Kalmouks noirs (ainsi r
• sition aux Kalmouks du Volga, et anx Kalmouks hia
qui font partie des l'innois-Tatars) sont, comme nous l'avons
haut, les débris des OEloetes on Kalmoults émigrés sur le territoire russe
an temps de la décadence des Oïrates. Ils habitent, dans le gouvernement
de Tomsk, les contrées nord et sud des monts Altaï jusqu'à la
frontière chinoise.
Il existe aujourd'hui sur le territoire russe deux fractions de ce peuple,
dont l'une entra complètement, dès l'année 1740, dans le pacte de
^ siijctiou à la liussie; tandis que l'autre, habitant sur la frontière chinoise,
paye l'yassak- à la Rnssic et à la Chine, cc qui lui a fait donner
le nom de Dvoïedantsy, c'est-à-dire double tributaire. Les premiers,
nommés aussi Kalmouks russes, par opposition aux Dvoïedantsy, conqitent
9,000 àmcs de l'un-et de l'autre sexe. Ils vivent en nomades sur
les bords des rivières Katonnia et Iliinpéi, sur le Kane, le Tcharych, etc.,
errant alternativement des vaUées sur les montagnes et des montagnes
dans les vallées. Les Dvoïedantsy, plus riches que les précédents et
sépares d'eux par de hautes crêtes de montagnes et un espace de pins
de 100 verstes, occupent, au nombre de 3,000 âmes, les contrées
supérieures du Tcboulym et du Bachkaonse, ainsi que quelques points
isolés sur la rive droite du Katouiiia, depuis sa source jusqu'au
Tchouïa.
Complètement séparés de leurs frères de race et restés presque en
tout point fidèles aux anciennes moeurs et habitudes des Kalmouks-
Dzoungaiï, ils ont à peine fait le premier pas dans la voie de la civilisation;
on remarque cependant chez eux l'usage plus fréquent des armes
à fcn. L'avenir nous apprendra s'ils se décideront enfin à s'adonner
à l'agriculture et à se fixer dans des établissements permanents.
La langue des Kalmouks de l'Altaï est un mélange de mongol et de
t a t a r ; mais les Dvoïedantsy possèdent nu idiome particulier et se servent
eu outre de la langue mongole.
Ils sont trapns, de petite taille et ont les épaules larges; leurs jambes
arquées annoncent l'habitude du cheval; la conformation de leur visage
est mongole.
Endurcis dès lenr enfance contre la cbaleur, le froid et tontes les
intempéries dn climat, les Kalmouks portent en toute saison les mêmes
vêtements, consistant en une pelisse fourrée à manchcs longnes et larges,
faite de peaux do chèvre, de mouton ou de cheval, cousues avec un
lil foimé des nerfs de ces animaux, et urdinairement garnie, du coté
droit, sur les manches et en bas, d'une bordure en peau de cheval
rougeâtre, do la largeur de deux vcrchoks. Les pantalons sont trèsamples
et confectionnes avec de la grosso toile; les bottes ont une
forme particulière, d'épai.sses semelles et pas de talons; les bas sont on
fciitic; le bonnet, de forme scml-spbérique et orné d'une bou|ic en soie
rimgo au sownet, est en drap janne ou en. une cspèce d'ctolfc chinoise
en sole; lorsqu'il -est garni de peau de mouton, cette peau o.st toujours
noire et le bonnet va on se rétrécissant du front .'i la nuque, oïi ¡1
est attaché |iar de Imigs rubans bariolés. Les lialmiraks ne mettent
jamais de gants, leurs ni.ains étant abritées par la loiigiioiir des manches
de la pelisse. Les riches se font romariiiier par de plus boai
plus grand pï'ix. Le costume des
Iminmes qu'en ce ([u'elles portent i
1 été sur la peau, une es|ièce de
vête.
iiieuts et des fo
lie se disti
par-dessus
de celui .1
lisse, et
sans manches, nommée tchégbcdek, faite ci
foncé, et ressemblant à un frac à longue la
dent sur les épaules. Ce peuple ne fait pi
femmes mariées nouent leurs cheveux en deu
filles en ont une douzaine eotremôlécs de eorai
elles se parent aussi de colliers, de bracelets, d'i
sont plus propres que les hommes; leurs cbevr
meut sellés et Imrnacliés, car ceux des bum
toutes simples, recouvertes de feutre ou de pei
Les kibitkas, nommées yourtes, sont de forme conique et consistent
en un assemblage de poutres légères recouvertes d'ccorce de bouleau;
sur le sommet est pratiquée nue ouverture pour donner passage à là
fumée. Ces yourtes sont extrêmement malpropres. Sur les pentes des
monts Altaï, oii le bétail abonde, elles sont généralement en feutre et
se nomment kehrcghé. Ces habitations sont jolies et beaucoup plus
chaudes que celles qui sont recouvertes d'écorce. Les Kalmouks n'aimant
nankin ou
le dmit les
u.sagc de
tresses, m
ux et d'antres ornements;
anneaux, etc. I,es femmes
lUx sont aussi |dns ricbcmcs
kitaï bleu
iclies peumise.
Les
les jeunes
n'ont que des selles
de moutoo.
pas les grandes agglomérations d'individus, leurs villages ne consistent.
qu'en demx, trois, rarement cinq yourtes, renfermant le cercle
de la plus étroite parenté. Chaque habitation possède plusieurs chiens
servant de gardiens, qui aboient très-fort sans mordre. Le côté gauche
de l'yoiirtc conique est tenu en plus grand honneur que le côté droit;
il contient les armes et les simulacres des dieux domestiques. Ces idoleii
sont des mannequins de bois recouverts de chifi'ons de feutre on d'étoffes
et dont de fausses perles on des pierreries simulent les yeux. A la droite
de l'yourte sont les marmites, les utensiles de ménage et les sacs en
cuir remplis d'aïrane on de konmyss. Les hommes et les visiteurs se
placent toujours à gaiicbc, les femmes à droite; celles-ci n'ont pas
la permission de passer à côté dn feu, constamment allumé au milieu
de l'yourte, ni auprès des idoles. Co sont les femmes qni soignent le
ménage ; les bommes sont trcs-paressoux et ne s'occupent que de chasse.
CJiez eux se retrouvent les particularités et les usages communs à tous
les peuples nomades en général, et qne nous avons déjà eu l'occasion
d'étudier chez les Tatjirs. La femme est esclave et propriété de l'homme;
on l'obtient à prix d'argent (kalym).
Le plat national se iiomnio kotcho; il consiste en une c.spèce de
gruau d'orge non moulue. Ce iiotcho, que l'on prépare dans une marmite
chaque matin, est cuit, simplement dans de l'eau ou avec du lait.
On mange en outre toute espèce de viande, notamment celle dn cheval;
on la fait rôtir d'une façon particulière qui exige d'excellentes dents
pour la manger. On ne consomme pas de ]iani, atteudu que les yourtes
ne contiennent pas de four : aussi Icni's babitaiits sont-ils faibles et peu
propres à l'agriculture. Ils préparent pour l'bivcr une espèce de fromage
qui se mange avec du thé séché et comprimé eu tablettes.
Comme boisson, les Kalmouks ont d'abord l'eau des rivières on des
sources auprès desquelles ils ont coutume d'établir leurs demeures, puis
le thé comprimé en tablettes, qu'ils font cuire avec du lait dans de
grandes chaudières de cuivre; ils le boivent dans des tasses cliinoises
en bois et le sucrent avec de la farine d'avoine séchée, l/été est le
temps du repos jjoiir les Kalmouks; ils se livi'cnl alors à toutes les
jouissances dont ils peuvent disposer. Le konmyss de lait de vache
(l'aïranc des Tataivs), le konmyss ordinaire et l'araki qu'on.en obtient
par la distillation, senties boissons fcrmentées qu'ils préfèrent. Hommes
et femmes se livrent également au plaisir de fumer.
•i ; M
'M
)
t t I
I
lil
I ;
i
• ,t
l ' I l i