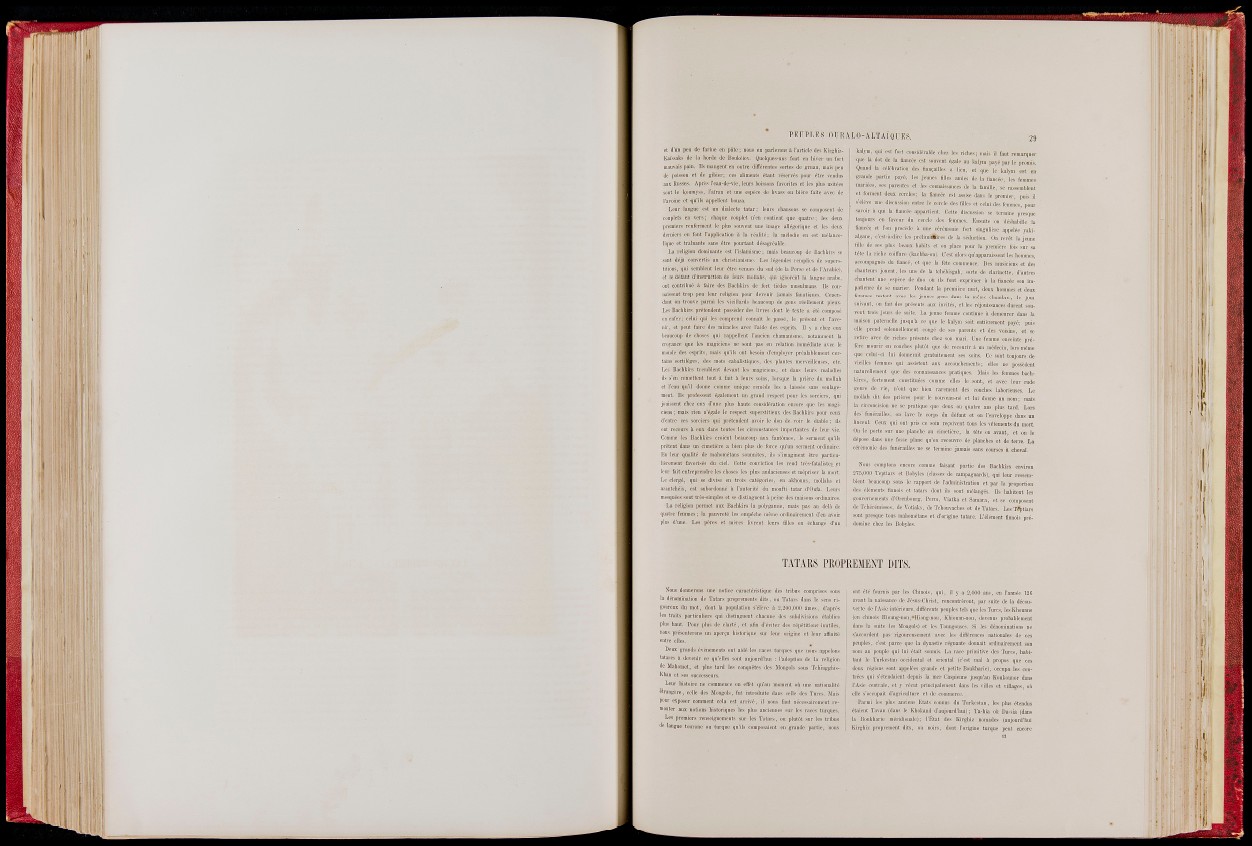
PEUPLES OURALO-ÂLTAÏQUKS.
et d'un peu de farine en pâte ; nous en pariei'ons à l 'artide des Kirghiz-
Kaïssalcs de lu horde de Eoukéicv. Quelques-uns font en hiver un fort
mauvais pain. Ils mangent en outre (iifférentes sortes de gruau, mais pou
de poisson et de gibier; ces aliments étant réservés pour être vendus
aux Russes. Après î'eau-de-vie, leurs boissons favorites et les plus usitées
sont le kouniyss, l'aïraii et une espèce de kvass ou bière faite avec de
l'avoine et tju'ils appellent boiiza.
Leur langue est uii dialecte tatar ; leni's chansons se couiposent de
couplets en vers; chaque couplet n'en contient que quatre; les deux
premiers renferment le plus souvent une image allégorique et le.>i deux
tieniiei's en font l'application à la réalité; la mélodie eu est mélancolique
et ti'atuante sans être pourtant dé.sagréable.
L a religion dominante est l'islamisme; mais beaucoup de Haclikirs se
sont déjà convertis au chi-istianisme. Les légendes l'cniplies de supei-stitioHs,
qui semblent leur ôti'e venues du sud (de la Perse et do l'Arabie),
et le défaut d'instruction de leni's mollalis, qui ignoi'cnt la langue arabe,
ont contribué à faire des Bachkii's de fort tièdes musulmans. Ils connaissent
trop peu leur religion pour devonii- jamais fanatiques. Cependant
on trouve ])armi les vieillards beaucoup de gens réellement pieux.
Les Bachkirs pi'étendent posséder des livres dont le texte a été composé
en enfer; celui qui les comprend connaît le passé, le présent et l'avenir,
et peut faire des miracles avec l'aide des esprits. Il y a chez eux
beaucoup de choses qui rappellent l'ancien chamanisnie, notamment la
croyance que les magiciens ne sont pas en relation immédiate avec le
monde des esprits, mais qu'ils ont besoin d'employer préalablement certains
sortilèges, des mots cabalistiques, des phintes merveillenses, etc.
Les Bachkirs tremblent devant les magiciens, et dans leurs maladies
ils s'en remettent tout à fait leurs soins, lorsque la prière du mollah
et l'eau qu'il doinie comme unique remède les a laissés sans soulagement.
Ils p]'ofessent également un gi'and respect poui' les sorciers, qui
jouissent chez eux d'une pins haute considération encore que les magiciens
; mais rien n'égale le respect superstitieux des Bachkirs pour ceux
d'entre ces sorciers qui prétendent avoir le don de voir le diable ; ils
ont recours ii eux dans toutes les circonstances importantes de leui' vie.
Comme les Bachkirs croient beaucoup aux fantômes, le serment qu'ils
prêtent dans un cimetière a bien plus de force qu'un serment ordinaire.
E n leui- qualité de mahométans sounuites, ils s'imaginent être particulièrement
favorisés du ciel. Cette conviction les rend très-fatalistes et
Icui' fait enti eprendre les choses les plus audacieuses et mépriser la mort.
Le clergé, qui se divise en trois catégories, en akhouns, mollahs et
azantchéis, est subordonné il l'autorité du moufti tatar d'Oufa. Leurs
mosquées sont très-simples et se distinguent à peine des maisons ordinaires.
L a religion permet aux Bachkirs la polygamie, mais pas au del;\ de
quatre femmes; la pauvreté les empêclie même ordinairement d'en avoir
plus d'une. Les pères et mères livrent leurs filles en échange d'un
29
kiilym, qui est fort considérable che^ îes i-iclies ; mais il faut remarquer
que la dot de la fiancée est souvent égale au kalym payé par le i)romi.s.
Quand la célébration des fiançailles a lieu, et que le kalym est en
gi'ande partie payé, les jeuties filles amies de la fiancée, les fennnes
nuij-iéos, ses parentes et les connaissances de la famille, se i-assemhlent
e( forment doux cercles ; la fiancée est îussiso (liuis le premier, puis i[
s'élève une ilisciissiuii entre le cci-rle des filles et, eeliii des femmes, pour
savuir à (jiii in liaiicéc appartient. Cette [liscnssicjn se lenniiie presque
toujours en livenj- du ccrclc îles femmes. Ensuite on désliabille la
aanccç et l'on proeède ¡1, nne céi-cmonie fort singnlièi-e appelée yaldalgane,
c'est-à-dire les inéliiuimiires de la séduction. Ou revêt la jeune
tille do ses plus beanx habits et on placo pour la pj'omière fois sur sa
t ê t e la riche coiltorc (kacliba-ou). C'est alors qu'apparaissent les hommes,
accompagnés du fiancé, et que la féte coniuiencc. Des musiciens et des
chanteurs jouent, les uns de la tchéhi,sgah, soite de clarinette, d'autres
chantent une ospecc de duo où ils font exprimer à la fiancée son inipatieuce
de se niai ier. Peudaut la première uuit, deux hommes et deux
femmes restent avec les jeunes gens dans la même eliambre ; le jour
suivant, on fait des présents aux invités, et les réjouissances durent souvent
trois jours do suite. La jeune femme coutimio it demeurer dans la
maison paleruelle jusqu'il ce que le kal.ym soit entièrement payé; puis
elle prend solennellement congé de ses parents et des voisins, et se
r e t i r e avec de riches présents chez son mari. Une femme enceinte pi'éfère
moui-ir en conchos illutôt que de recourir à un médecin, lors même
que celui-ci lui donneiait gratriitemout ses soins. Ce sont toujours de
vieilles femmes qui assistent aux accouchements ; elles ne possèdent
naturellement que des connaissances pratiques. Mais les femmes bachk
i r e s , fojtenieut constituées comme elles le sont, et avec leui- l'ude
geiu-e do vie, n'ont que bien rarement des couches laborieuses. Le
mollah dit des prières pour le nouveau-né et lui doime un nom ; mais
la circoncision ne se pratique que deux on quatre ans plus tard. Lors
dos funérailles, on lave le corps du défunt et on l'enveloppe dans un
linceul. Ceux qui ont pi-is ce soin reçoivent tous les vêtements dn mort.
On le porte sur une planche an cimetière, la tète en ayant, et ou le
dépose dans nne fosse piano qu'on recouvre de planches et de terre. La
cérémonie des funérailles ne se termine jamais sans courses h cheval.
Nous comptons encore coumie faisant partie des Bachkirs environ
2 7 5 , 0 0 0 Teptiars et Bobyles (classes de campagnards), qui leur ressem-
Hent beauconp sons le rappoi't de l'administration et par la proportion
des éléments linnois et tatars dont ils sont mélangés. Ils habitent les
gouvcniements d'Orenbourg, Perm, Viatka et Samara, et se composent
de ïchérémisses, de Votiaks, de Tchouvaches et de Tatars. Les Tffptiars
sont presque tous mahométans et d'origine tatare. L'élément finnois prédomine
chez les Bobyles,
. I
, i,
• »1 ;
TATARS PßÜPßEJIENT DITS,
Nous donnerons nne notice caractéristique des tribus comprises sous
la dénomination de Tatars proprcments dit^, ou Tatai's dans le sens l'igoureux
du mot, dont la population s'élève à 2,200,000 âmes, d'après
les traits particuliers qui distinguent chacune dos subdivisions établies
pins haut. Pour plus de clarté, et atin d'éviter des répétitions inutiles,
nous présenterons un apei'çu histori(iue sur leur origine et lenr affinité
entre elles.
Deux grands événements ont aidé les l'aces turques que nous appelons
tatai'es à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui : l'adoption de la religion
(le Maliomet, et ])Ius tai'd les conquêtes des Mongols sous Tcliinggliis-
Khan et ses snccessenrs,
Leur histoire ne commence en ellet qu'an moment où nue nationalité
étrangère, celle des Mongols, fut introduite dans celle des Turcs. Mais
pour exposer comment cela est arrivé, il nous faut îiécessairement remoutei
aux notions historiques les pins anciennes sur les races turques.
Les premiers renseignements sur les Tatars, ou plutôt sur les tribus
de langue tourane ou turque qu'ils composaient en grande partie, nous
ont été fournis par les Chinois, qui, il y a 2,000 ans, en l'année 126
avant la naissance de Jésus-Christ, rencontrèrent, par suite de la découverte
do l'Asie intérieni-e, difierents peuples tels que les Turcs, les Khounns
(en chinois Ilioung-imu.•Iliong-nou, Kliiounn-nou, devenus probablement
dans la suite les Mongols) et les Toungouses. Si les dénominations ne
s'accordent pas l'igonrousoment avec les difFéi'cnces nationales de ces
peuples, c'est parce que la dynastie régnante donnait ordinairement son
nom au peuple qui lui était soumis. La race pi-imitive des Turcs, habitant
le Turkestan occidental et oriental (c'est mai pi-opos que ces
deux régions sont appelées gi'ande et petite Boukharic), occupa les contrées
qui s'étendaient depuis ia mer Caspienne jusqu'au Koukounor dans
l'Asie centrale, et y vécut pi-incipalement dans les villes et villages, où
e l le s'occupait d'agriculture et de commerce.
Parmi les plus anciens Etats coinius du Tui'kestan, les plus étendus
étaient Tavan (dans le K'bokand d'aujourd'hui); Ta-hia où Da-sia (dans
l a Buukluirie méridionale); l'État des Kirghiz nomades (aujourd'hui
Kirgliiz proprement dits, ou noirs, dont l'origine turque peut encore
M):
( I ,
1 1 1
' ' I