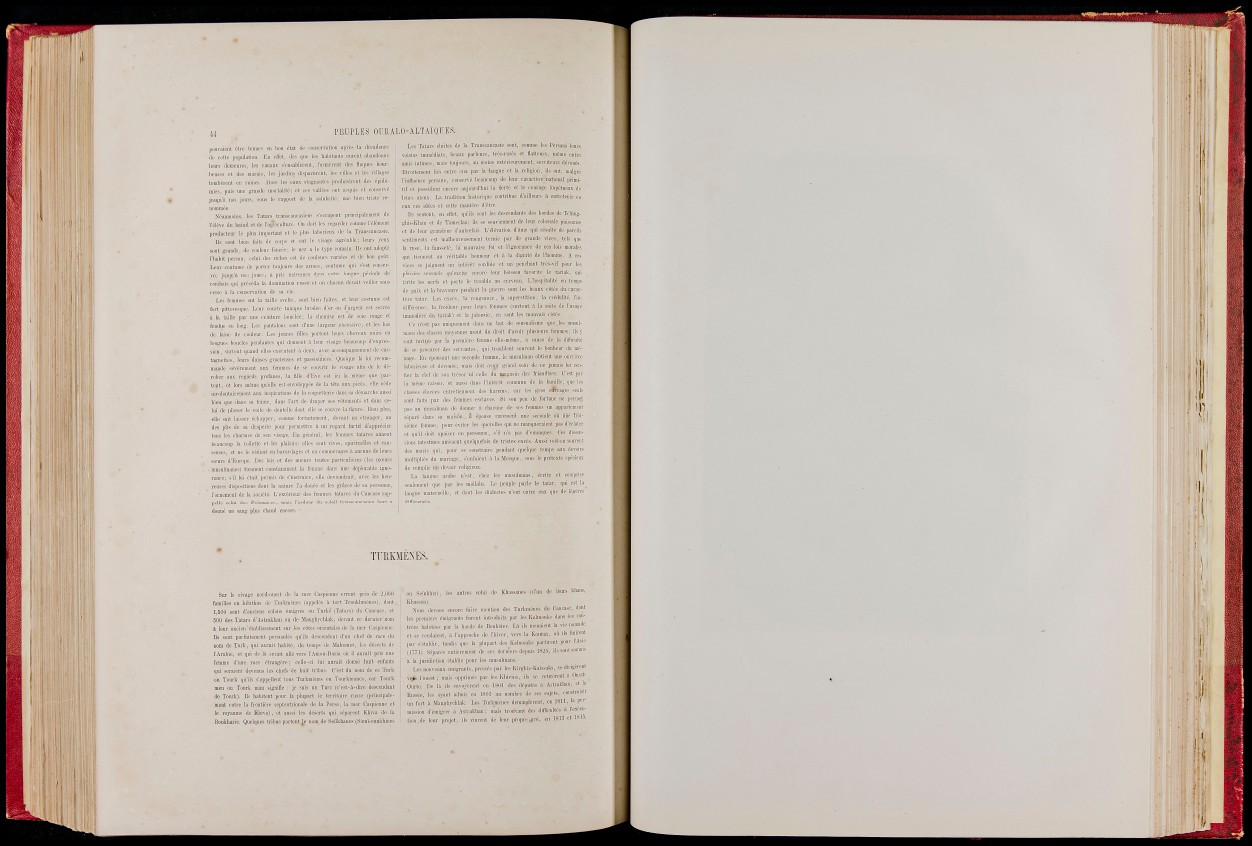
• ' l ' I
ü
u
44
T E U P L E S OURÂLO-ALÏÂIQUES.
{ìouvaiciit ótre tenues en l)on 6tat de conservation après la décadenoc
(le cette poinilation. En effet, ilès que les haljitants curent abanaoiuió
l e u r s demeures, les canaux s'ensablèrent, formèrent des flaques tourb
e u s e s et des marais, les jardins disparurent, les villes et les villages
t o n i b b r o u t en i-nines. Alors les eaux stagnantes prodnisireat des épidém
i e s , puis une grande mortalité; et ces vallées out acquis et conservé
j u s q u ' à nos jours, sous le rapport de la salnbrité, une bien triste renommée.
N é a u m o i n s , les 'Uatars transcaucasiens s'occupent principalement de
l ' é l è v e du batail et de l'agriculture. On doit les regarder comme l'élément
p r o d u e l e n r le plus important et le plus laborieux de la Trauscaucasie.
Ils sont bien faits de corps et ont le visage agréable; leurs yeux
s o n t grands, de conleur foncée; le nez a le type romain. Ils ont adopté
l ' h a b i t persan; celui des riches est de couleurs variées et de bon goût.
L e u r coutume de porter toujours des armes, coutume qui s'est conservée
jusqu'il nos jours, a pris naissance dans cette longue période de
c o m b a t s qui |)récéda la domination russe et où chacun devait veiller sans
cesse il la consei'vation de sa vie.
L e s femmes ont la taille svelte, sont bien faites, et leur costume est
f o r t pittoresque. Leur courte tunique brodée d'or ou d'argent est serrée
à la taille par une ceiuture bouclée; la chemise est de soie rouge et
f e n d u e en long. Les pantalons sont d'une largeur excessive, et les bas
d e laine do couleur. Les jeunes filles portent leurs cheveux noirs en
l o n g u e s boucles pendantes qui donnent leur visage beaucoup d'express
i o n , surtout quand elles exécutent à deux, avec accompagnement de cast
a g n e t t e s , leurs danses gracieuses et passionnées. Quoique la loi recomm
a n d e sévèrement aux femmes do se couvrir le visage afin de le dér
o b e r aux regards profanes, la fille d'Eve est ici la même que part
o u t , et lors môme qu^elle est enveloppée de la tête aux pieds, elle cède
i n v o l o n t a i r e m e n t aux inspirations de la coquetterie dans sa démarche anssi
b i e n que dans sa tenue, dans l'art de draper ses vêtements et dans cel
u i de plisser le voile de dentelle dont elle se couvre la figure. Bien plus,
e l l e sait laisser échappei', comme fortuitement, devant un étranger, un
d e s plis de sa draperie pour permettre à un regard furtif d'apprécier
t o u s les charmes de son visage. En général, les femmes tatares aiment
b e a u c o u p la toilette et les plaisirs; elles sont vives, spiritxielles et caus
e u s e s , et ne le cèdent en bavardages et en commérages il aucune de leurs
s oe u r s d'Europe. Des lois et des moeurs toutes particulières (les moeurs
. musulmane s ) tiennent constamment la fonme dans une déplorable ignor
a n c e ; s'il lui était permis de s'instniire, elle deviendrait, avec les heur
e u s e s dispositions dont la natuj-e l'a douée et les grâces de sa personne,
r o r n e m e n t de la société. L'extérieur des femmes tatares du Caucase rapp
e l l e celui des Polonaises, mais l'ardeur du soleil transcaucasien leur a
donné un sang plus chaud encore.
L e s Tatars chiites de la Transcancasie sont, comme les Persans leurs
v o i s i n s immédiats, beaux parleurs, très-rusés et flatteurs, même entre
amis intimes, mais toujours, au moins extérieurement, serviteurs dévoués.
E t r o i t e m e n t liés entre eux par la langue et la religion, ils ont, malgré
l ' i n f l u e n c e persane, conservé beaucoup de leur caractère national primitif
et possèdent encore aujourd'hui la fierté et le courage impétueux de
l e u r s aïeux, La tradition historique contribue d'ailleurs k entretenir en
e u x ces idées et cette manière d'être.
I l s sentent, en effet, qu'ils sont les descendants des hordes de Tchingg
l i i s - K h a n et do Tamerlan; ils se souviennent de leur colossale puissance
e t de leur grandeur d'autrefois. L'élévation d'âme qui résulte de pareils
s e n t i m e n t s est malhcui'cusement ternie par de grands vices, tels que
l a ruse, la fausseté, la mauvaise foi et l'ignorance de ces lois morales
qui tiennent au véritable honneur et îi la dignité de l'homme. A ces
v i c e s se joignent un intérêt sordide et un penchant très-vif pour les
p l a i s i r s sensuels qu'excite encore leur boisson favorite le tarialc, qui
i i - r i t e les nerfs et porte le trouble au cerveau. L'hospitalité en temps
d e paix et la hi 'avonrc pendant la guerre sont les beaux côtés du caract
è r e tatar. Les excès, la vengeance, la superstition, la crédulité, l'ind
i f f é r e n c e , la froideur pour leurs femmes (surtout à la suite de l'usage
i m m o d é r é du tariak) et la jalousie, en sont les mauvais côtés.
C e n'est pas nniquement dans un but de sensualisme que.les musulm
a n s des classes moyennes usent du droit d'avoir plusieurs femmes; ils y
sont invités par la première femme elle-même, k cause de la difficulté
d e se procurer des servantes, qui troublent souvent le bonheur du mén
a g e . En épousant une seconde femme, le rausuhnan obtient nne ouvrière
l a b o r i e u s e et dévouée, mais doit avojr grand soin de ne jamais lui confier
la clef de son trésor ni celle du magasin des friandises. C'est par
l a même raison, et aussi dans l'intéi'êt commun de la famille, que les
c l a s s e s élevées entretiennent des harems; car les gros oif\-rages seuls
s o n t faits par des femmes esclaves. Si son peu de fortune ne permet
p a s au musulmau de donner à chacune de ses femmes un appartement
s é p a r é dans sa maison, il épouse rarement inie seconde ou une trois
i è m e femme, ponr éviter les querelles qui ne manqueraient pas d'éclater
e t qu'il doit apaiser en personne, s'il n'a pas d'eunuques. Ces dissensions
intestines amènent quelquefois de tristes excès. Aussi voit-on souvent
des maris qui, pour se soustraire pendant quelque temps aux devoirs
m u l t i p l i é s du mariage, s'enfuient ii la Mecque, sous le prétext e spécieux
d e remplir un devoir religieux.
L a langue arabe n'est, chez les musulmans, écrite et comprise
s e u l e m e n t que par les mollahs. Le peuple parle le tatai', qui est la ^
l a n g u e maternelle, et dont les dialectes n'ont entre eux que de légères
d i f f é r e n c e s .
T O K M E X E S ,
• Sur le rivage nord-ouest de la mer Caspienne errent près de 2,000
f a m i l l e s ou kibitkas de Turkmènes (appelés à tort Troukhmènes), dont.
1 , 5 0 0 sont d'anciens colons émigrés on Turks (Tatars) du Caucase, et
5 0 0 des Tatars d'Astrakhan ou de Manghychlak, devant ce demie]- nom
à leur ancien'établissement sur les côtes orientales de la mer Caspienne.
I l s sont parfaitement persuadés qu'ils descendent d'un chef de race du
n om de Turk, qui aurait habité, du temps de Mahomet , les déserts de
l ' A r a b i e , et qui de là serait allé ver s l'Amon-Baj-ia où il aurait pris une
f e m m e d'une race étrangère; celle-ci lui aurait donné huit enfants
qui seraient devenus les chefs de huit tribus. C'est du nom de ce Turk
o u Tourk qu'ils s'appellent tons Turkmènes ou Tourkmanes, car Tourlc
m e n ou Tourk man signifie : je suis un Turc (c'est-îi-dire descendant
d e Tourk). Ils habitent pour la plupart le territoire russe (prijicipalem
e n t entre la frontière septentrionale de la Perse, la mer Caspieinie et
l e royaume de Ebiva), et aussi les déserts qui séparent Kbiva de la
B o u k h a r i e . Quelques tribus portent le nom de Seïlkhanes (Siouï-ounkliines
o u Seïnkhis), les antres celui de Khassanes (d'un de leurs klians,
K h a s s a n ) .
N o u s devons encore faire mention des Turkmènes du Caucase, dont
l e s premiers emigrants furent introduits par les Kahnouks dans les cont
r é e s habitées par la horde de Boukéiev. Lii ils menaient la vie nomade
e t se rendaient, à l'approche de riiivei-, vers la Konma, où ils fnnrcnt
l ) a r s'établi 1-, tandis que la i)lupart des iv al m o n k s pai'tirent pour l'Asie
( 1 7 7 1 ) . Séparés entièrement de ces derniers dcj)uis 1825-, ils sont soumis
il l a juridiction établie poui- les musulmans.
L e s nouveaux émigrants, pressés par les Kii'gliiz-Kaïssaks, se dii'igèrcnt
v c K l'ouest; mais opprimés pai- les K'hivins, ils se i-etii'èrent h Ousst-
O u r t e . De là ils envoyèi'cnt eu 1801 îles députés îi Asti'aklmn, et la
R u s s i e , les ayant admis en 1S03 an nombre de ses sujets, construisit
u n fort à Manghyclilak". Les Turkmènes deman,dèreut, en 1811, Ifi Pf^'"
m i s s i o n d'émigrer à Astrakhan ; mais trouvant des difficultés l'éxecut
i o n .de leur projet, ils vinrent de leur propre,gi-é, en 1813 et 1315,
• t • '1
: i r
• i'il