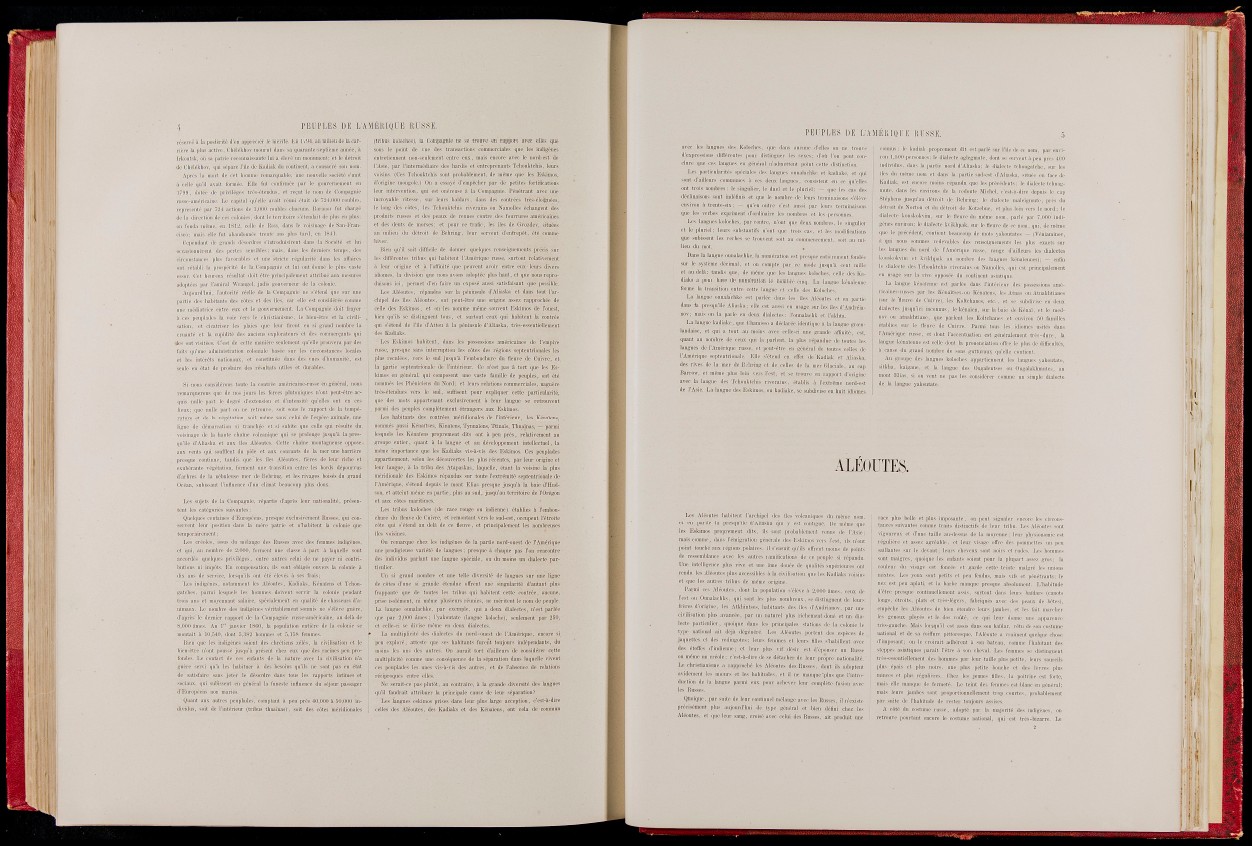
4 P E U P L E S DE L 'AMÉ l í lQUE RUSSE.
róservc: íi la ijostériié il'en apprC'cior le mérite. Kn 1794, au milieu de la carr
i è r e la |jlus activo, Chélékliov uiouriil liaiis sa qiiaraiite-septiômo année, à
[i-lcoutsic, oi:i sa patrie recoiuiaissaiite lui a élevé un inomunent; ot le détroit
d e (.'hólckliüv, (|ni sépare l'Ile de Kiidiak du continent, a consacré sou nom.
A p i ' è s la mort de cet lionnue renuxriiualjle. line nouvelle société s'iuiit
à celle qu'il avait formée. Klle i'iit conlinnée par le gouvernement on
1 7 9 0 , diilée do privilége.s très-étendus, et reçut le nom de Compagnie
r u s s e - a m é r i c a i n e , Le cai)ital t|u'olle avait réuni était do 724.000 roubles,
r o p i ' e s o n t é |)nr 724 actions de 1,000 rouble.s cliacunc. Baraiiov fut chargé
d e la dirociiou de cos oolonie.s. dont lo lerrifuiro s'étcndail de plus on pins:
on fonda inOnio, on 1812, celle de lioss, dans le voisinage de San-Fi'ane
i s c o ; mais elle fnt ¡ibaudonnée tronío ¡tus plus tard, en 18-11.
C o p e n d a n t do grands dôsoi-dres s'introduisirent dans la Société et lui
u c e a s i o n n è r o u l dos portes sensibles; mais, dans les derniers temps, des
o i r c o n s t a ï u ' e s plus favorables et une stricte régulai'ité dans les nffiiii-es
ont rétabli la ]irospéi-ité do la Compagnie et lui ont donné le plus vaste
e s s o r . Cet heureux résultat doit ûtre principalement attribué aux mesures
a d o p t é e s jiiir l'amiral Wrangel, Jadis gonvei'ueui' de la colonie.
A u j o u r d ' h u i , l'auloi'ité réelle de la Com])agnic ne s'étend quo sui- une
p a r t i e des habitants des côtes et des îles, car elle est considérée comme
une nu-diatrice entre eux et le gouvei'nement, La Compagnie doit frayer
)\ ces iionplades la voie vers le christianisme, le bien-être et la civilis
a t i o n . et cicatriscr ics plaies que leur firent en si grand nombre la
c r u a u t é et la cupidité des anciens explorateurs et dos commerçants qui
vies ont visitées. C'est de cette manière seulement qu'elle prouver a par des
fait,s qu'une administration coloniale basée sur les circonstauces locales
e t les intéi'Cts nationaux, et constituée dans des vues d'iiumanité, est
s e u l e en état do iiroduire des résultats utiles et durables.
Si nous considérons toute la contrée aniéricaiuc-russo en général, nous
r e m a r q u e r o n s (pio de iu)s jours les forces plutoniques n'ont peut-éti'C acq
u i s nullo part le degré d'extension et d'intensité qu'elles ont en ces
l i e u x ; _que nulle part on ne retrouve, soii. sons le rajiport de la tempér
a t u r e et de la végétation, soit même sons celui de l'espèce animale, une
l i g u e de démarcation si trancilée et si subite que celle qui résulte du
v o i s i n a g e do la haute chaîne volcanique qui se prolonge jusqu'à la presq
u ' î l e d'Aliaska et aux îles Aléoutes. Cette chaîne montagneuse oppose
a u x vents qui soufflent du pôle et aux courants de la mer une barrière
p r e s q u e continue, tandis que les îles Aléoutes, fières de leur riclie et
e x u b é r a n t e végétation, forment une transition entre les bords dépourvus
d ' a r b i ' e s do la nébuleuse mer de Behr ing, et les rivages boisés du gi-and
O c é a n , subissant l'infincnce d'un climat beaucoup plus doux.
L e s sujets de la Compagnie. ré])artis d'après leur nationalité, présent
e n t les catégories suivantes:
Q u e l q u e s centaines d'Eui'opéens, ])rcsque exclusivement Russes, qui cons
e r v e n t leur position dans la mère patrie et n'habitent la colonie que
t e m p o r a i i ' o m o n t ;
L e s créoles, issus du mélange des Eusses avec des femmes indigènes,
ot qui. an nombre do 2.000. forment une classe ii part h laquelle sont
a c c o r d é s quelques privilèges, entre anti'es celui de ne payer ni contrib
u t i o n s ni impôts, Kn compensation, ils sont obligés envers la colonie à
d i x ans do sei'vice. lorsqu'ils ont été élevés ii ses frais;
L e s indigènes, notamment les Aléoutes. Kadiaks, Kénaïons et Tclioug
a t c l i e s , parmi lesquels les hommes doivent servir la colonie pendant
t r o i s ans et moyennant salaire, spécialement on qualité de chasseui-s d'an
i m a u x . Le nombre des indigènes véritablement soumis ne s'élève guère,
d ' a p r è s le dei'nier ra])])ort de la Crnupagnie russe-américaine, au delii de
8 , 0 0 0 âmes. An 1" janvier 1860. la population entière de la colonie se
m o n t a i t îi 10,540, dont 5,382 hommes et 5,158 femmes.
Bien que les indigènes soient des cln-étieus zélés, la civilisation et le
b i e n - ê t r e n'ont poussé jusqu'à présont chez eux (|ue des i-acines ])eu prof
o n d e s . Le contact de ces enfants de la nature avec la civilisation n'a
g u è r e .servi qu'il les habituer à des besoins qu'ils ne sont ¡¡as en état
d e satisfaire sans jeter le désordre dans tous les rapports intimes et
s o c i a u x , qui subissent eu général la funeste influence du séjour passager
d ' E i n - o p é e n s non mariés.
Quant aux autres peuplades, comptant il peu près 40,000 à 50,000 ind
i v i d u s , soit de l'intérieur (tribus thnaïnas), soit des cotes méridionales
( t r i b u s koloches), la Compagnie ne se trouve eu rapport avec clies que
sous le point de vue des transactions commerciales que les indigènes
e n t r e t i e n n e n t non-seulement entre eux, mais encoi-e avec le nord-est de
l ' A s i e , par l'intermédiaire des hardis ot entreprenauts Tcliouktchis, leurs
voisins, (Ces Tchonktchis sont probablement, de même que les Eskimos,
d ' o r i g i n e mongole,) On a essayé d'empêclier par de petites fortifications
l e u r intervention, qui est onéreuse à la Compagnie. Pénétrant avec une
i n c r o y a b l e vite.sse, sui- loui'S baïdars, dans des contrées très-éloi^nées,
le long des cotes, les Tchouktchis riverains ou Namulles échangent des
p r o d u i t s russes et des iieaux de renues contre des fourrures américaines
e t des dents de morses; et pour ce trafic, les îles de Gvozdev, situées
a u milieu du détroit de Beliring, leur servent d"enfre])ot, été comme
h i v e r .
B i e n qu'il soit difficile de donner ([uelques renseignements ])récis sur
l e s différentes tribus i|ui habitent l'Amérique russe, .surtout relativement
ù leur origine et à l'aflinité que peuvent avoii- entre eux leurs divers
i d i o m e s , la division que nous avons ado])téc plus l iant , et que nous reprod
u i s o n s ici, permet d'en faire un exposé aussi satisfaisant que possible.
L e s Aléoutes, répandus sur la péninsule d'Aliaska et dans tout l'arc
h i p e l des îles Aléoutes, ont peut-être une origine avisez rapprochée do
c e l l e des Eskimos, et on les nomme même souvent Eskimos de l'ouest,
b i e n qu'ils se distinguent tous, et surtout ceux qui habitent la contrée
(|ui s'étend de l'île d'Attou à la péninsule d'Aliaska, très-essentiellement
des Kadiaks.
- Les Eskimos habitent, dans les possessions américaines de l'empire
r u s s e , presque sans interruption les côtes des régions septentrionales les
p l u s reculéos, vers le sud jusqu' à rembouchnre du fleuve de Cuivre, et
l a ixartie septentrionale de l'intérieur. Oc n'est pas à tort que les Esk
i m o s en général, qui composent une vaste famille de peuples, ont été
nommés les Phéniciens du Nord; et leurs relations commerciales, naguère
t r è s - é t e n d u e s vers le sud, suffisent pour expliquer cette particularité,
q u e des mots appartenant exclusivement à leur langue se l'cirouvent
. ])armi des peuples complètement étrangers aux Eskimos.
L e s habitants des contrées méridionales de l'intérieur, les Kénaïens,
nommés aussi Kénaïtses, Kinaïens, Tpinaïens, Ttiiiaïs, Thnaïnas, — parmi
l e s q u e l s les Kénaïens proprement dits ont à peu près, relativement au
g r o u p e entier, quant à la langue et au développement intellectuel, la
même importance que les Kadiaks vis-à-vis des Eskimos. Ces peuplades
a p p a r t i e n n e n t , selon les découvertes les plus récentes, par leur origine et
l e u r langue, à la tribu des Atajiaskas, laquelle, étant la voisine la plus
m é r i d i o n a l e des Eskimos répandus sur toute l 'extrémi té septentrionale de
l ' A m é r i q u e , s'étend depuis le mont Elias presque jusqu'à la baie d'Hudson,
et atteint même en par t ie, plus au sud, jusqu'au territoire de l'Orégon
e t aux côtes maritimes.
L e s tribus koloches (de race ronge ou indienne) établies à l'embouc
î i u r e du fleuve de Cuivre, et remontant vers le sud-est, occupent l'étroite
c ô t e qui s'étend au delà de ce fleuve, et principalement les nombreuses
î l e s voisines.
On remarque cbez les indigènes de la partie nord-ouest de l'Amérique
u n e prodigieuse variété de langues ; presque à chaque pas l'on rencontre
d e s individus parlant une langue spéciale, ou du moins un dialecte part
i c u l i e r .
Un si grand nombre et une telle diversité de langues .sur une ligne
do côtes d'une si grande étendue offrent une singularité d'autant plus
f r a p p a n t e que de toutes les tribus qui habitent cette contrée, aucune,
p r i s e isolément, ni môme plusieurs réunies, ne méritent le nom de peuple.
L a langue ounalachke. par exemple, qui a deux dialectes, n'est parlée
i | u e ])ar 2,000 âmes; ryakoutate (langue koloche), seulement ])ar 250,
e t celle-ci se divise mémo en deux dialectes.
• La multiplicité des dialectes du nord-ouest de l'Amérique, encore si
lieu exploré, atteste que ses liabitants furent toujours indé|)endants, du
m o i n s les uns des autres. On aurait tort d'ailleurs do «ousidérer cette
m i i l t i i i l i c i t é comme une conséquence de la séparat ion dans laquelle vivent
ces peuplades les unes vi.s-à-vis des autres, et de rabsence do relations
r é c i p r o q u e s outre elles.
N e serait-ce pas plutôt, au contraire, à la grande diversité des langues
q u ' i l faudrait attribuer la )n'iucipale cause de leur séparation?
L e s langues eskimos prises dans leur plus large acception, c'est-à-dire
c e l l e s des Aléoutes, des Kadiaks et des Kénaïens, ont cela de commun
P E U P L E S DE L ' A l l É K I O l E EUSSE.
a v e c les langues des IColoclies. quo dans aucune d'elles ou ne trouve
d ' e x p r e s s i o n s diiloi'outo.-: jjour distinguer les sexes: d'où l'on peut conc
l u r e que ces langues en général n'admettent ])oint cotte distinction.
Los jjarticularités spéciales dos langues oiuuilachko et kadiake, et qui
sont d'ailleurs communes à ces deux langues, consistent en ce qu'elles
ont trois nombres: le singulier, le duel ot le pluriel: — que les ca.s dos
d é c l i n a i s o n s sont indéfinis et que le nombre de leurs tonninai.sons s'élève
e n v i r o n il trente-six : — qu'on (uitro c'est aussi par leurs terminai.sons
quo les verbes expriment d'ordinaire les nombres ot les ])crsonncs.
L e s langues koloches, par contre, n'ont que deux nombres, le singulier
e t le pluriel: leurs substantifs n'ont quo Irois cas, et les modifications
q u e subissent les verbes se trouvent soit au commencement, soit au mil
i eu du mot. ,
Dans la langue ounalachke, la numération est |)rosquo ent iùiement fondée
s u r le système décimal, et on compte par ce mode jusqu'à cent mille
e t au delà: taudis que. do même que les langues koloches, cello des Kad
i a k s a pour base de numération le nomine cinq. La langue kéna'ienno
f o r m e la ti-ansition entre cette tangue ot celle des Koloches.
L a langue ounalachke est parlée dans les îles Aléoutes ot on partie
d a n s la pi'esqn'ilo Alia.ska: elle est aussi en usage sur les ¡les d'Andréian
o v ; mais on la parle on deux dialectes: l'onnalachk et l'akhta.
L a langue kailiako, que Chamisso a déclarée identique à la langue grcenl
a n d a i s o , et qui a tout au moins avec celle-ci une grande affinité, est,
q u a n t au nombre de ceux qui la parlent, la plus répandue de toutes les
l a n g u e s de l'Amérique russe, et peut-être en général de toutes celles de
l ' A m é r i q u e septentrionale. Elle s'étend on efi'et de'Kadiak et Aliaska,
des l'ives do la mer de Bohring ot de colles do la mer Glaciale, au cap
BarroM', et même plus loin vers l'est, ot se trouve en rapport d'origine
a v e c la langue des Tchouktchis riverains, établis à l'extrême nord-est
d e l'Asie. La langue des Eskimos. ou kadiake, se subdivise en hui t idiomes
c o n n u s ; le kadiak prO|u-emeu( dit est parlé sur l'ilo de co nom, paron\ir<
m 1,500 per.sonnos; le dialecte aglognuito, dont se servent à i)ou près 400
i n d i v i d u s , dans la partie nord d'Aliaska; le dialocto tchougatcho, sur les
î l e s du même nom et dans la partie sud-est d'Aliaska, située on face do
K a d i a k , est encore moins répandu quo les précédent s : le dialecte tchnagm
u t o . dans les environs do la redoute Michel, (-'est-à-dire depuis le cai»
S t é p h e n s jusqu'au détroit do Rohring: le dialocto maleïgmulo, près du
d é t r o i t de Norton ot dti détroit do Kotzebuc, et plus loin vers le nord; le
( l i a l o o to kouskokvim, sur le tlouvo du mémo nom, parlé par 7,OOO'indig
è n e s environ: le dialecte kviklipak, sur le fleuve de co nom, qui, de même
q u e le précédent, contient beaucou)) de mots yakoutates — (Veniaminov,
il qui nous summes roilovnbles des ronseignomonts les plus exact.s sur
les langues du nord de l'Amérique russe, range d'ailleurs les dialectes
k o u s k o k v im et kvikhpak au mmibre dos langues kéimïennes); — enfin
le dialecte des Tohonktchis riverains on Namolle,^, ([ui est principalement
en usage siii- la rive opposée du continent asiatique.
La langue kénaïonno est parlée dans l'intérioiir dos possessions amér
i c a i n e s - ] usses par les Kénaïtses.ou Kénaïens. les Atnas ou Atnakhtianes
( s u r le "lleuve de Cuivre), les Koltclianes, etc., et se subdivi.se en deux
d i a l e c t e s jusqu'ici inconnus, le kénaïen, sur la baie do Kénaï , et le mednov
ou atnakhtiane, que parlent les Koltclianes et onvii'on 50 familles
é t a b l i e s sur le Heuve de Cuivre, Pai'mi tous les idiomes usités dans
l ' A m é r i q u e russe, et dont l'accentuation est généralemeut très-dure, la
l a n g u e kénaïenne est celle dont la prononciation offi'o le plus de difficultés,
à cause du grand nombre de sons gutturaux qu'elle contient.
A u groupe des langues koloches appartiennent les langues yakoutatu,
s i t k h a , kaïgane, et la langue des Ougalentses ou Ougalaklimutes, au
mont Elias, si on veut ne pas les considère)' comme un simple dialecte
d e la langue yakoutate.
H''
ALÉOUTES.
L e s Aléoutes habitent l'archipel des îles volcaniques du même nom.
e t en partie la presqu'île d'Aliaska qui y est contigui'. De même quo
l e s Eskimos ])roprement dits, ils sont iirobablomont venus do l'Asie;
m a i s comme, dans l'émigi-ation générale des Eskimos vois Test, ils n'ont
i m i n t touché aux régions polaires, il s'ensui t qu'ils offrent moins do points
d e ressemblance avec les autres ramifications de ce ])euplo si répaiuln.
Une intolligonce plus vire et une àme douée de qualités supérieures ont
r e n d u les Aléoutes plus accc.ssibies à la civilisation que les Kadiaks voisins
e t que les autres tribus do même oi'igino.
P a r m i ocs Aléoutes. dont la population s'élève à 2,000 âmes, ceux do
l ' e s t ou Oiiualacliks. qui sont les plu.s nombreux, se distinguent do leurs
f r è r e s d'origine, les Atkhintses, habitants dos îles d'Andrianov. par une
c i v i l i s a t i o n ¡)lns avancée, par un naturel plus richement doué et un dial
e c t e particulier, quoique dans les principales stations do la colonie le
t y p e national ait déjà dégénéré. Les Aléoutes ])ortent dos espèces de
j a ( | u e t t c s et dos redingotes; leurs femmes et leurs filles s'habillent avec
des étoffes d'indienuo; et leur plus vif désir est d'époiisor un Russe
ou mémo un créole; c'est-à-dire de se détacher de leur propre nationalité.
Le christianisme a rapproché les Aléoutes des Russes, dont ils adoptent
a v i d e m e n t les luauirs ot les habitudes, ot il no manque "plus que l'introd
u c t i o n de la langue iiarmi eux pour aclievei- lour complète fusion avec
les liussos.
Q f i o i q n o , par suite de leur continuel mélange avec les Russes, il n'exi.ste
p r é c i s é m e n t plus aujourd'hui de (ypo général ot bien défini cliez les
A l é o u t e s , ot que leur .sang, croisé avec celui des Russes, ait produit une
r a c e plus belle et plus imposante, on peut signaler encore les circonst
a n c e s suivantes comme traits distinctifs do leur tribu. Les Aléouto'c sont
v i g o u r e u x et d'une taille au-dessus de la moyenne: leur physionomie est
r é g u l i è r e et assez agréable. et leur visage offre de.« pommettes un peu
. s a i l l a n t e s sur le devant: leurs cheveux sont noirs et rudes. Les hommes
sont maigres, quoique les enfants soient pour la plu|)art assez gros; la
c o u l e u r du visage est foncée et garde cette teinte malgré les unions
m i x t e s . Los yeux sont jietits ot iieu fendus, mais vifs et pénétrants: le
n e z est peu aplati, et la barbe manque presque absolument. L'habitude
d ' ê t r e presque continuellement assis, surtout dans leurs baïdars (canots
l o n g s , étroits, plats et très-légei's. fabriqués avec des peaux de bêtes),
e m p ê c h e les Aléoutes de bien étendre leurs jambes, et les fait marcher
ios genoux ])loyés ot le dos voiité, ce qui leni- donne une apparence
t r è s - g a u c h o . Mais lorsqu'il est assis daus son baïdar. vétu do son costume
n a t i o n a l et de sa l'oiffure pittoresque, l'Aléonto a vraiment quei(|ue chose
d ' i m p o s a n t : on le croirait adhérent à son bateau, comme l'habitant des
s t e p p e s asiatiques paraît l'être à son cheval. Les femmes .se distinguent
t r è s - e s s e n t i e l l e m e n t des hommes j)ar leur taille plus jietite, leui's sourcils
p l u s é])ais et ¡ilus noirs, une i)lus petite bouche et des lèvres plus
milices et plus régulières. Chez les jeunes filles, la poitrine est forte,
mais elle manque do fermeté. Le teint des femmes est blanc en général;
mais leurs jambes sont proportioimellement trop courtes, probablement
p a r suite do l'habitude do rester toujours assises.
A côté du costume russe, adopté pai' la majorité des indigènes, on
r e t r o u v e pourtant encore le costume national, qui est très-bizarre. Le