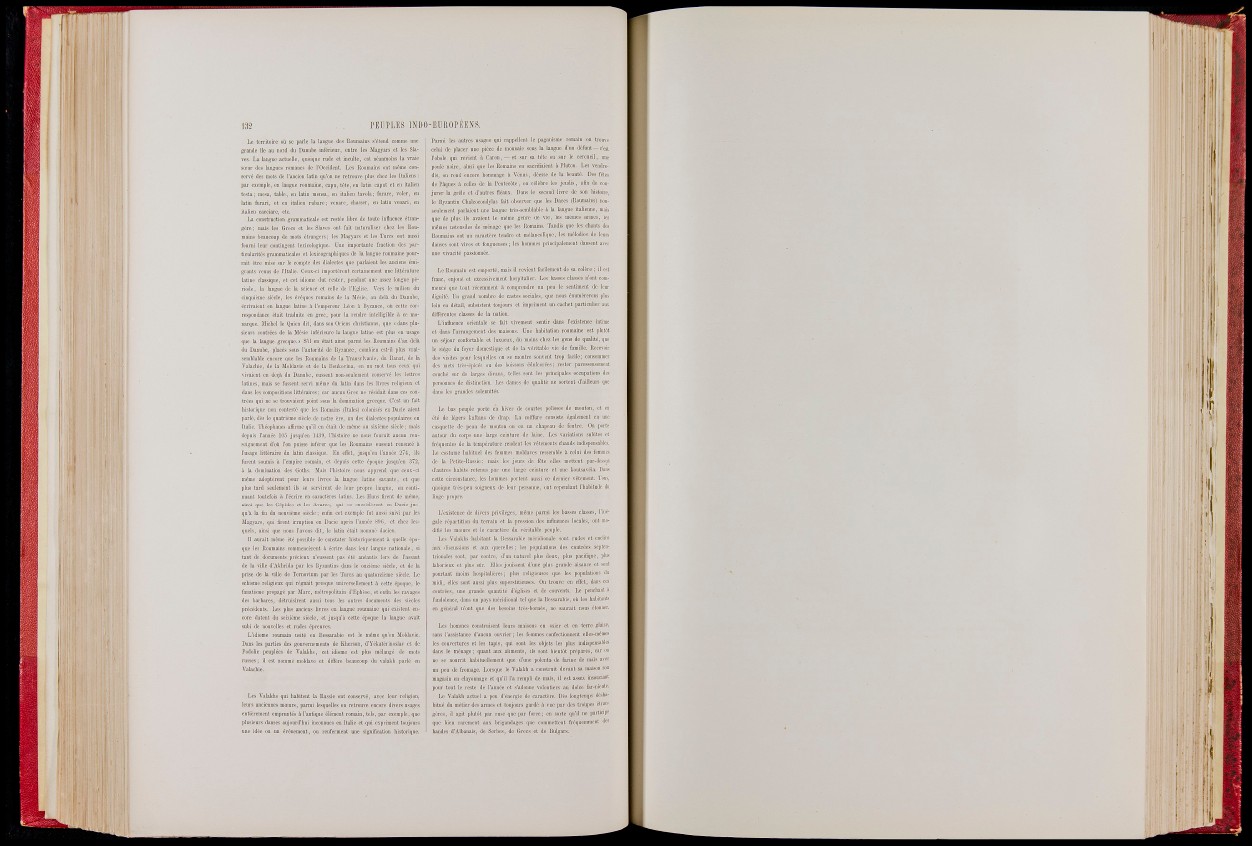
1} : í
I ' I'
1 íi
!' ï
1 3 2 P E U P L E S INÜO-EUROPÉENS.
L e lon'itoirc où se parle la langue (les Roumains s'ótencl comme une
grande ile au nord du Danube inférieur, entre les Magyars et les Slaves,
La langue actuelle, quoique rude et inculte, est néanmoins la vraie
sceui- des langues romanes de rOccident. Les Roumains ont inême conservé
des mots de l'ancien latin qu'oii ne retrouve plus chez les Italiens:
par exemple, en langue roumaine, capu, tète, en latin caput et en italien
t e s t a ; mesa, table, en latin mensa, en italien tavola; furaré, voler, en
latin fiirari, et en italien rubare ; venare, chasser, en latin venari, en
italien cacciare, etc.
L a construction grammaticale est i-estée libre de toute influence étrangère
; mais les Grecs et les Slaves ont fait uaturaliser cliez les Roumains
beaucoup de mots éti'angers; les Magyars et les Turcs ont aussi
fourni leur contingent lex ico logique. Une importante fraction des particnlarités
grammaticales et lexicogi'apliiques de la langue roumaine pourr
a i t 6tfe mise sur le compte des dialectes que parlaient les anciens émigrants
veniis de l'Italie. Ceux-ci importîirent certainement nue littérature
latine classique, et cet idiome dut rester, pendant une asse?: longue pér
i o d e , la langue de la science et celle de l'Eglise. Vers le milieu du
cinquième siècle, les évûques romains de la Mésie, au delà dn Dannbe,
écrivaient en langue latine à l'empereur Léon à Byzance, où cette correspondance
était traduite en grec, pour la rendre intelligible il ce monarque.
Miclie! le Quien dit, dans son Oriens cbristianns, que < dan s plusieurs
contrées de la Mésie inférieure la langue latine est plus en usage
que la langue grecque. > S'il en était ainsi parmi les Roumains d'au delà,
du Danube, placés sous l'autorité de Byzauce, combien est-il plus vraisemblable
encore que les Roumains de la Transylvanie, du Bauat, de la
Valacliic, de la Moldavie et de la Eoukovina, en un mot tous ceux qui
vivaient en dcçii du. Danube, eussent non-seulement conservé les lettres
latines, mais se fnssent servi môme du latin dans les livres religieux et
dans les compositions littéraires; car aucun Grec ne résidait dans ces contrées
qui ne se tj-ouvaient point sous la domination grecque. C'est un fait
historique non contesté que les Romains (Itales) colonisés en Dacie aient
parlé, dôs le qnatrième siècle de notre ère, im des dialectes populaires en
Italie. Théophanes affirme qu'il en était de même au sixième siècle; mais
depuis l'année 105 jusqu'en 1439, l'histoire ne nous fournit aucun renseignement
d'où l'on puisse inférer que les Rounxaius eussent renoncé
l'usage littéraire du latin classique. En effet, jusqu'en l'année 274, ils
furent soumis ¡i. l'empire romain, et depuis cette époque jusqu'en 372,
à la domination des Gotbs. Mais l'histoire nous apprend que ceux-ci
même adoptèrent pour leurs livres la langue latine savante, et que
plus tard seulement ils se servirent de leur propre langue, en continuaut
toutefois ii l'écrire en caractères hvtins. Les Iluns firent de même,
ainsi que les Gépides et les Avares, qui se succédèrent en Dacie jusqu'à
la fin du neuvième siècle ; enfin cet exemple fut au>;si suivi par les
Magyars, qui firent irruption en Dacie après l'année S9G, et chez lesquels,
ainsi que nous l'avons dit, le latin était nommé dacien.
11 aurait même été possible de constater historiquement il quelle époque
les Roumains commencèrent à écrire dans leur langue nationale, si
tant de documents précieux n'eussent pas été anéantis lors de l'assaut
de la ville d'Akhrida par les Byzantins clans le onzième siècle, et de la
prise de la ville de ïernovium par les Turcs au quatorzième siècle. Le
schisme religieux qni régnait presque universellement à cette époque, le
fanatisme propagé par Marc, mctroi)ülitain d'Ephèse, et enfin les ravages
des barbares, délJ'uisirent aussi tous les autres documents des siècles
précédents. Les plus ajiciens livres en langue roumaine qui existent encore
datent du seizième siècle, et jusqu'à cette époque la langue avait
subi de nouvelles et rudes épreuves.
L'idiome roumain usité en Bessai'abie est le môme qu'en Moldavie.
Dans les parties des gouvernements de Klierson, d'Yékatéi-inoslav et de
Podolie peuplées de Valakhs, cet idiome est plus mélangé de mots
r u s s e s ; il est nommé moldave et diffère beaucoup du valakh parlé en
Valachie.
Les Valakhs qui habitent la Russie ont conservé, avec leur religion,
leurs anciennes moeurs, parmi lesquelles on retrouve encore divers usages
entièrement empruntés à l'antique élément romain, tels, par exemple, que
plusieurs danses aujourd'hui inconnues en Italie et qui expriment toujours
une idée ou un événement, ou renferment une signification historique.
Parmi les autres usages qui rappellent le paganisme romain on trouve
celui de placer une pièce de monnaie sous la langue d'un défunt —c'est
l'obole qui revient à Caron, — e t sur sa féte ou sur le cercueil, une
poule noire, ainsi que les Romains en sacrifiaient à Pluton. Les vendredis,
on rend encore liommage à Vénus, déesse de la beauté. Des fêtes
de Pâques à celles de la Pcntecôtc, on célèbre les jeudis, afin de conj
u r e r la grêle et d'autres fléaux. Dans le second livi-e de son histoire,
le Byzanti]! Chalcocondylas fait observer que les Daces (Roumains) nonseulement
parlaient une langue très-semblable à la langue italienne, mais
que de plus ils avaient le môme genre de vie, les mémos armes, les
mômes ustensiles de ménage que les Romains, Tandis que les chants des
Roumains ont un caractère tendi-e et mélancolique, les mélodies de leurs
danses sont vives et fougueuses ; les hommes principalement dansent avec
une vivacité passionnée.
L e Roumain est emporté, mais il revient facilement de sa colère ; il est
franc, enjoué et excessivement hospitalier. Les basses classes n'ont commencé
que tout l'écemment i\ comprendre un peu le sentiment de leur
dignité. Un grand nombre de castes sociales, qne nous énumérerons pins
loin en détail, subsistent toujours et impriment un cachet particulier aux
difi'érentes classes de la nation.
L'influence orientale se fait vivement sentir dans l'existence intime
e t dans l'arrangement des maisons. Une habitation roumaine est plutôt
un séjour confortable et luxueux, du moins chez les gens de quahté, que
le siège du foyer domestique et de la véi'itable vie de famille. Recevoir
des visites pour lesquelles on se montre souvent trop facile; consommer
des mets très-épicés ou des boissons édulcorées; rester paresseusement
couché sur de larges divans, telles sont les principales occupations des
personnes de distinction. Les dames de qualité ne sortent d'ailleurs que
dans les grandes solennités.
L e bas peuple porte eu hiver de courtes pelisses de mouton, et en
été de légers kaftans de drap. La coifl\ire consiste également eu une
casquette de peau de mouton ou en un chapeau de feutre. On porte
autour du corps une large ceinture de laine. Les variations subites et
fréquentes de la température rendent les vêtements cliauds indispensables.
L e costume habituel des femmes moldaves ressemble à celui des femmes
de la Petite-Russie ; mais les jours de féte elles mettent par-dessus
d ' a u t r es habits retenus par une large ceinture et une koutsavéia. Dans
cette circonstance, les hommes portent aussi ce dernier vêtement. Tous,
quoique très-peu soigneux de leur personne, ont cependant l'habitude du
linge propre.
Jj'cxistcnce de divers privilèges, même jiarmi les basses classes, l'inégale
répartition du terrain et la pression des influences locales, ont modifié
les mujurs et le caractère du véritable peuple.
Les Valakhs habitant la Bessarabie méridionale sont rudes et enclins
aux discussions et aux querelles; les populations des contrées septentrionales
sont, par conti-e, d'un naturel plus doux, plus pacifique, plus
laborieux et plus sur. Elles jouissent d'une plus grande aisance et sont
pourtant moins hos])italières ; plus religieuses que les populations du
midi, elles sont aussi plus superstitieuses. On trouve en effet, dans ces
contrées, une grande quantité d'églises et de couvents. Le penchant à
l'iudolence, dans un pays méridional tel que la Bessarabie, où les habitants
en général n'ont que des besoins très-bornés, ne saui-ait nous étonnei'.
Les hommes construisent leurs maisons en osier et en terre glaise,
sans l'assistance d'aucun ouvrier; les femmes confectionnent elles-mêmes
les couvertures et les tapis, qui sont les objets les plus indispensables
dans le ménage; quant aux aliments, ils sont bientôt prépai'és, car on
n e se nourrit habituellement que d'une polenta- de fai'ine de maïs avec
un peu de fromage. Loi'squc le Valakh a const]-uit devant sa maison son
magasin en clayonnage et qu'il l'a rempli de maïs, il est assez insouciant
poui- tout le reste de l'année et s'adonne volontiers au dolce fui'-nientc.
L e Valakh actuel a peu d'énergie de caractère. Dès longtemps désliahitué
du métier des armes et toujours gardé à vue par des tro'upes éti'Higères,
il agit ])lutót jiar ruse que par force ; en sorte qu'il ne particq)e
que bien l'arement aux brigandages que commettent fréquemment des
bandes d'Albanais, de Serbes, de Grecs et de Bulgars.
f I ^