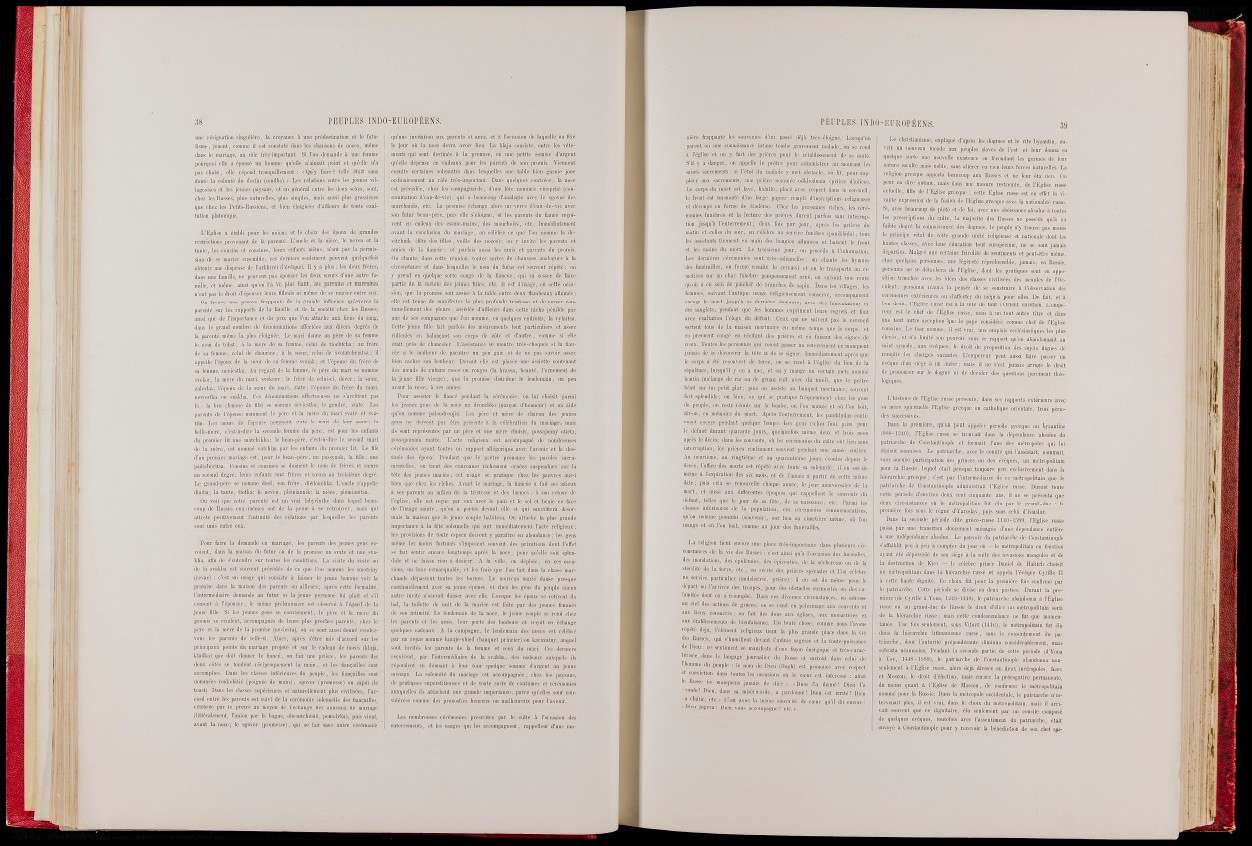
s
V
MI SM
Iti
38 P E U P L E S INDO-EUROPÉENS.
line résignation singulière, hi croyance à une prédestination et le fatalisme,
jouent, cominc il est constate clans les chansons de noces, môme
dans le mariage, un i-ôic trôs-important. Si l'on demaïKlo ti une femme
pourquoi elle a éponsé nn homme qu'elle n'aimait point et qu'elle n'a
pas choisi, elle répond tranquillement : < Qu'y faire? telle était sans
doute la volonté du destin (soudba). » Les relations entre les jeunes villag
eoisos et les jeunes paysaiis, et en général entre les deux sexes, sont,
chez les Russes, plus naturelles, plus simples, mais aussi plus grossières
que chez les Petits-Kussieus, et bien éloignées d'ailleurs do toute exaltation
platonique.
L ' E g l i s e a étahli pour les nnions et le choix di
restrictions pi'ovenant de la parenté. L'oncle et la
éponx de grandes
ièce, le neveu et la
t a n t e , les cousins et cousines, leurs enfants même, n'ont pas la poi-mission
de se marier ensemble ; ces derniers seulement peuvent quelquefois
obtenir une dispense de l'arkhiréi (l'évéque). II y a plus : les doux frères,
dans une famille, ne |)euvent-pas épouser les denx soeurs d'une antre famille,
et même, ainsi qu'on l'a vu plus haut, les parrains et marraines
n'ont piis le droit d'éjionser leurs filleuls ni môme de se marier entre eux.
On trouve une preuve frappante de la grande influence qu'exerce la
parenté sur les rapports de la famille et de la société chez les Russes,
ainsi (lue de l'importance et du iirix qu
dans le grand nombre do dénomination
la parcjité même la plus éloignée. Le i
le nom de telist; à la mère de
: l'on attache aux liens du sang,
aft'ectées aux divers degrés de
lari donne au père de sa femme
sa femme, cehi
h. la soenr, ce
de tiochtclia I fri
de sa femme, celui de chonrine ; celui de svoîatclrcuitsa ; il
appelle l'époux de la soeur de sa femme svoïak; et l'épouse dn frère de
s a femme, ncviestha. Au regard de la femme, le père du mari se nomme
svekor, la mère du mari, svekrov ; le frère de celui-ci, déver; la soeur,
zalovka; l'époux do la soeur du mari, ziate : l'épouse du frf
neviestka on snakha. Ces dénominations affectueuses ne s';
là : la hru (femme du fils) se nomme neviestka; le gendre,
])arcnts de l'épouse nomment le père et la mère du mari stiia.
; du mari,
rétent pas
date. Les
•nfants
Les soeurs de l'épouse nomment ziate le mari de lei
helle-mère, c'est-ii-dire la seconde femme du père, est pour
du pi-emier lit une matchiklia; le beau-père, c'est-cVdii'O le second mari
de la mère, est nommé votcliim par les enfants du i)remier lit. T-c fils
d'un premier mariage est, pour le beau-père, un passynok, la tille, une
])adtcborilsa. Cousins et cousines se donnent le nom de frères et soenrs
au second degré; leurs enfants sont frères et soeui-s au troisième degré.
Le grand-père se nomme died, son frère, diédouclika. L'oncle s'appelle
diadia; la tante, tiotka; le neveu, plémiannik; la nièce, plérnianitsa.
;ettc parenté est nn vrai labyrinthe dans lequel beaiieiix
mémes ont de la peine ii se retrouver, mais qui
lent l'intimité des relations par lesquelles les parents
On voit qu.
coup de Russes
a t t e s t e positivem
sont unis entre <
Pour faire
demande en mariage, les pa
maison du futur ou de la proi
ntendi'e sur toutes les conditioi
t souvent précédée de ce que
m usage qui consiste h laisser
, maison des j}arcnts on ailleii
voient, dans
kha, afin de
de la svaklia
(revue) : c'est un
pi'omise dans la i
l'intermédiaire dei
consent à l'épouse
jeune fille. Si les
promis se rendent
père et la .
vous les parents de
principaux points du
kladka) que doit doi
ide au futur si la jeune ])crsor
le même jiréliininaire est obse:
? se conviennent, le p
és de leurs plus procln
(neviesta), oii se sont
A l o r s , après s'être m
p r o j e t é et sur le cado
1 fait
lies gen;
lompagn
de la pr
n a g e
le fiai
:òtés se tendent réciproquement mai
accomplies. Dans les classes inférieures du
nommées roukobitié (poignée de main), sgc
toast). ])ans les classes supérieures ot natui'i
cord entre lés parents est suivi de la cérémc
its des jeiiues gens eue
un svate et une sva-
L a visite du svate ou
in nomme les smotriny
: jeune homme voir la
après cette formalité,
lui plaît et s'il
à l'égard de la
; et la mère du
p a r e n t s , chez le
;si donné rendezd'accord
sur les
de noces (klaja,
p r i è r e , les parcnt.s des
, et les fiançaille-s sont
p i e , les fiançailles sont
(promesse) ou zapoï (le
lont plus civilisées, l'acle
des fiançailles,
célébrée p
(littéralement, I
avant ia noce,
le prêtre ; 1 moyen de I'.
la bague, ob;
(promesse), (
nie solen
îo do.s f
lénié, po
j fait sai
neaux de
lolvka), ]h:
i autre et
qu'une invitation aux parents et amis, et à l'occasion de laquelle on lixe
le jour oil la noce devra avoir lien. La klaja consiste, outre les vêtements
qui sont destinés à la pi'omise, en une ])etite somme d'argent
qu'elle dépense en cadeanx pour les parents de son promis. Viennent
ensuite certaines solennités dans lesquelles une table bien garnie joue
ordinairement un rùle très-important. Dans quckiues contrées, la nore
e.st précédée, chez les campagnards, d'une féte nonunée vinopitié (consommation
d'eau-de-vie), qui a beaucoup d'analogie avec le sgovor des
marchands, etc.- J.a promise échange alors un verre d'ean-de-vio avec
son futur beau-père, puis elle s'éloigne, et les parents du fiancé reçoivent
en cadean des essuie-mains, des mouchoirs, etc. Immédiatement
avant la conclusion du mariage, on célèbre ce que l'on nomme la devitchnik
(fête des filles, veille des noces); on y invite les piirents ot
amies de la fiancée; et iiarfois aussi les amis et parents du promis.
On chante, dans cette réunion, toutes sortes do chansons analogues à la
circonstance et dans lesquelles le nom du futur est souvent ré]iété : on
y prend en quelque sorte congé de la fiancée, qui va cesser de faire
p a r t i e de la société dos jeunes filles, etc. Il est d'usage, en cette occasion,
que la promise soit assise !\ la table entre deux flambeaux allumés ;
elle est tenne de manifester la plus profonde tristesse et de verser continuellement
des pleurs, assistée d'ailleurs dans cette tâche pénible par
une de ses compagnes que l'on nomme, en quelques endroits, la vylnitsa.
Cette jeune fille fait parfois des mouvements tout particuliers et assez
ridicules en balançant son corps de côté et d'autre , comme si elle
é t a i t près de chanceler. L'assistance se montre très-choquée si la tiancée
a le malheur de paraître un pen gaie et de ne pas savoir assez
bien cacher son bonheur. Devant elle est placée une a.ssiettc contenant
des noeuds de rubans roses ou rouges (la krassa, beauté, l'ornement de
la jeune fille vierge), que la promise distribue le lendemain , nn peu
avant la noce, à ses amies.
Pour assister le fiancé pendant la cérémonie, on lui choisit parmi
les jeunes gens de la noce nn drouchko (garçon d'honneur) et un aide
qu'on nomme paloudroujié. Les père et mère de chacun des jeunes
gens ne doivent pas être présents à la célébration du mariage, mais
ils sont repi'csentés par nu père et une mère choisis, possajonny otietz,
possajonnaïa matte. L'acte i-eligienx est accompagné de nombrenses
cérémonies ayant toutes un rapport allégorique avec l'avenii- et la destinée
des époux. Pendant que le prêtre prononce les paroles sacramentelles,
on tient des couronnes richement ornées suspendues sur ta
t ê t e des jeunes mariés ; cet usage se pratique cliez les pauvj'es anssi
bien que chez les riches. Avant le mariage, la fiancée a fait ses adieux
à ses parents au milieu de la tristesse et des larmes ; h son retour de
l'église, elle est reçue par eux avec le ])ain et le sel et bénie en face
de l'image sainte, qu'on a portée devant elle et qui sanctifiera désormais
la maison que le jeune couple habitera. On attache lu plus gramle
importance à la fête solennelle qui suit immédiatement l'acte religieux ;
les provisions de toute espèce doivent y paraître en abondance; les gens
môme les moins fortunés s'imposent souvent des pi'ivations dont l'eliet
se fait sentir encore longtemps après la noce, pour qu'elle soit splendide
et ne laisse rien ii désirer. A la ville, on déploie, en ces occasions,
nn lu.x.e remai'qnable, et les frais que l'on fait dans la classe niarcliande
dépassent toutes les bornes. Le nouveau marié danse ])i'e.s(iu('
continuellement avec sa jeune é|iouse, et chez les gens rlii peuple aucun
a u t r e invité n'osei'ait danser avec elle. J.orsquc les époux se retii'ent dn
bal, la toilette de nuit de la mariée est faite par des jennes fomme.s
de son intimité. Le lendemain do la noce, le jeune coiijile se rond chez
les parents et les amis, leur porte des bonbons et reçoit en échange
quelques cadeaux. A la campagne, le letidemaiu des noces est célélué
])ar nn repas nommé kniaje-obied (banquet ])rincicr) ou kaiavaïiiy, aiiqiiol
sont invités les purents de la femme et ceux du mari. Cos derniers
reçoivent, par l'intermédiaire do la svaklia, dos cadeaux auxquels ils
répondent en donnant à leur tour quelque somme d'argent au joiuie
ménage. La solennité du mariage est accom|iagnée, chez les paysans,
de pratiques superstitieuses et de toute sorte de coutuine.s et cérémonies
auxquelles ils attachent une grande importance, parce qu'elles .sont conlidérées
(
Les
dos pronostics he •nx po • l'a
mbreuses cérémonies i)resci-ite.s iiar le culte îi
iiiterremenls, et les usages qui les accompagnent, l'appelloiit d'i
P E U P L E S INDO-EUROPEENS. 39
d'im passé iliijà tròs-éloigiié. Lo,
time tombe gi-.avemeot mjilatle
mère f]'a|)]).nite les souvei
parent ou tuie cuiHiaissaiici ^ ^
, l'église et on y fait des piiÈres pour le rotalilissemeiit de sa santé.
S'il y
111
i r , en ajipolle le prêtre iiour administrer au mourant les
ints sacrements; si l'état du malade y mot obstacle, ou lit, ¡¡our supjer
aux sacrements, uue prière nommée odkliodnaïa (prière d'adieu).
Le coi'ps (in mort est lave, babillé, placé avec respect dans le cercueil;
le front est surmonté d'un large liapier rempli d'insci-iptions religieuses
et découpé en forme de diadème. Cbez les personnes ricljos, les céi'énionies
funèbres et la lectuj'o dos prières durent parfois sans inlerniption
jusqu'.'i l'enterrement; deux fois par jour, après les pi'ières du
malin et colles du soir, ou célèbre nn service funèbre (panikhida); tous
les assistants tieiuient en main des bougies allumées ot baisent Je front
e t ' l e s mains du mort. Le troisième jour, on procède à l'inbumation.
Les dernières cérémonies sont ti-ès-solennelles; on elianto los lij-mues
dos funérailles, on ferme ensuite le cercuoil et on le tr.msporte au cinmtière
sur nn char funèbre pompeusement orné, on suivant une route
qu'on a eu soin de jonelier de branches de sapin. Dans les vilLages, les
femmes, suivant l'antique usage religieusement conservé, accomp.ugneut
encore le moi't jusqu'à sa dernière demeure, avec des lamentations et
des sanglots, pendant que les hommes e.xprinicut Icnrs regrets et font
avec exallation l'éloge du défunt. Ceux qui ne suivent pas le cercueil
sortent tons de la maison mortuaii'o en même temps que le corps, et
en prcmicnt congé en récitant des prières et en faisant des signes de
crois. Toutes les personnes qui voient passer un enterrement ne manquent
jamais de se découvrir la téte et de se signer. Immédiatement après que
le corps a été l'ocouvert de tei-re, on se rend ii l'église du lieu de la
sépulture, lorsqu'il y on a une, et on y m.inge un certain mets nommé
iioutia (mélange de riz ou de grnau cuit avec du miel), que le piètre
bénit sur nn petit ]ilat ; puis on assiste au banquet mortuaire, souvent
fort splendide; ou bien, ce qui se pratique fréquemment chez les gens
du peuple, ou reste réunis sur la tombe, où l'on mange et où l'on boit,
dit-on, en mémoire du mort. Après l'enterrement, les panikhidas continuent
encore pendant quelque temps. Les gens riches font prier pour
le défunt durant quarante jours, cinoiqiiefois même deux et trois mois
après le décès; dans les couvents, où les cérémonies du culte ont lien sans
interruption, los prières continuent sonvent pendant une année entière.
Au neuvième, au vingtième et au quarantième jours écoulés depuis le
décès, l'ofSce des morts est répété avec toute sa solennité : il on est de
mémo à l'expiration des six mois, et de l'année h partir de cette même
date ; puis cela se renouvelle chaque année. le jour anniversaire de la
mort, et aussi aux différentes époques qui rappellent le souvenir du
défunt, telles que le jour de sa fête, de sa naissance, etc. Parmi les
classes inl'érienres de la population, ces eêrémonies commémoratives
qu'eu nomme pominki (souvenir), ont lieu au cimetière même, oii l'on'
mange et où l'on boit, comme au jour des funérailles.
La religion tient encore une |)lare très-importante dans plusieurs circonstances
de la vie des liasses : c'est ainsi qu'il l'occasion des incendies,
des inondations, des éiiidémies, des épizooties, de la séclieresso on de la
stérilité do la terre, etc., ou récitc des prières spéciales et l'on célèbre
un service |.artieulier (molobstvié, prière); il en est de mémo pour le
départ ou l'arrivée des troupes, pour des obstacles surmontés ou des calamités
dont on a triomphé. Dans ocs diverses circonstances, on adresse
au ciel dos actions de grâces, ou se rend on pèlcrin.age aux couvents ot
aux lieux consacrés ; on fait dos dons aux églises, aux monastères et
anx établissomeiits de bienfaisance. Kn toute chose, comme nous l'avons
répété déjà, l'élément religieux tient la plus grande place dans la vie
des Russes, qui s'bniuilient devant l'inlinio sagesse et la toute-puissance
do Ilio» ; ce sentiment se manifeste d'nno façon énergique et très-caracdans
le biiigage journalier du llusse et surtout dans echii de
térisée
lonime du peuple : le nom de Dieu (liogh) est iirononeé avec respect
. conviction dans toutes les occasions où le coeur est intéressé : ainsi
Ulisse ne manquera jamais de dire : .Dieu l'a doiinél Dieu l'a.
.sa miseri rde
cliiUil
pardoi
etc. . (l'est 1
Dieu est irrité! Die
rité do cauir qu'il dit eucorc
Le christianisme, expliqué d'après les, dogmes et le rite byzantin, ouv
r i t un nouveau monde aux peuples slaves de l'est et leur donna en
quelque sorte une nouvelle existence en fécondant les germes de leur
nature inculte mais noble, sans altérer eu rien leurs forces naturelles. La
religion grecque apporta beaucoup aux Russes et ne leur ota rieu. Ou
peut en dire autant, mais dans une mesure restreinte, do l'Uglise russe
actuelle, tille de l'Eglise grecque : cette lOglise russe est en effet la vivante
expression de-la fusion de l'Eglise grecque avec la nationalité russe.
Si, avec beaucoup do piété et de foi, avec une obéissance absolue ii toutes
les prescriptions du culte, la majorité des Busses ne possède qu'à un
faible degré la connaissance des dogmes, le peuple n'y trouve pas moins
le principe vital de cotte grande unité religieuse et nationale dont les
hautes classes, avec leur éducation tout européenne, ne se sont jamais
départies. Malgré uue certaine frivolité do sentiments et pcnt-étre mémo,
chez quelques personnes, une légèreté répréhensible, jamiiis, on lliissic,
personne ne se détachera de l'Eglise, dont les pratiques sont en opposition
trancliée avcc les idées des cla.sses civilisées des peuples de l'Occ
i d e n t ; personne n'aura la pensée de se soustraire ii l'observation dos
cérémonies extérieures ou d'affecter du mépris pour elles. De fait, et à
bon droit, l'Eglise russe est à la tête de tout l'Orient chrétien. L'emper
e u r est le chef de l'Eglise russe, mais à un tout autre titre et dans
une tout autre acception que le pape considéré comme cliof de l'Eglise
romaine. Le tsar nomme, il est vr.ai, aux emplois occlésiastiques les |ilus
élevés, et n'a limité sou pouvoir sous ce rapport qu'on abandonnant au
saint synode, aux évêques, le droit de proposition des sujets dignes de
remplir les charges vacantes. L'empereur peut aussi faire passer un
évéqne d'un siège îi nn autre ; mais il ne s'est jamais arrogé le droit
de prononcer sur le dogme ni de décider des questions purement tliéoiogiquos.
1 / b i s t o i r e de l'Eglise russe présente, dans ses rapports extérieurs avec
s a mère spirituelle l'Eglise grecque ou catholique orientale, trois périodes
successives.
Dans la première, qu'on peut appeler période grecque ou byzantine
(98S-1240), l'Eglise russe se tronvait dans la dépendance absolue du
p a t r i a r c h e do Oonstautinoplo et formait l'une des métropoles qui lui
étaient soumises. Le patriarclie, avec le comité qui l'assistait, nommait,
sans aucune participation des princes ou des évêcpies, un métropolitain
pour la Eiissio, lequel était presque toujours pris exclusivement dans la
hiérarchie grecque; c'est par riutermédiaire de ce métropolitain que le
p a t r i a r c h e de Constantinople administrait l'Eglise russe. Durant toute
cette période d'environ deux cent cinquante ans. Il ne se présenta que
deux circonstances oil le métropolitain fut élu par le grand-duc : la
première fois sons le règne d'Yiiroslav, puis sous celui d'isiaslav.
Dans la seconde période dite gréco-russe 11.10-1589, l'Eglise russe
passa par une transition doucement ménagée d'une dépendance entière
il une indépendance absolue. Le pouvoir du patriarche de Oonstantlnoplo
s'atfaibllt pen h peu à compter du jour oii — le métropolitain en fonction
ayant été dépossédé de son siège il la suite des invasions mongoles et de
la destruction de Kiev — le célèbre prince Daniel de llalltcb choisit
un métropolitain dans la hiérarchie russe et appela l'évéque Cyrille fl
il cette haute dignité. Ce choix fut pour la première fols eouliriné par
le patriarche. Cette période se divise en denx paitlcs. Durant la première
(de Cyrille il Yona, 1243-1448), le patriarclic abandonna à l'Eglise
russe on an grand-duc de Russie le droit d'élire un métropolitain sorti
de la hiérarchie russe ; mais cotte eondescendauce ne fut que momentanée.
Une fois soiiiomont, sons Vltovt (1410), le métropolitain fut élu
dans la hiérarchie Iltlinaiiienne russe, sans ie cousenteinent dn pat
r i a r c l i c , dont l'autorité prépondérante dlmluuii considérablement, mais
subsista néanmoins. Pendant la seconde partie de cette période (d'Yona
il Vov, 1448- 1589), le patriarche de Gonstantlno|ilo abandonna nonseulement
il l'Eglise russe, aiors déjil divisée en doux métropoles, Ivlei'
e t Moscou, le droit d'élection, mais encoi-e la prérogative permanente,
du moins quant à l'Eglise de Moscou, de coiiliri
1 pou , Rui
le métropolitai
Dans la métropole occidentale, le patriarclic
ait plus, il est vrai, dans le elle étropolltai il arri
vait souvent que ce dignitai
de lelques toiitcfol
.•oyé lï Constantinople po
élu souleniont par nu concilo composé
ivec l'assentiment du patriarche, était
•ecevoir La bénédiction de sou chef spi