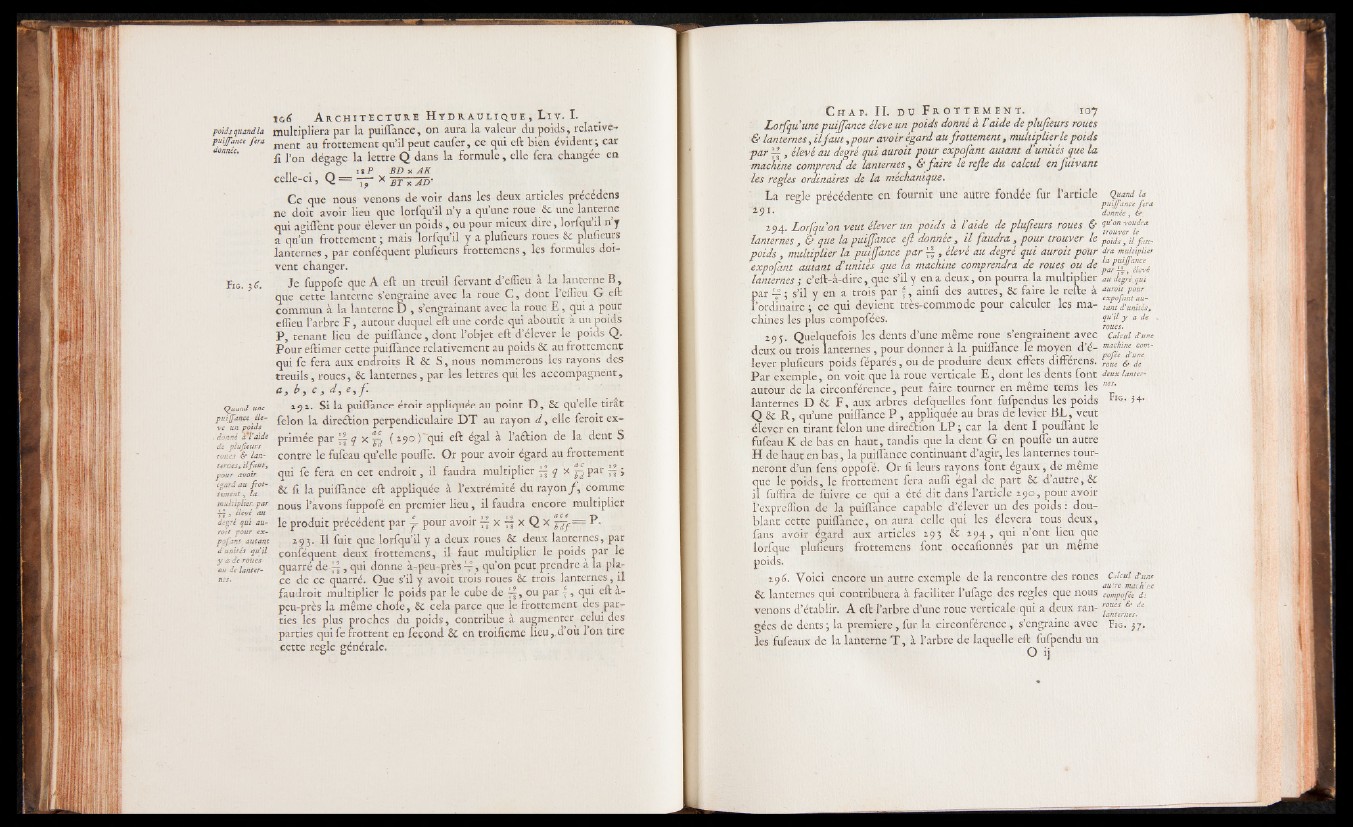
p o id s q u a n d la
p u ijfa n c e fe r a
donnée.
Fig. 56.
Q u a n d une
p u ijfa n c e élev
é u n p o id s
. d on né a V a id e
d e p lu fie u r s
rou es & la n tern
es3 i l f a u t ,
p o u r a v o ir
égard a u fr o t tem
e n t , la .
m u ltiplie r, p a r
, élevé a u
degré q u i a u -
r o it p o u r e x -
p p fa n t a u ta n t
d u n ité s q u 'il
y a d e ro u e s
ou de la n te rnes
»
ïo « A rchitecture H ydr a u l i q u e , L i v . I.
multipliera par la puiffance, on aura la valeur du poids , relativement
au frottement qu’il peut caufer, ce qui eft bien évident ; car
fi l’on dégage la lettre Q dans la formule, elle fera changée en
„ . „ H P S D x A K celle-ci, O = -— x aT „
Ce que nous venons de voir dans les deux articles precedens
ne doit avoir lieu que lorfqu’il n y a quune roue 6c une lanterne
qui agifïènt pour élever un poids, ou pour mieux dire, lorfqu il n y
a qu’un frottement ; mais lorfqu’il y a plufieurs roues 8c plufieurs
lanternes, par conféquent plufieurs frottemens, les formules doivent
changer.
Je fuppofe que A eft un treuil fervant d’effieu à la lanterne B ,
que cette lanterne s’engraine avec la roue C , dont l’effieu G eft
commun à la lanterne D , s’engrainant avec la roue E , qui a pour
eflîeu l’arbre F , autour duquel eft une cordé qui aboutit a un poids
P , tenant lieu de puifîance, dont l’objet eft d’élever le poids Q.
Pour eftimer cette puifîance relativement au poids ôc au frottement
qui fe fera aux endroits R ôt S , nous nommerons les rayons des
treuils , roues, 8c lanternes, par les lettres qui les accompagnent,
(l y b y C y d y C y f i
z y i. Si la puiffance étoit appliquée au point D , St qu’elle tirât
félon la direction perpendiculaire D T au rayon d , elle feroit exprimée
par tf ? x ( 29 ° )~qui eft égal à l’aétion de la dent S
contre le fufeau qu’elle poulie. Or pour avoir égard au frottement
qui fe fera en cet endroit, il faudra multiplier -j-j- q x p p a r 75 >
& fi la puifîance eft appliquée à l’extrémité du rayon f , comme
nous l’avons fuppofe en premier lieu, il faudra encore multiplier
le produit précédent par 4 - pour avoir tj x 75 x Q x j jp — P-
193. I l fuit que lorfqu’il y a deux roues 8t deux lanternes, par
conféquent deux frottemens, il faut multiplier le poids par le
quarré de f| , qui donne à-peu-près^, qu’on peut prendre a la place
de ce quarré. Oue s’il y avoit trois roues ôc trois lanternes, il
faudrait multiplier le poids par le cube de f i , ou par { , qui eft a-
peu-près la même chofe, 8c cela parce que le frottement des parties
les plus proches du poids, contribue à augmenter celui des
parties qui fe frottent en fécond 8t en troifieme neu,.d’ou 1 on tire
cette réglé générale.
C h a p . I L d u F r o t t e m e n t . 107
Lorfqu une puijfance éleve un poids donné à la id e de plufieurs roues
& lanternes, ilfa u t ,pour avoir égard au frottement, multiplier le poids
p a r f j , élevé au degré qui auroit pour expofant autant d ’unités que la
machine comprend de lanternes y & fa ire lerejle du calcul enfuivant
les réglés ordinaires de la méchanique.
La réglé précédente en fournit une autre fondée fur l’article Quand u
o t p u ijfa n c e fe r a
donnée, 6*
294- Lorfqu on veut étever un poids à l’aide de plufieurs roues &
lanternes, & que la puijfance e jl donnée, i l faudra , pour trouver le poids"U fau-
p oid s, multiplier la puijfance par | | , élevé au degré qui auroit pour dru multiplier
expofant autant d ’unités que la machine comprendra de roues ou de p jg ftk v é
lanternes -, c’eft-à-dire, que s’il y en a deux, on pourra la multiplier au degré, qui
t>ar — : s’il v en a trois par f , ainfi des autres, ôc faire le refte à auroit pour
l ’ordinaire; ce qui devient tres-commode pour calculer les ma- tantdiumüs.
chines les plus compofées. !u'il y a de
l - rou es.
295. Quelquefois les dents d’une meme roue s’engrainent avec Calcul dune
deux ou trois lanternes, pour donner à la puiffance le moyen d’é-
lever plufieurs poids féparés, ou de produire deux effets différens. pmJ & J
Par exemple, on voit que la roue verticale E , dont les dents font deuxUnter-
autour de la circonférence, peut faire tourner en même tems les
lanternes D ôc F , aux arbres defquelles font fufpendus les poids Fig- 14'
Q ôc R , qu’une puiffance P , appliquée au bras de levier B L , veut
élever en tirant Ici on une direction L P ; car la dent I pouffant le
fufeau K de bas en haut, tandis que la dent G en pouffe un autre
H de haut en bas, la puiffance continuant d’agir, les lanternes tourneront
d’un fens oppofé. Or fi leurs rayons font égaux, de même
que le poids, le frottement fera aufli égal de part 8c d’autre, ôc
il fuffira de fuivre ce qui a été dit dans l’article 2.90, pour avoir
l’expreffion de la puiffance capable d’élever un des poids : doublant
cette puifîance, on aura celle qui les élevera tous deux,
fans avoir égard aux articles 193 ôc 194 , qui n’ont lieu ^que
lorfque plufieurs frottemens font occafionnés par un même
poids.
2.9 6. Voici encore un autre exemple de la rencontre des roues Calcul dune
ôc lanternes qui contribuera à faciliter l’ufage des réglés que nous compofée d:
venons d’établir. A eft l’arbre d’une roue Verticale qui a deux ran-
gées de dents; la première, fur la circonférence, s’engraine avec F ig . 3 7 .
les fufeaux de la lanterne T , à l’arbre de laquelle eft fufpendu un
O ij