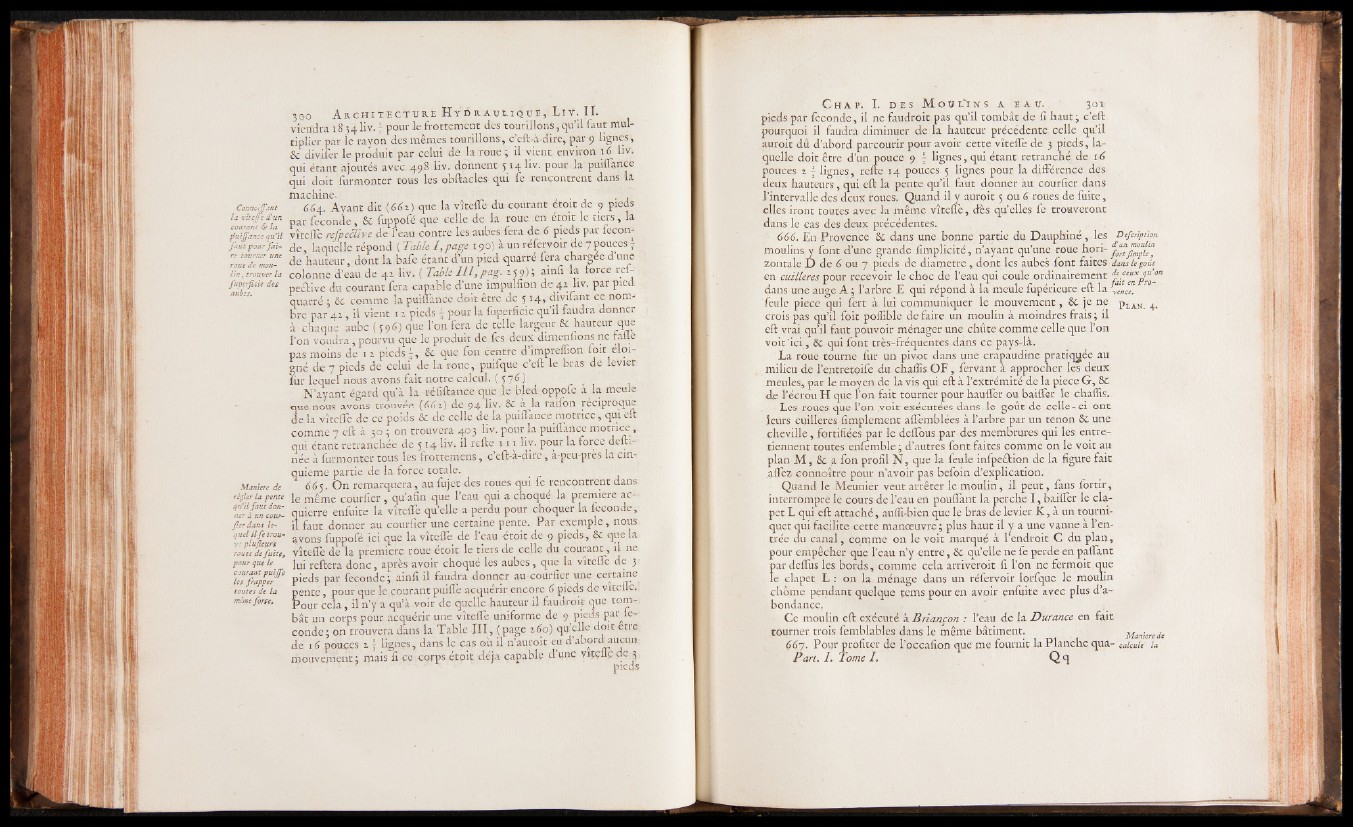
Connoijfant.
la vîteJJ'e d'un
courant & la
puiffance qu'il
faut pour faire
tourner une
roue de moulin
, trouver la
fuperfieie des
aubes.
Maniéré de
régler la pente
qu'il faut donner
à un cour-
f e r dans lequel
il fe trouve
plufieurs
roues de fuite,
pour que le
courant puiffe
les frapper
toutes de la
mm forge»
3§o A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . II.
viendra 1834 liv. J pour le frottement des tourillons, qu’il faut multiplier
par le rayon des mêmes tourillons, c’eft-à-dire, par 9 lignes,
& divifer le produit par celui de la roue ; il vient environ 16 liv.
qui étant ajoutés avec 498 liv. donnent 5 14 liv. pour la puiffance
qui doit furmonter tous les obftacles qui fe rencontrent dans la
machine, . ,
664. Ayant dit (661) que la vîteffe du courant etoit de 9 pieds
par fécondé, & fuppofé que celle de la roue en étoit le tiers, la
vîteffe refpeclive de l’eau contre les aubes fera de 6 pieds par fécondé,
laquelle répond ( Table 1, page 190) aunrefervoir de 7 pouces y
de hauteur, dont la bafe étant d’un pied quarre fera chargée d une
colonne d’eau de 4 1 liv. ( Table I I I , pag. 159 ) ; ainfi la force rel-
pective du courant fera capable d’une impulfion de 4 1 liv, par pied
quarté ; 8c comme la puiffance doit être de 5 14 , divifant ce nom-
bre par 42 5 il vient 12 pieds pour la fuperfieie qu il faudra donner
à chaque aube ( 596) que l’on fera de telle largeur & hauteur que
l ’on voudra, pourvu que le produit de fes deux dimenfîons ne faffè
pas moins de 1 1 pieds ; , - & que fon centre d’impreffion foit éloigné
de 7 pieds de celui de la roue, puifque c’eft le bras de levier
fur lequel nous avons fait notre calcul. ( 576) . â
N’ayant egard qu’a la r-efifcance que ,1e bled oppole a la meulô
que nous avons trouvée (66 z) de 94 liv. & a la raifbn réciproque
de la vîteffe de ce poids cC de celle de la puiflance motlice, qui eft
comme 7 eft à 30 ; on trouvera 403 liv, pour la puiffance motrice,
qui étant retranchée de 5 14 liv. il refte 1 1 1 liv. pour la force defti-
née à furmonter tous les frottemens, c’eft-à-dire, à-peu-pres la cinquième
partie de la force totale.
ddj, On remarquera, au fujet des roues qui fe rencontrent dans
le même courfier, qu’afin que leau qui a choque la première ac-
quierre enfuite la vîteffe qu’elle a perdu pour choquer la fécondé,
il faut donner au courfier une certaine pente. Par exemple, nous
avons fuppofé ici que la vîteffe de 1 eau etoit de 9 pieds, fié que la
yîteffe de la première roue étoit le tiers de celle du coulant, il ne
lui reliera donc, après avoir choqué les aubes, que la vîteffe de 3 -
pieds par fécondé ; ainff il faudra donner au courfier une certaine
pente, pour que le pourant puiffe acquérir encore 6 pieds de vîteffe,
Pour cela, il n’y a qu'à voir de quelle hauteur il faudroit que tombât
un corps pour acquérir une vîteffe uniforme de 9 pieds parafe,-
conde; on trouvera d'ans la Table I I I , (page z6o) qu’elle doit etre
de 16 pouces z } lignes, dans le cas où il 11’auroit eu d’abord, aucun
mouvement; mais fi çe corps étoit déjà capable d’une yitçlip de 3
pieds
C h a p . I. d i s , M o s l î n s a e a u . 301'
pieds par fécondé, il ne faudroit pas qu’il tombât de fi haut ; c’eft
pourquoi il faudra diminuer de la hauteur précédente celle qu’il
auroit dû d’abord parcourir pour avoir cette vîteffe de 3 pieds, laquelle
doit être d’un pouce 9 { lignes, qui étant retranché de 16
pouces 1 j lignes, relie 14 pouces 5 lignes pour la différence des
deux hauteurs, qui eft la pente qu’il faut donner au courfier dans
l ’intervalle des deux roues. Quand il y auroit 5 ou d roues de fuite,
elles iront toutes avec la même vîteffe, d'ès qu’elles fe trouveront
dans le cas des deux précédentes.
666. En Provence Sc dans une bonne partie du Dauphiné, les Defcnptwn
moulins y font d’une grande fimplicité, n’ayant qu’une roue hori-
zontale D de 6 ou 7 pieds de diamètre, dont les aubes font faites dansUgoûc
en cuillères pour recevoir le choc de l’eau qui coule ordinairement
dans une auge A ; l’arbre E qui répond à la meule fupérieure eft la
feule pièce qui fert à lui communiquer le mouvement, 8c je ne p1AN 4.
crois pas qu’il foit poiîible défaire un moulin à moindres frais; il
eft vrai qu’il faut pouvoir ménager une chute comme celle que l’on
v oit'ic i, & qui font très-fréquentes dans ce pays-là.
La roue tourne fur un pivot dans une crapaudine pratiquée au
milieu de l’entretoifc du chalîîs O F , fervant à approcher les deux
meules, par le moyen de la vis qui eft à l’extrémité de la piece G , 8c
de l’écrou H que l’on fait tourner pour hauffer ou baiffsr le chaffis..
Les roues que l’on .voit exécutées dans le goût de celle-ci ont
leurs cuillères Amplement affèmblées à l’arbre par un tenon 8c une
cheville, fortifiées par le deffous par des membrures qui les entretiennent
toutes enfemble; d’autres lont faites comme on le voit au
plan M , & a fon profil N , que la feule infpe&ion de la figure fait
aflèz connoître pour n’avoir pas befoin d’explication.
Quand le Meunier veut arrêter le moulin, il peut, fans fortir,
interrompre le cours de l’eau en pouffant la perche I , bailler le clapet
L qui eft attaché, aulîi-bien que le bras de levier K , à un tourniquet
qui facilite cette manoeuvre ; plus haut il y a une vanne à l’entrée
du canal, comme on le voit marqué à l’endroit C du plan,
pour empêcher que l’eau n’y entre, & qu’elle ne fe perde en paffant
par deflùs les bords, comme cela arriveroit fi l’on ne fermoit que
le clapet L : on la ménage dans un réfervoir lorfque le moulin
chôme pendant quelque rems pour en avoir çnfuite avec plus d’abondance,
Ce moulin eft exécuté à Briançon : l'eau de la Durance en fait
tourner trois femblables dans le même bâtiment. Manierede
66j. Pour profiter du l’pccafion que' me fournit la Planche qua- calcule la
Part. I. Tome I, Q q