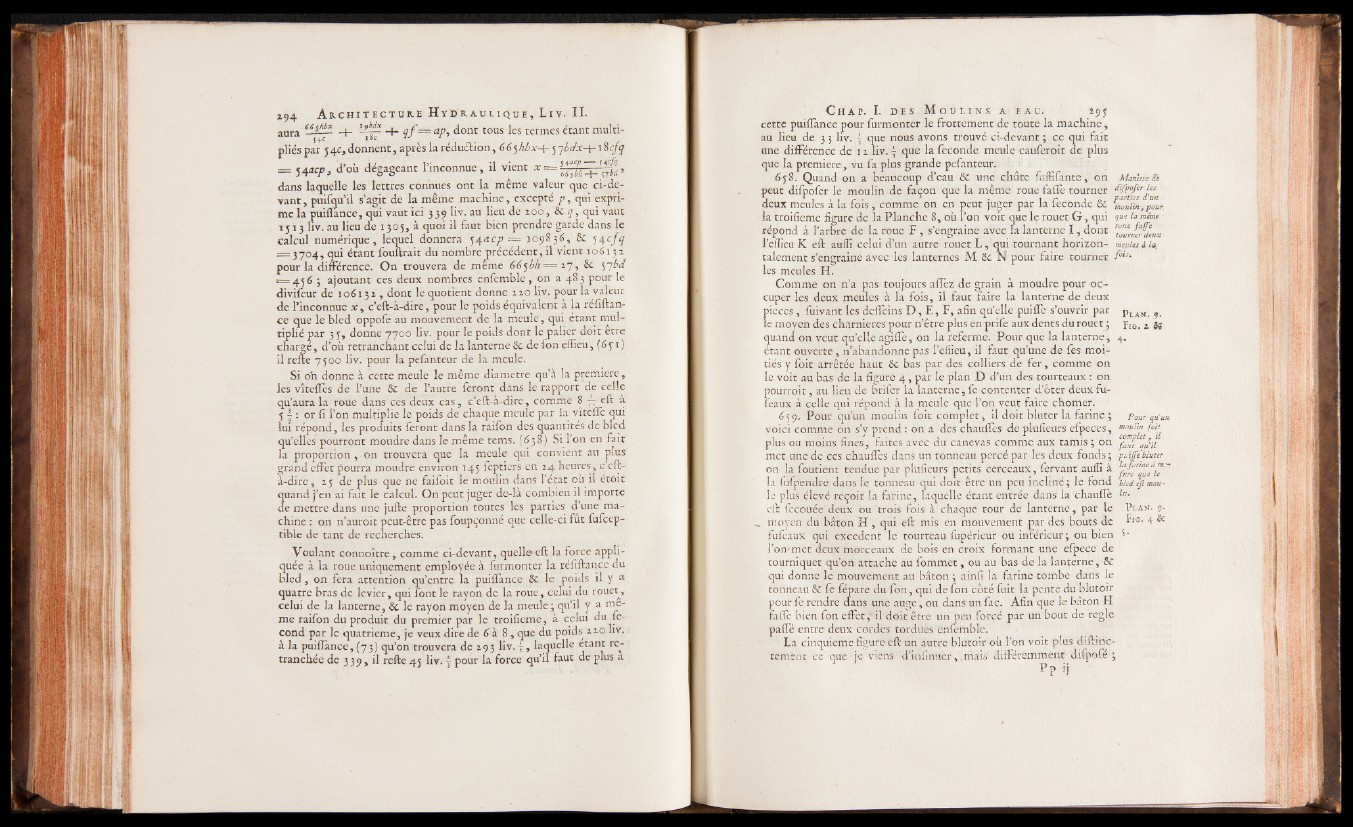
19 4 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . I I .
aura i_6ihbl _f_ q f = a p , dont tous les termes étant multipliés
par J 4c, donnent, après la réduction ,6 65 hbx-i- 5 -]bdx-\- lic jq
= j4dc/>, d’où dégageant l’inconnue, il vient * == ,
dans laquelle les lettres connues ont la même valeur que ci-devant
, puilqu’il s’agit de la même machine, excepté p , qui exprime
la puillance, qui vaut ici 339 liv. au lieu de 10 6 , q , qui vaut
1 5 1 3 liv. au lieu de 1305 , à quoi il faut bien prendre garde dans le
calcul numérique, lequel donnera 54(1 cp = ? 109836, 8c 54cfq
= 3704, qui étant fouftrait du nombre précédent, il vient 10613 a
pour la différence. On trouvera de même 6 6 $ b k = t 7 , & 57^
£ = 4 5 6 ; ajoutant ces deux nombres enfemble, on a 48 3 pour le
divifeur de 1 0 6 1 3 1 , dont le quotient donne 220 liv. pour la valeur
de l’inconnue x , c’eft-à-dire, pour le poids équivalent à la réfiftan-
ce que le bled oppofe au mouvement de la meule, qui étant multiplié
par 3 5, donne 7700 liv. pour le poids dont le palier doit etre
chargé, d’où retranchant celui de la lanterne 8c de fon eiiîeu, (<671 )
il refte 7500 liv. pour la pefanteur de la meule.
Si oh donne à cette meule le même diamètre qu’à la première,
les vîtefles de l’une 8c de l’autre feront dans le rapport de celle
qu’aura la roue dans ces deux cas, c’eft-à-dire, comme 8 -77 eft a
j | : or fi l’on multiplie le poids de chaque meule par la vîteflè qui
lui répond, les produits feront dans la raifon des quantités de bled
qu’elles pourront moudre dans le même tems. (638) Si l’on en fait
la proportion , on trouvera que la meule qui convient au plus
grand effet pourra moudre environ 145 feptiers en 24 heures, c eft-
a-dire, 25 de plus que ne faifoit le moulin dans l’état ou il etoit
quand j’en ai fait le calcul. On peut juger de-là combien il importe
de mettre dans une jufte proportion toutes les parties d’une machine
: on n’auroit peut-être pas foupçonné que celle-ci fut fufcep-
tible de tant de recherches.
Voulant connoître, comme ci-devant, quelle-eft la force appliquée
à la roue uniquement employée à furmonter la réfiftance du
b led, on fera attention qu’entre la puillance 8c le poids il y a
quatre bras de levier, qui font le rayon de la roue, celui du rouet,
celui de la lanterne, 8c le rayon moyen de la meule; qu’il y a meme
raifon du produit du premier par le troilieme, à celui du fécond
par le quatrième, je veux dire de 6 à 8 , que du poids 220 liv.
à la puilîànce, (73) qu’on trouvera de 293 liv. 7 , laquelle étant retranchée
de 3 39 , il refte 45 liv. 7 pour la force qu’il faut de plus a
C h a p . I. de s M o u l i n s a e a u . 195
cette puiffance pour furmonter le frottement de toute la machine,
au lieu de 3 3 liv. 7 que nous avons trouvé ci-devant ; ce qui fait
une différence de 12 liv. p que la fécondé meule cauferoit de plus
que la première., vu fa plus grande pefanteur.
658. Quand on a beaucoup d’eau 8c une chute fuffifante, on M a m m i e
peut difpofer le moulin de façon que la même roue fafle tourner
deux meules à la fois, comme on en peut juger par la fécondé 8c ^ Z u rm ,p o u .r
la troilieme figure de la Planche 8, où l’on voit que le rouet G , qui 1“ même
répond à l’arbre de la roue F , s’engraine avec la lanterne I , dont
l’eflîeu K eft auffi celui d’un autre rouet L , qui tournant horizon- meules à l*
talement s’engraine avec les lanternes M 8c N pour faire tourner
les meules H.
Comme on n’a pas toujours affez de grain à moudre pour occuper
les deux meules à la fois, il faut faire la lanterne de deux
pièce? , fuivant les deffeins D , E , F , afin qu’elle puiffe s’ouvrir par pLAN «
le moyen des charnières pour n’être plus en prife aux dents du rouet ; F i a . 2 î ï
quand on veut quelle agiffe, on la referme. Pour que la lanterne, 4.
étant ouverte, n’abandonne pas l’effieu, il faut qu’une de fes moitiés
y foit arrêtée haut 8c bas par des colliers de fe r , comme on
le voit au bas de la figure 4 , par le plan D d’un des tourteaux : on
pourroit, au lieu de brifcr la lanterne, l'e contenter d’ôter deux fu-
feaux à celle qui répond à la meule que l’on veut faire chômer.
659. Pour qu’un moulin foit complet, il doit bluter la farine ; pour qU’UH
voici comme on s’y prend: on a des chauffes de plufieurs efpeces, moulin /oie
, . « I 1 plus ou moins fines, Vfa i• tes avec d1 u canevas comm1 e aux tami• s ; on mc ojmMv lneUt3'u i l
met une de ces chauffes dans un tonneau percé par les deux fonds ; puijfi Muter
on la foutient tendue par plufieurs petits cerceaux, fervant auffi à '
la fufpendre dans le tonneau qui doit être un peu incliné; le fond bled ejl mou-
le plus élevé reçoit la farine, laquelle étant entrée dans la chauffé l“-
eft fecouée deux ou trois fois à chaque tour de lanterne, par le P i a n . 9.
_ moyen du bâton H , qui eft mis en mouvement par des bouts de ^ia- 4 &
fufeaux qui excédent le tourteau fupérieur ou inférieur; ou bien s‘
l’on-met deux morceaux de bois en croix formant une efpece de
tourniquet qu’on attache au fommet, ou au bas de la lanterne, 8c
qui donne le mouvement au bâton ; ainfi la farine tombe dans le
tonneau 8c fe fépare du fon, qui de fon côté fuit la pente du olutoir
pour fe rendre dans une auge, ou dans un fac. Afin que le bâton H
faffe bien fon effet; il doit être un peu forcé par un bout de réglé
paffé entre deux cordes tordues enfemble.
La cinquième figure eft un autre blutoir où l’on voit plus diftinc-
tement ce que je viens d’iniînuer, .mais différemment difpofé ;
P p ij