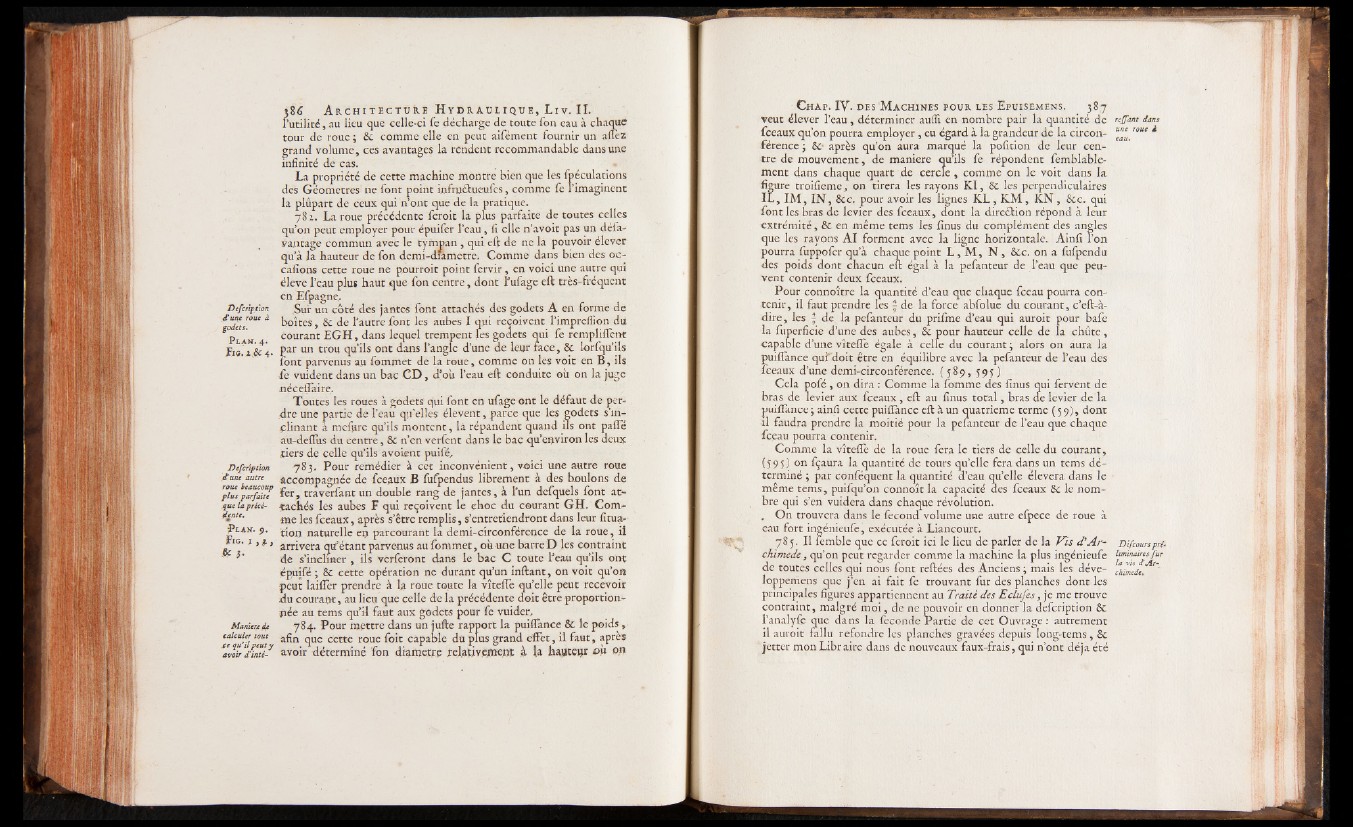
Defcriptlon
dune roue à
godets.
Plan. 4.
E1S.2&4.
Dcfcription
.dune' autre
roue beaucoup
plus parfaite
.que la précédente.
Plan. 9.
É lG . J , f . ,
6ç }.
Manière de
calculer tout
fe qu'il peut y
avoir (Tinté-
386 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . I I .
l’utilité, au lieu que celle-ci fe décharge de toute fon eau à chaque
tour de roue ; 8c comme elle en peut aifément fournir un allez
grand volume, ces avantages la rendent recommandable dans une
infinité de cas.
La propriété de cette machine montre bien que les fpéculations
des Géomètres ne font point infruéfueufes, comme fe l’imaginent
la plupart de ceux qui n’ont que de la pratique.
782. La roue précédente feroit la plus parfaite de toutes celles
qu’on peut employer pour épuifer l’eau, fi elle n’avoit pas un défa-
yantage commun avec le tympan, qui eft de ne la pouvoir élever
qu’à la hauteur de fon demi-dfâmetre, Comme dans bien des oc-
cafions cette roue ne pourrait point fervir, en voici une autre qui
élevel’eau plus haut que fon centre, dont l’ufage eft très-fréquent
en Efpagne.
Sur un côté des jantes font attachés des godets A en forme de
boîtes, & de l’autre font les aubes I qui reçoivent l’impreffion du
courant E G H , dans lequel trempent les godets qui fe rempliflènt
par un trou qu’ils ont dans l’angle d’une de leur race, 8c lorfqu’ils
font parvenus au fommet de la roue, comme on les voit en B , ils
fe vuident dans un baç C D , d’où l’eau eft conduite où on la juge
néceflàire.
Toutes les roues à godets qui font en ufage ont le défaut de perdre
une partie de l’eau qu elles élevent, parce que les godets s’inclinant
à mefitre qu’ils montent, là répandent quand ils ont pafle
au-deflùs du centre, 8c n’en verfent dans le baç qu’environ les deux
tiers de celle qu’ils avoient puifé.
783. Pour remédier à cet inconvénient, voici une autre roue
accompagnée de fceaux B fufpendus librement à des houlons de
fe r , traverfant un double rang de jantes, à l’un defquels font attachés
les aubes F qui reçoivent le choc du courant GH. Comme
les fceaux, après s’être remplis, s’entretiendront dans leur fitua-
tion naturelle et) parcourant la demi-circonférence de la roue, il
arrivera qu’étant parvenus au fommet, où une barre D les contraint
de s’incliner , ils verferont dans le bac C toute l’eau qu’ils ont
épuifé ; 8c cette opération ne durant qu’un inftant, on voit qu’oa
peut laiflèr prendre à la roue toute la vîteflè qu’elle peut recevoir
du courant, au lieu que celle de la précédente doit être proportionnée
au tems qu’il faut aux godets pour fe vuidcr.
784. Pour mettre dans un Julie rapport la puiflance 8c le poids,
afin que cette roue foit capable du plus grand effet, il faut, après
avoir déterminé fon diamètre relativement à la hauteur où o.n
C hap. IV. des M achines pour les E puisemens. 387
veut élever l’eau, déterminer auffi en nombre pair la quantité de
fceaux qu’on pourra employer, eu égard à la grandeur de la circonférence
; 8c- après qu’on aura marqué la pofition de leur centre
de mouvement, de maniéré qu’ils fe répondent femblable-
ment dans chaque quart de cercle , comme on le voit dans la
figure troifieme, on tirera les rayons K l , 8c les perpendiculaires
I L , IM , IN , 8cc. pour avoir les lignes K L , K M , K N , 8cc. qui
font les bras de levier des fceaux, dont la direction répond à leur
extrémité, 8c en même tems les finus du complément des angles
que les rayons A I forment avec la ligne horizontale. Ainfi l’on
pourra fuppofer qu’à chaque point L , M , N , 8cc. on a fufpendu
des poids dont chacun eft égal à la pefanteur de l’eau que peuvent
contenir deux fceaux.
Pour connoître la quantité d’eau que chaque fceau pourra contenir
, il faut prendre les £ de la force abfolue du courant, c’eft-à-
dire, les ~ de la pefanteur du prifme d’eau qui auroit pour bafe
la fuperficie d’une des aubes, 8c pour hauteur celle de la chute,
capable d’une vîteflè égale à celle du courant ; alors on aura la
puiflance quf'doit être en équilibre avec la pefanteur de l’eau des
fceaux d’une demi-circonférence. (58 9 , 595)
Cela pofé, on dira : Comme la fomme des finus qui fervent de
bras de levier aux fceaux, eft au finus to ta l, bras de levier de la
puiflance ; ainfi cette puiflance eft à un quatrième terme (59), dont
il faudra prendre la moitié pour la pefanteur de l’eau que chaque
fceau pourra contenir.
Comme la vîteflè de la roue fera le tiers de celle du courant,
(595) on fçaura la quantité de tours quelle fera dans un tems déterminé
; par conféquent la quantité d’eau qu’elle élevera dans le
même tems, puifqu’on connoît la capacité des fceaux 8c le nombre
qui s’en vuidera dans chaque révolution.
. On trouvera dans le fécond volume une autre efpece de roue à
eau fort ingénieufe, exécutée à Liancourt.
785. Il lémble que ce feroit ici le lieu de parler de la Vis d 'A rchimède
, qu’on peut regarder comme la machine la plus ingénieufe
de toutes celles qui nous font reliées des Anciens ; mais les déve-
loppemens que j ’en ai fait fe trouvant fur des planches dont les
principales figures appartiennent au Traite des Eclufes, je me trouve
contraint, malgré moi, de ne pouvoir en donner la defeription 8c
l’analyfe que dans la féconde Partie de cet Ouvrage : autrement
il auroit fallu refondre les planches gravées depuis long-tems, 8c
jetter mon Libr aire dans de nouveaux faux-frais, qui n’ont déjà été
rejfant dans
une roue à
eau.
D ifcou r s pré«
liminaires f u r
la vis T A r chimède,