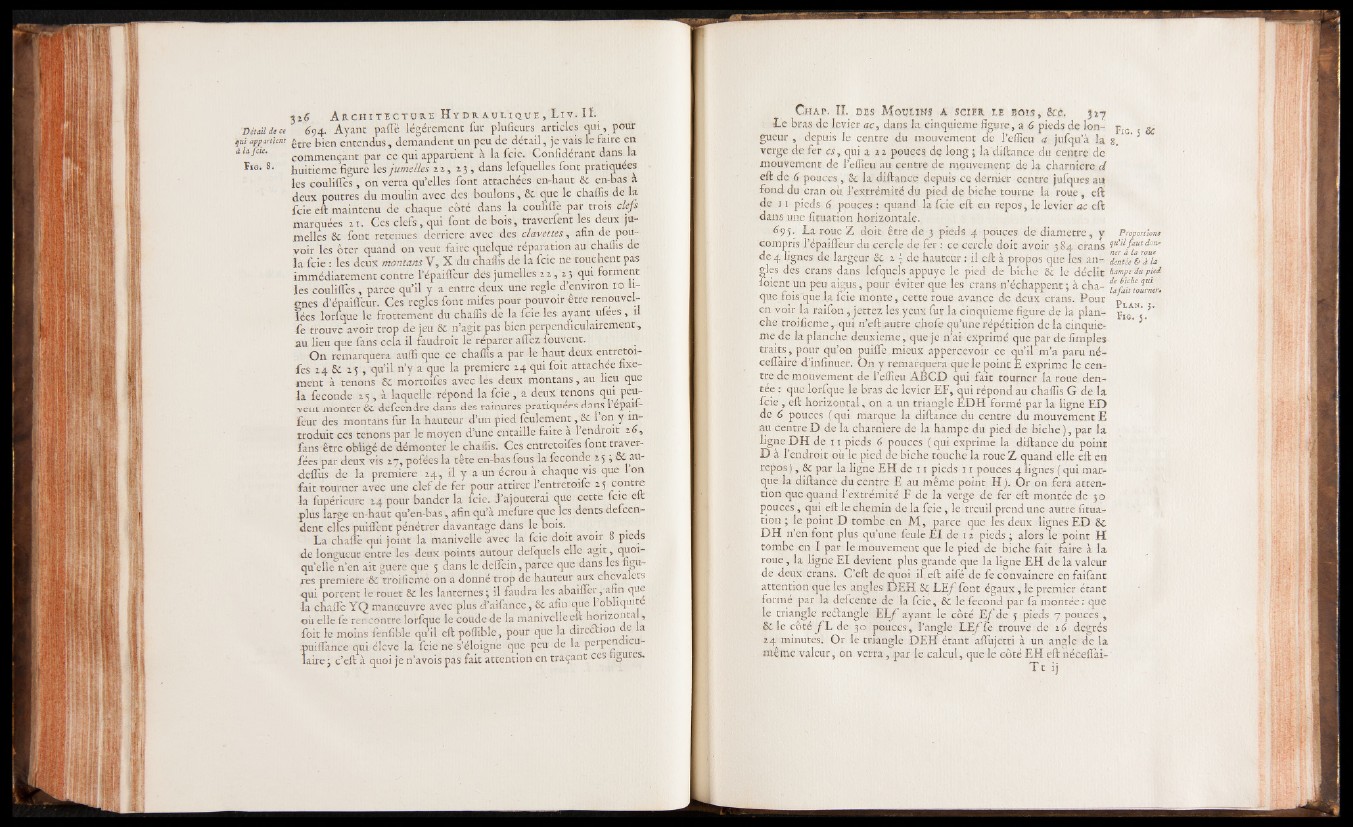
Fig. 8.
3 16 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . IL
'Détail de ce 694. Ayant pafle légèrement fur plufieurs articles qui , pour
fui appartUnt £tre y en entendus, demandent un peu de détail, je vais le faire en
iUJ cu- commençant par ce qui appartient à la fcie. Confidérant dans la
huitième figure les jumelles 2 2 , 1 3 , dans lefquelles font pratiquées
les codifies , on verra qu’elles font attachées en-haut 8c en-bas a
deux poutres du moulin avec des boulons, 8c que le chaffis de la
fcie eft maintenu de chaque côté dans la codifie par trois clefs
marquées 21. Ces clefs, qui font de bois, traverfent les deux jumelles
8c font retenues derrière avec des clavettes, afin de pouvoir
les ôter quand on veut faire quelque réparation au chaffis de
la fcie : les deux montans V , X du chaffis de la fcie ne touchent pas
immédiatement contre l’épaifleur dès jumelles n , 13 qui forment
les codifies , parce qu’il y a entre deux une réglé d’environ 10 lignes
d’épaifieur. Ces réglés font mifes pour pouvoir être rcnouvel-
lées lorlque le frottement du chaffis de la fcie les ayant ufées , il
fe trouve avoir trop de jeu 8c n’agit pas bien perpendiculairement,
au lieu que fans cela il faudroit le réparer aflez fouvent.
On remarquera auffi que ce chaffis a par le haut deux entretoi-
fes 24 8t 15 , qu’il n’y a que la première 24 qui foit attachée fixement
à tenons 8c mortoifcs avec les deux montans, au lieu que
la fécondé 15 , à laquelle répond la fcie , a deux tenons qui^ peuvent
monter 8c defcendre dans des rainures pratiquées dans 1 epail-
feur des montans fur la hauteur d’un pied feulement,8e 1 on y introduit
ces tenons par le moyen d’une entaille faite à l’endroit z6,
fans être obligé de démonter le chaffis. Ces entretoifes font traver-
fées par deux vis 27, pofées la tête en-bas fous la fécondé 15 ; 8c au-
defliis de la première 14 , il y a un écrou a chaque vis que Ion
fait tourner avec une clef de fer pour attirer 1 entretoife 2 5 contre
la fupérieure 24 pour bander la fcie. J ’ajouterai que cette fcie eft
plus large en-haut qu’en-bas, afin qu’a mefure que les dents delcendent
elles puifiènt pénétrer davantage dans le bois.
La chaffè qui joint la manivelle avec la fcie doit avoir 8 pieds
de longueur entre les deux points autour defquels elle agit, quoiqu’elle
n’en ait guere que 5 dans le deflein, parce que dans les figures
première 8C troifieme on a donné trop de hauteur aux chevalets
qui portent le rouet 8c les lanternes ; il faudra les abaiflër, afin que
la chafle YQ manoeuvre avec plus d’aifance, 8c afin que l’obliquité
où elle fe rencontre lorfque le coude de la manivelle eft honzonta ,
foit le moins fenfible qu’il eft poffible, pour que la direction e a
puiflance qui élevé la fcie ne s’éloigne que peu de la perpendiculaire
; c’eft à quoi je n’avois pas fait attention en traçant ces ügures.
Chap. IL des Moulins a scier le bois, 8co, j i j
Le bras de levier ac, dans la cinquième figure, a 6 pieds de Ion- p(G o,
gueur , depuis le centre du mouvement de l’effieu a jufqu’à la 8. ' 5
verge de fer es, qui a 22 pouces, de long ; la diftance du centre de
mouvement de l’effieu au centre de mouvement de la charnière d eft de 6 pouces , 8c la diftance depuis ce dernier centre jufques au
fond du cran où l’extrémité du pied de biche tourne la roue, eft
de 1 1 pieds 6 pouces : quand la fcie eft en repos, le levier ac eft
dans une fituation horizontale.
<>95. La roue Z doit être de 3 pieds 4 pouces de diamètre, y Proportion1
compris l’épaifieur du cercle de fer : ce cercle doit avoir 384 crans
de 4 lignes de largeur 8c 2 ( de hauteur : il eft à propos que les an- | | | | ÊÊm
gles des crans dans lefquels appuyé le pied de biche 8c le dédit h“mPt du
fuient un peu aigus, pour éviter que les crans n’échappent ; à cha-
que fois'que la fcie monte, cette roue avance de deux crans. Pour pLAN
en voir la raifon, jettez les yeux fur la cinquième figure de la plan- pIG
che troifieme, qui n’eft autre chofe qu’une répétition de la cinquie- ' '
me de la planche deuxieme, que je n’ai exprimé que par de fimples
traits, pour qu’on puifle.mieux appercevoir ce qu’il m’a paru né-
celfaire d’infinuer. On y remarquera que le point E exprime le centre
de mouvement de l’effieu A BCD qui fait tourner la roue dentée
: que lorfque le bras de levier EF , qui répond au chaffis G de la
fc ie , eft horizontal, on a un triangle EDH formé par la ligne ED
de 6 pouces ( qui marque la diftance du centre du mouvement E
au centre D de la charnière de la hampe du pied de biche ), par la
ligne DH de 1 1 pieds 6 pouces ( qui exprime la diftance du point
D à l’endroit où le pied de biche touche la roue Z quand elle eft en
repos), 8c par la ligne EH de 1 1 pieds 1 1 pouces 4 lignes ( qui marque
la diftance du centre E au même point H ). Or on fera attention
que quand l’extrémité F de la verge de fer eft montée de 30
pouces, qui eft le chemin de la fc ie , le treuil prend une autre fituation
; le point D tombe en M , parce que les deux lignes ED 8C
D r ! n en font plus qu’une feule E l de 12 pieds ; alors le point H
tombe en I par le mouvement que le pied de biche fait faire à la
roue, la ligne E l devient plus grande que la ligne EH de la valeur
de deux crans. C ’eft de quoi il. eft aifé de fe convaincre en faifant
attention que les angles DEH Sç LdLf font égaux , le premier étant
formé par la defeente de la fcie, 8c le fécond par fa montée: que
le triangle reûangle E L f ayant le côté E/ de y pieds 7 pouces ,
8c le côté ƒ L de 30 pouces, l’angle LE ƒ ie trouve de 16 degrés
24 minutes. Or le triangle DEH étant aflùjetti à un angle de la
même valeur, on verra, par le calcul, que le côté EH eft néceffài-
T t ij