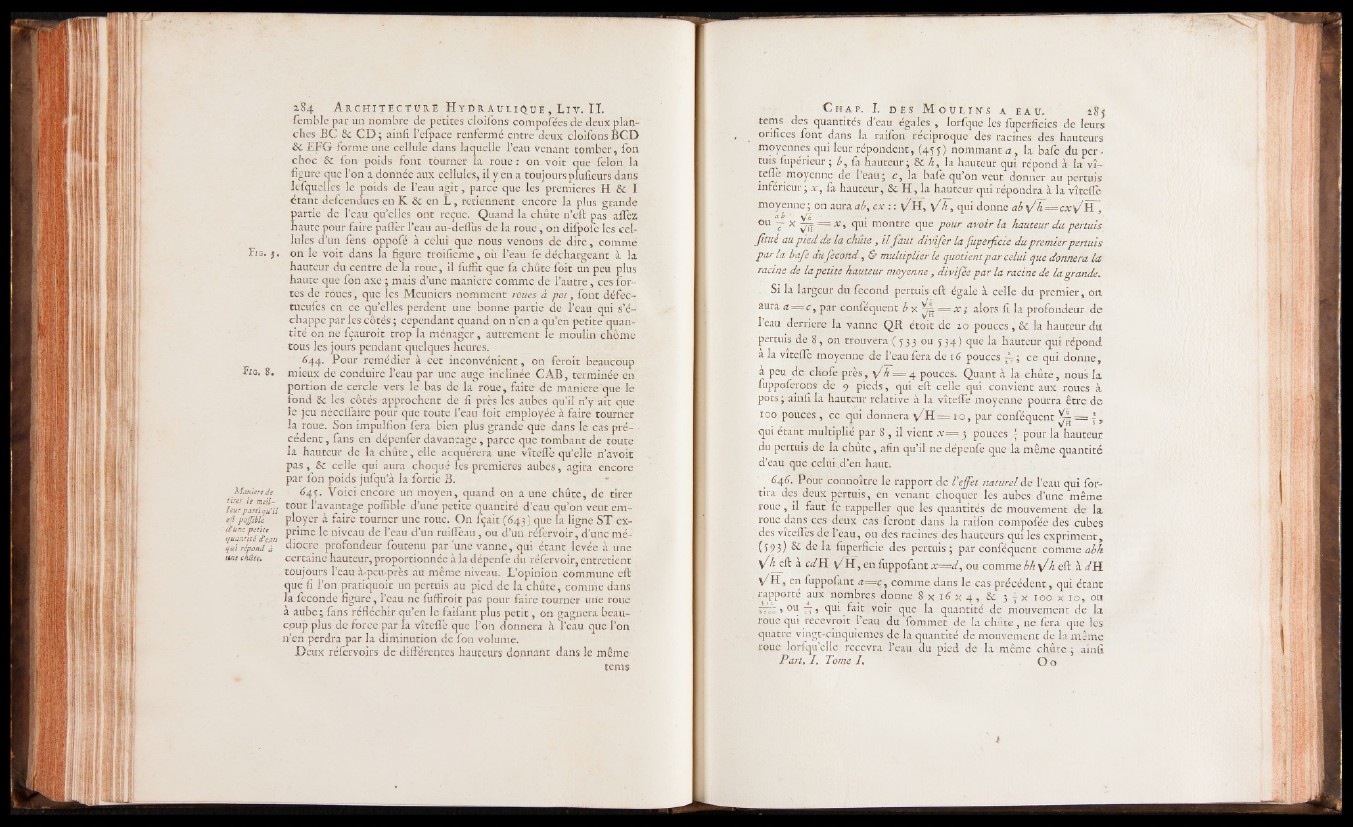
184 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . II.
femble par un nombre de petites cloifons composées de deux planches
BC &c CD ; ainli l’efpace renfermé entre deux cloifons BGD
& E FG forme une cellule dans laquelle l’eau venant tomber, fon
choc Sc fon poids font tourner la roue : on voit que félon la
figure que l’on a donnée aux cellules, il y en a toujours plufieurs dans
lefquelles le poids de l’eau agit, parce que les premières H & I
étant defcendues en K &c en L , retiennent encore la plus grande
partie de l’eau qu’elles ont reçue. Quand la chute n’eft pas alfez
haute pour faire palier l’eau au-deflùs de la roue, on difpole les cellules
d’un fens oppofé à celui que nous venons de dire, comme
Fis. 3. on le voit dans la figure froifieme, où l’eau fe déchargeant à la
hauteur du centre de la roue, il fuffit que fa chute foit un peu plus
haute que fon axe ; mais d’une maniéré comme de l’autre, ces fortes
de roues, que les Meuniers nomment roues à pot, font défec-
tueufes en ce qu’elles perdent utje bonne partie de l’eau qui s’échappe
par les côtés ; cependant quand on n’en a qu’en petite quantité
on ne fçauroit trop la ménager, autrement le moulin chôme
tous les jours pendant quelques heures.
644. Pour remédier à cet inconvénient, on feroit beaucoup
Fig. 8. mieux de conduire l’eau par une auge inclinée C A B , terminée en
portion de cercle vers le bas de la roue, faite de maniéré que le
Fond & les côtés approchent de fi près les aubes qu’il n’y ait que
le jeu nécefîaire pour que toute l ’eau foit employée à faire tourner
la roue. Son impulfion fera bien plus grande que dans le cas pré-
cèdent, fans en dépenfer davantage, parce que tombant de toute
la hauteur de la chute, elle acquérera une vîtefle qu’elle n’avoit
p a s , & celle qui aura choqué les premières aubes, agira encore
par fon poids jufqu’à la fortie B.
Manier:d; 645. Voici encore un moyen, quand on a une chute, de tirer
le u r pinTqdu tout l’avantage poffible d’une petite quantité d’eau qu’on veut em-
tjl poffible ployer à faire tourner une roue. On fçait (643) que la ligne ST ex-
(taoepetite prime le niveau de l’eau d’un ruilfeau, ou d’un réfervoir, d’une méqui
répond à dlocre protondeur foutenu par une vanne, qui étant levée à une
uni chute. certaine hauteur, proportionnée à la dépenfe du réfervoir, entretient
toujours l’eau à-peu-près au même niveau. L ’opinion commune eft
que fi l’on pratiquoit un permis au pied de la chute, comme dans
la fécondé figure, l’eau ne fuffiroit pas pour faire tourner une roue
a aube; fans réfléchir qu’en le faifant plus petit, on gagnera beau- '
coup plus de force par la vîtefle que l’on donnera à l’eau que l’on
n’en perdra par la diminution de fon volume.
Deux réfervoirs de différentes hauteurs donnant dans le même tems
C h a i, I des tems des quantités d’eau égaleMs , oluorlfqiunes l esa f uepearfuic.i es de le1u8r5s moroifyiceensn efso nqtu id laenusr rléap oranidfoenn t,r é(c4i5p5r)o qnuoem dmesa rnatcsi,n elsa dbeasfe hdauu tpeuerrs
mtefisle f umpoéryieenunr e; bd,e fal’ ehaauu;t eur; & A, la hauteur qui répond à la vîinférieur
; ce, fa hauteur, &c ,H la, lbaa hfea uqtue’uorn q vuei urté pdoonndnrear au permis à la vîtefle
moyenne ; on aura ab, e x : : V a , V h , qui donne ab \/h — cx \/H ,
ou ~ X i i|S x , qui montre que pour avoir la hauteur du pertuis
Jitue au p ied de la chute, ilfa u t d ivifer la fuperficie du premier pertuis
par la bafe du fécond, & multiplier le quotient par celui que donnera la
racine de la petite hauteur moyenne, divifée par la racine de la grande.
. Si la largeur du fécond pertuis eft égale à celle du premier, 011
aura a == c, par conféquent b x - - x ; alors fi la profondeur de
l’eau derrière la vanne QR étoit de zo pouces, & la hauteur du
pertuis de 8, on trouvera ( 533 ou 334) que la hauteur qui répond
a la vîtefle moyenne de l’eau fera de 1 6 pouces^-; ce qui donne,
fau pppeuo fedreo ncsh odfee p9r èpsi,e yds h, =qu i4 epfot ucceelsl.e Qquuia ncto àn vlaie ncth ûautex, rnoouuess la à pots; ainfi la hauteur relative à la vîtefle moyenne pourra être de
100 pouces , ce qui donnera ro, par conféquent | ,
qui étant multiplié par 8 , il vient x — 3 pouces [ pour la hauteur
du permis de la chûte, afin qu’il ne dépenfe que la même quantité
d’eau que celui d’en haut.
tira6 4d6e. s Pdoeuurx cpoenrntuoiîstr, ee lne rvaepnpaonrtt cdheo lq’euffeert nleast uaruebl dese dl’e’uanue qmui êfmore- rroouuee ,d ailn sf acuest fdee uraxp pcaesll efre rqounet ldeas nqsu laan triatiéfso nd ec ommopuovfeémé ednest dcue belas des viteflès de l’eau, ou des racines des hauteurs qui les expriment,
( 5 9 3 ) de la fuperficie des pertuis ; par conféquent comme abh
V h eft a cdH \/H , enfuppofant x—d , ou commebh\/heR. à d J î
r\a/pHpo, retné fauupxp onfoamntb are=s cd, ocnonme m8ex d1a6nsx l4e ,c a&s p r3é cjéxd e1n0t0, qxu 1i 0é,t aonut rÏTouïîe > qui TrTe c> efvl™ra iFt ali’te avuo idr uq ufoe mlma eqtu dane tiltaé cdheû tem ,o nuev efmerean tq udee lélas qrouuaet relo vrfiqnug’te-lclien qrueiceemvreas dl’ee alua qduua nptiietdé ddee mlao umveêmmeen tc dheû tlea m; aêimnfei P an . I . Tome I . O o