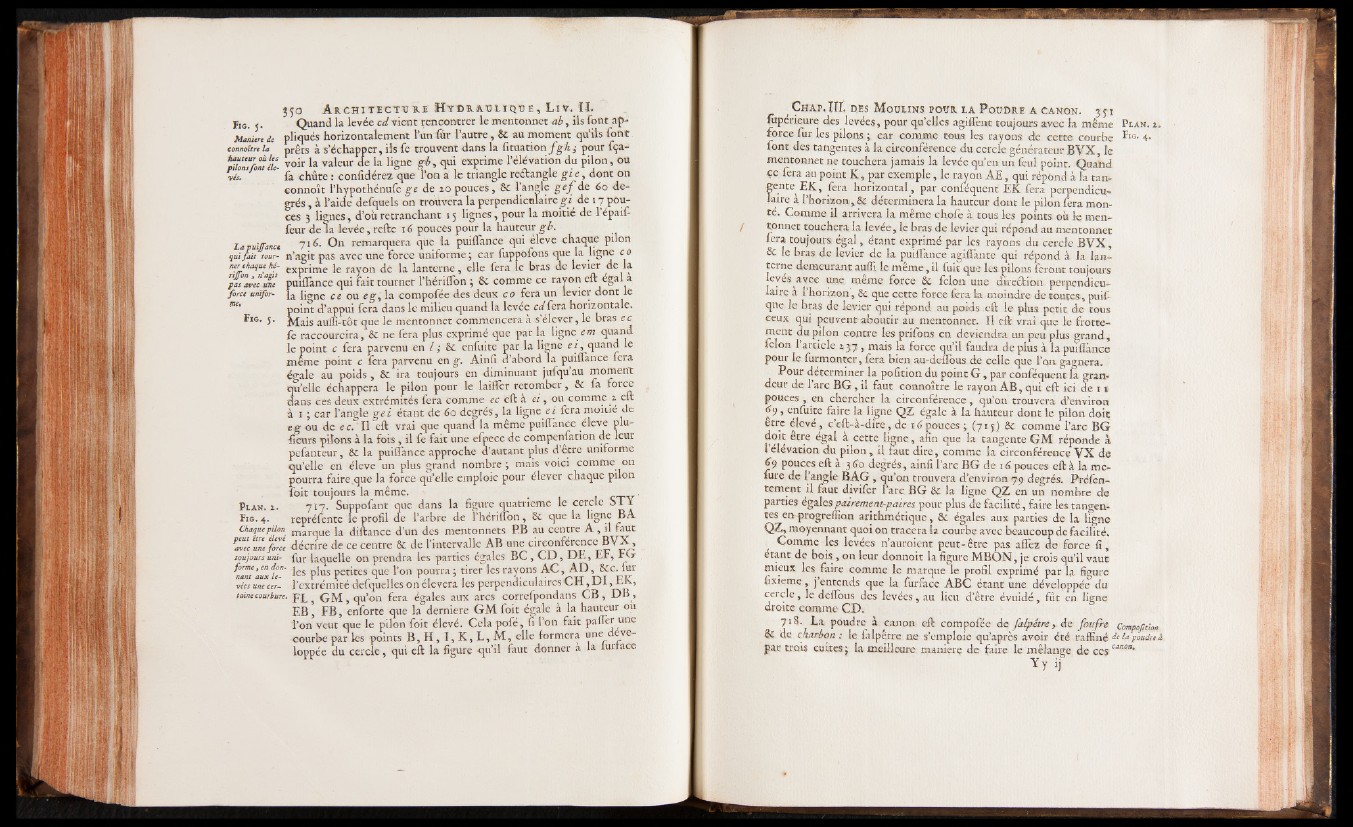
Fig.
Maniéré de
connoître la
hauteur où les
pilotis fo n t élevés.
L a pu ijfa nc t
qu i fa i t tourner
chaque fié-
rijfon , n'agit
p a s avec une
fo r ce unïfor-
J 5 0 A R C H I T E C T U R E H Y D R A U L IQ U E , L lV . I I .
Quand la levée cd vient rencontrer le mentonnet ab, ils font appliqués
horizontalement l’un fer l ’autre, 8t au moment qu’ils font
prêts à s’échapper, ils fe trouvent dans la fituation f g h ; pour fça-
voir la valeur de la ligne gb , qui exprime l’élévation du pilon, ou
fe ch-ûte : confidérez que l ’on a le triangle re&angle g i e , dont on
connoît l’hypothénufe ge de 10 pouces, &c l’angle g e f de 60 degrés
, à l’aide defquels on trouvera la perpendiculaire g i de 17 pouces
3 lignes, d’où retranchant 15 lignes, pour la moitié de 1 épaif-
feur de la levée, refte 1 6 pouces pour la hauteur g b.
7 1 6. On remarquera que la puiffence qui éleve chaque pilon
Fig.
n’agit pas avec une force uniforme; car fuppofons que la ligne ce
exprime le rayon dê la lanterne, elle fera lé bras de levier de la
puiflânce qui Fait tourner l’hériflon ; & comme ce rayon eft égal a
la ligne ce ou e g , la compofée des deux co fera un levier dont le
point d’appui fera dans le milieu quand la levee cd fera horizontale.
Mais auffi-tôt que le mentonnet commencera à s’élever, le bras ec
fe raccourcira, St ne fera plus exprimé que par la ligne em quand
le point c fera parvenu en / ; St enfuite par la ligne e i , quand le
meme point c fora parvenu en g. Ainli d’abord la puiflânce fora
égale au poids , 8t ira toujours en diminuant jufqu’au moment
qu’elle échappera le pilon pour le laifïcr retomber, 8t fa force
dans ces deux extrémités fora comme ec eft à c i , ou comme 1 eft
à 1 ; car l’angle g e i étant de 60 degrés, la ligne e i fera moitié de
eg ou de ec. Il eft vrai que quana la même puiflânce eleve plusieurs
pilons à la fois, il fe fait une efpece de compenfation de leur
pefanteur, St la puiflânce approche d’autant plus d'ette uniforme
qu’elle en éleve un plus grand nombre ; mais voici comme on
pourra faire.que la force qu’elle emploie pour elever chaque pilon
îbit toujours la même. _ , .
7 17 . Suppofant que dans la figure quatrième le cercle S T Y
repréfente le profil de l’arbre de Thériflon, 8t que la ligne B A
Chaquepîlm marque fe diftance d’un des mentonnets PB au centre A , il faut
‘une fo re t décrire de ce centre St de l’intervalle AB une circonférence B V X ,
toujours uni- fur laquelle on prendra les parties égales B C , C D , D E , EF, FG
fo rm e , en don- ] j petites que Ton pourra; tirer les rayons A C , A D , 8tc. fur
vées une cer - l’extremité defquelles on élevera Jes perpendiculaires v^ x l, u i ,
tainecourbure. 4 G M , qu’on fera égales aux arcs correfpondans C B , DB ,
E B , F B , enforte que la derniere GM foit égale a la hauteur ou
Ton veut que le pilon foit élevé. Cela pofé, fi Ton fait pafler une
courbe par les points B , H , I , K , L , M , elle formera une ve-
loppée du cercle, qui eft la figure qu’il faut donner a la lurtacc
Plan.
Fig. 4.
Chap.III. des M oulins pour, la Poudre a canon. 351
fepérieure des levées, pour qu’elles agi fient toujours avec fe même Plan. i .
force fur les pilons ; car comme tous les rayons- de cette courbe Fla- 4-
font des tangentes à fe circonférence du cercle générateur B V X , le
mentonnet ne touchera jamais 1a levée qu’en un foui point. Quand
çe fora au point K , par exemple, le rayon A E , qui répond à fe tangente
E K , fora horizontal, par conséquent E K fera perpendiculaire
à, l’horizon,& déterminera la hauteur dont le pilon fora monté.
Comme fi arrivera 1a même chofe à tous les points où le men-
tonnet touchera la levée , le bras de levier qui répond au mentonnet
for* toujours ég a l, étant exprimé par les rayons du cercle B V X ,
& le bras de levier de 1a puiflânçe agiflânte qui répond à 1a lanterne
demeurant aufli le même, il fuit que les pilons feront toujours
levés avec une meme force Qc félon une direéfion. perpendiculaire
à l'horizon, 8e que cette force fera fe moindre de toutes, puif-
qne le bras de levier qui répond au poids eft le plus petit de tous
ceux qui peuvent aboutir au mentonnet. I l eft vrai que le frottement
du pilon contre les prifons en deviendra un peu plus grand,
félon l'article 2,37 , mais la force qu’il faudra de plus à la puiflânce
pour le fermenter, fera bien au-deflous de celle que l’on gagnera.
Pour déterminer fe pofition du point G , par conféquent 1a grandeur
de Tare B G , il faut connoître le rayon A B , qui eft ici de 1 1
pouees , en chercher la circonférence, qu’on trouvera d’environ
69, enfuite faire 1a ligne Q Z égale à fe hauteur dont le pilon doit
être eleve , ç’eft-à-dire, de 1 6 pouces ; (715) &c comme Tare BG
doit être égal à cette ligne, afin que 1a tangente GM réponde à
1 élévation du pilon, il faut dire, comme 1a circonférence V X de
C9 pouces eft à 3 60 degrés, ainfi l’arc BG de 1 6 pouces eft â 1a meu
re de l’ang le BA G , q u’on trouvera d’environ 79 degrés. Préfen-
tement il faut divifer Tare BG & 1a ligne Q Z en un nombre de
parties égalespairement-paires pour plus de facilité, faire les tangentes
enprogreflion arithmétique, & égales aux parties de 1a ligne
Q Z , moyennant quoi on tracera la courbe avec beaucoup de facilité.
Comme les levées n’auroient peut-être pas affèz de force fi,
étant de bois , on leur donnoit 1a figure M B O N , je crois qu’il vaut
mieux les faire comme le marque le profil exprimé par fe figuré
fixieme, j entends que fe furface A B C étant une développée du
ceicle, le deflous des levées, au lieu d’être évuidé, fût en ligne
droite comme C D .
I I ? ’ , H P° U,c1t'r f ,Canon eft compofée de falpêtre, de foufre Compofuiou
çC de charbon: le lalpecre ae s’emploie qu’après avoir été raffiné p poudre à
par crois cuites ; la meilleure maniéré de faire le mêlante de ces caaon*
Y y ij