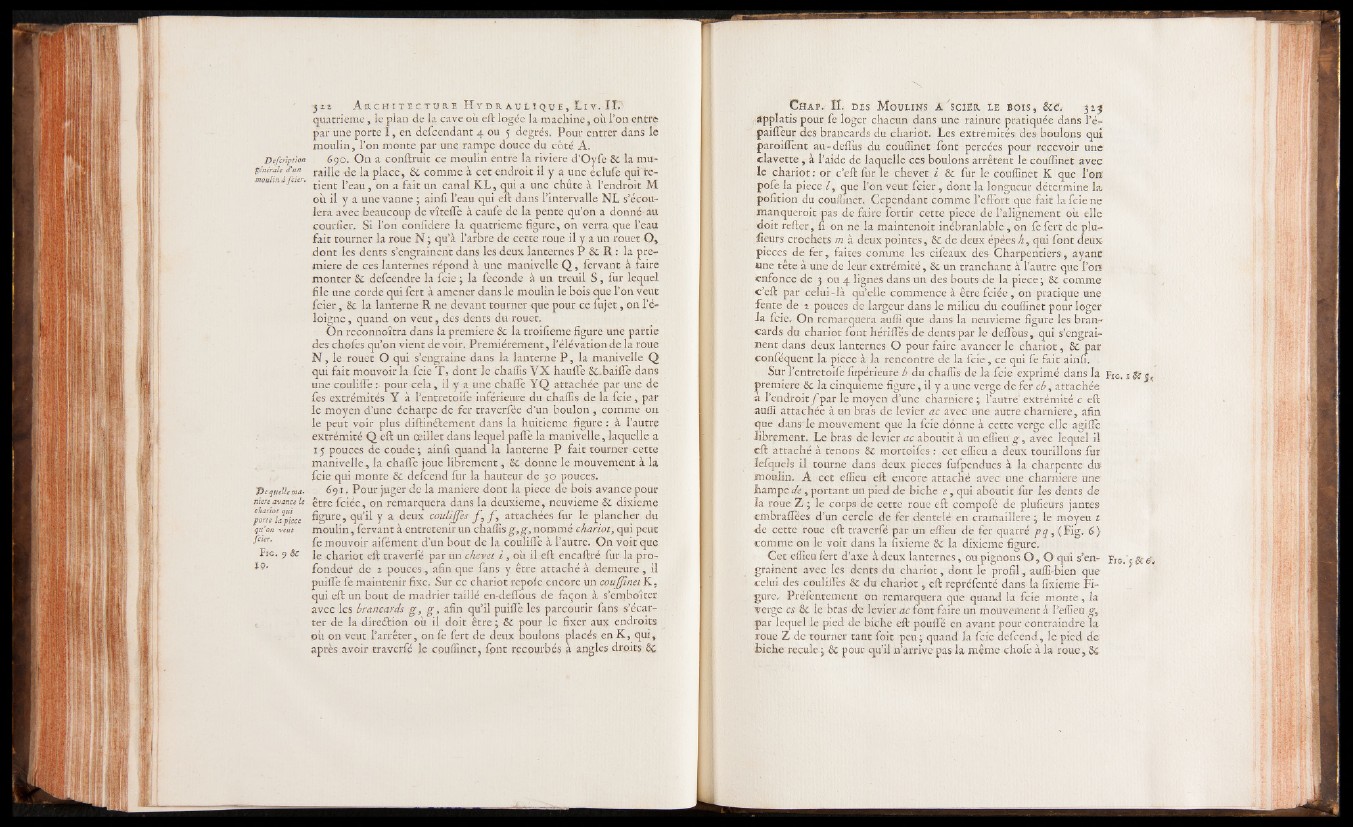
Defcription
générale d ’un
moulin à fc ie r.
quelle maniéré
avance le
chariot qui
porte la pièce
qu’ on veut
fc ie r .
Fig. 5 &
*9.
j î ,î A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . 1I.
quatrième, le plan de la cave où eft logée la machine, où l’on entre
par une porte I , en defcendant 4 ou 5 degrés. Pour entrer dans le
moulin, l’on monte par une rampe douce du côté A.
690. On a conftruit ce moulin entre la riviere d'Oyfe St la muraille
de la place, St comme à cet endroit il y a une éclufe qui retient
l’eau, on a fait un canal K L , qui a une chute à l’endroit M
où il y a une vanne ; ainli l’eau qui eft dans l’intervalle NL s’écoulera
avec beaucoup de vîtelle à caufe de la pente qu’on a donné au
courlier. Si l’on confidere la quatrième figure, on verra que l’eau
fait tourner la roue N ; qu’à l’arbre de cette roue il y a un rouet O,
dont les dents s’engrainent dans les deux lanternes P St R : la première
de ces lanternes répond à une manivelle Q , fervant à faire
monter St defcendre la fcie ; la fécondé à un treuil S , fur lequel
file une corde qui fert à amener dans le moulin le bois que l’on veut
fcier, 8c la lanterne R ne devant tourner que pour ce fujet, on l’éloigne
, quand on veut, des dents du rouet.
On reconnoîtra dans la première St la troifîeme figure une partie
des chofes qu’on vient devoir, Premièrement, l'élévation de la roue
N , le rouet O qui s’engraine dans la lanterne P , la manivelle Q
qui fait mouvoir la fcie T , dont le chaffis V X hauflè St.baifte dans
une coulillè : pour cela, il y a une chaflè YQ attachée par une de
fes extrémités Y à l’entretoife inférieure du chaffis de la fc ie , par
le moyen d’une écharpe de fer traverfée d’un boulon , comme on
le peut voir plus diftinétement dans la huitième figure : a l’autre
extrémité Q eft un oeillet dans lequel pâlie la manivelle, laquelle a
15 pouces de coude; ainli quand la lanterne P fait tourner cette
manivelle, la chafle joue librement, St donne le mouvement à la
fcie qui monte St defcend fur la hauteur de 30 pouces.
691. Pour juger de la maniéré dont la piece de bois avance pour
être fciée, on remarquera dans la deuxieme, neuvième St dixième
figure, qu’il y a deux coulijffes f , f , attachées fur le plancher du
moulin, fervant à entretenir un chaffis g , g , nommé chariot, qui peut
fe mouvoir aifément d’un bout de la coulifle à l’autre. On voit que
le chariot eft traverfé par un chevet i , où il eft encaftré fur la profondeur
de 2 pouces., afin que fans y être attaché à demeure , il
puilïè fe maintenir fixe, Sur ce chariot repole encore un cou ([inet h
qui eft un bout de madrier taillé en-deflous de façon à s’emboîter
avec les brancards g , g , afin qu’il puifle les parcourir fans s’écarter
de la direétion où il doit être; St pour le fixer aux endroits
où on veut l’arrêter, onfe fert de deux boulons placés en K , qui,
après avoir traverfé le couffinet, font recourbés à angles droits St
C hap. IL des M oulins a ' scier, le bois, Stc. 323
âpplatis pour fe loger chacun dans une rainure pratiquée dans l’é-
paifîeur des brancards du chariot. Les extrémités des boulons qui
paroiflent au-dellùs du couffinet font percées pour recevoir une
clavette, à l’aide de laquelle ces boulons arrêtent le couffinet avec
le chariot: or c’eft fur le chevet i 8t fur le couffinet K que l’orï
pofe la piece l , que l’on veut fcier, dont la longueur détermine la
pofition du couffinet. Cependant comme l’effort que fait la fcie ne
manqueroit pas de faire fortir cette piece de l’alignement où elle
doit refter, fi on ne la maintenoit inébranlable, on fe fert de plusieurs
crochets m à deux pointes, 8c de deux épées A, qui font deux
pièces de fe r, faites comme les cifeaux des Charpentiers, ayant
une tête à une de leur extrémité, Sc un tranchant à l’autre que l’on
enfonce de 3 ou 4 lignes dans un des bouts de la piece ; 8c comme
c ’eft par celui-là qu’elle commence à être fciée, on pratique une
fente de 2 pouces de largeur dans le milieu du couffinet pour loger'
la fcie. On remarquera auffi que dans la neuvième figure les brancards
du chariot font hérifles de dents par le defïbus, qui s’engrainent
dans deux lanternes O pour faire avancer le chariot, 8c par
conféquent la piece à la rencontre de la fcie, ce qui fe fait ainli.
Sur r entretoife fupérieure b du chaffis de la fcie exprimé dans la
première 8c la cinquième figure, il y a une verge de fer cb, attachée
a l’endroit ƒ par le moyen d’une charnière ; l’autre extrémité c eft
auffi attachée à un bras de levier ac avec une autre charnière, afin
que dans'le mouvement que la fcie donne à cette verge elle agifle
librement. L e bras de levier ac aboutit à un effieu g , avec lequel il
eft attaché à tenons 8c mortoifes : cet effieu a deux tourillons fur
lefquels il tourne dans deux pièces fufpendues à la charpente dui
moulin. A cet effieu eft encore attaché avec une charnière une
hampe de, portant un pied de biche e , qui aboutit fur les dents de
la roue Z ; le corps de cette roue eft compofé de plufieurs jantes
embraffees d’un cercle de fer dentelé en cramaillere ; le moyeu t
de cette roue eft traverfé par un effieu de fer quarré p q , ( Fig. 6 )
comme on le voit dans la fixieme 8c la dixième figure.
Cet effieu fert d’axe à deux lanternes, ou pignons 0 , 0 qui s’engrainent
avec les dents du chariot, dont le profil, auffi-bien que
celui des coulilïès 8c du chariot, eft repréfenté dans- la fixieme Figure.
Préfentement on remarquera que quand la fcie monte, la
verge es 8c le bras' de levier ac font faire un mouvement à l’effieü g ,
par lequel le pied de biche eft poulie en avant pour contraindre la
roue Z de tourner tant foit peu; quand la fcie defcend, le pied dé
biche recule ; 8c pour qu’il n’arrive pas la même chofe à la roue, 8c
Fig. x Si 3,
Fig. j & jH