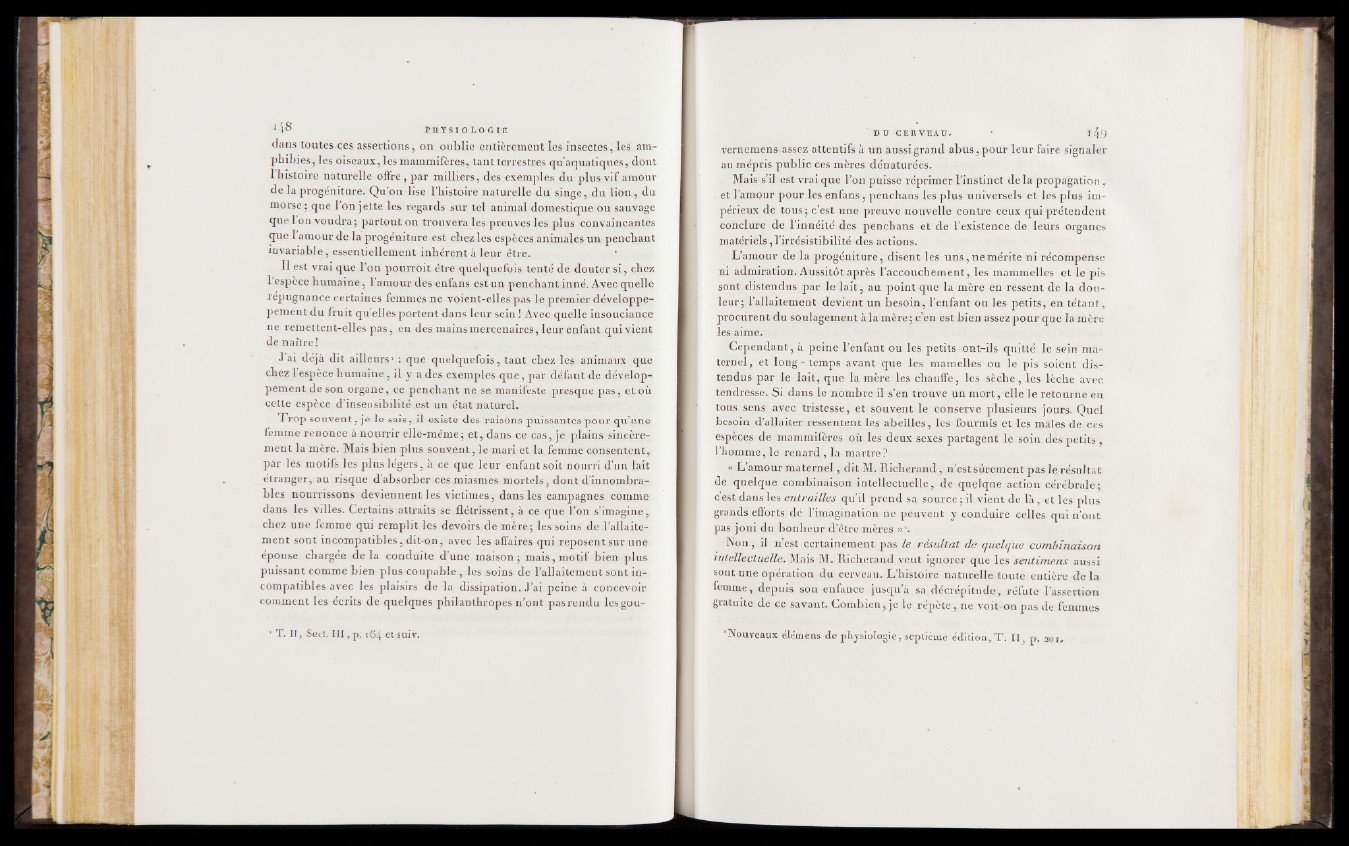
dans toutes ces assertions, on oublie entièrement les insectes, les amphibies,
les oiseaux, les mammifères, tant terrestres qu’aquatiques, dont
1 histoire naturelle offre, par milliers, des exemples du plus vif amour
de la progéniture. Qu'on lise l’histoire naturelle du singe, du lion, du
morse ; que l ’on jette les regards sur tel animal domestique ou sauvage
que Ion voudra ; partout on trouvera les preuves les plus convaincantes
que 1 amour de la progéniture est chez les espèces animales un penchant
invariable, essentiellement inhérent à leur être.
Il est vrai que l’on pourroit être quelquefois tenté de douter si, chez 1 espece humaine, l’amour des enfans est un penchant inné. Avec quelle
répugnance certaines femmes ne voient-elles pas le premier développe-
pement du fruit qu’elles portent dans leur sein ! Avec quelle insouciance
ne remettent-elles pas, en des mains mercenaires, leur enfant qui vient
de naître!
J ai déjà dit ailleurs* : que quelquefois, tant chez les animaux que
chez 1 espèce humaine, il y a des exemples que, par défaut de développement
de son organe, ce penchant ne se manifeste presque pas, et où
cette espèce d’insensibilité est un état naturel.
Trop souvent, je le sais, il existe des raisons puissantes pour qu’une
femme renonce à nourrir elle-même; et, dans ce cas, je plains sincèrement
la mère. Mais bien plus souvent, le mari et la femme consentent,
par les motifs les plus légers, à ce que leur enfant soit nourri d’un lait
étranger, au risque d’absorber ces miasmes mortels, dont d’innombrables
nourrissons deviennent les victimes, dans les campagnes comme
dans les villes. Certains attraits se flétrissent, à ce que l’on s’imagine,
chez une femme qui remplit les devoirs de mère; les soins de l’allaitement
sont incompatibles, dit-on, avec les affaires qui reposent sur une
épouse chargée delà conduite d’une maison; mais, motif bien plus
puissant comme bien plus coupable, les soins de l’allaitement sont incompatibles
avec les plaisirs de la dissipation. J’ai peine à concevoir
comment les écrits de quelques philanthropes n’ont pas rendu lesgou-
* T. II, Sect. III, p. 164 et suiv.
vernemens assez attentifs à un aussi grand abus, pour leur faire signaler
au mépris public ces mères dénaturées.
Mais s’il est vrai que l’on puisse réprimer l’instinct delà propagation,
et l’amour pour les enfans, penchans les plus universels et les plus impérieux
de tous; c’est une preuve nouvelle contre ceux qui prétendent
conclure de l’innéité des penchans et de l’existence de leurs organes
matériels, l’irrésistibilité des actions.
L’amour de la progéniture, disent les uns, ne mérite ni récompense
ni admiration. Aussitôt après l’accouchement, les mammelles et le pis
sont distendus par le lait, au point que la mère en ressent de la douleur;
l’allaitement devient un besoin, l’enfant ou les petits, en tétant,
procurent du soulagement à la mère; c’en est bien assez pour que la mère
les aime.
Cependant, à peine l’enfant ou les petits ont-ils quitté le sein maternel,
et long - temps avant que les mamelles ou le pis soient distendus
par le lait, que la mère les chauffe, les sèche, les lèche avec
tendresse. Si dans le nombre il s’en trouve un mort, elle le retourne en
tous sens avec tristesse, et souvent le conserve plusieurs jours. Quel
besoin d’allaiter ressentent les abeilles, les fourmis et les mâles de ces
espèces de mammifères où les deux sexes partagent le soin des petits ,
l’homme, le renard, la martre?
« L’amour maternel, dit M. Richerand, n’est sûrement pas le résultat
de quelque combinaison intellectuelle,. de quelque action cérébrale;
c’est dans les entrailles qu’il prend sa source; il vient de là, et les plus
grands efforts dé l’imagination ne peuvent y conduire celles qui n’ont
pas joui du bonheur d’être mères » *.
Non, il n’est certainement pas le résultat de quelque combinaison
intellectuelle. Mais M. Richerand veut ignorer que les sentimens aussi
sont une opération du cerveau. L’histoire naturelle toute entière de la
femme, depuis son enfance jusqu’à sa décrépitude, réfute l’assertion
gratuite de ce savant. Combien, je le répète, ne voit-on pas de femmes
‘Nouveaux élémens de physiologie, septième édition,T. I l , p. 301,