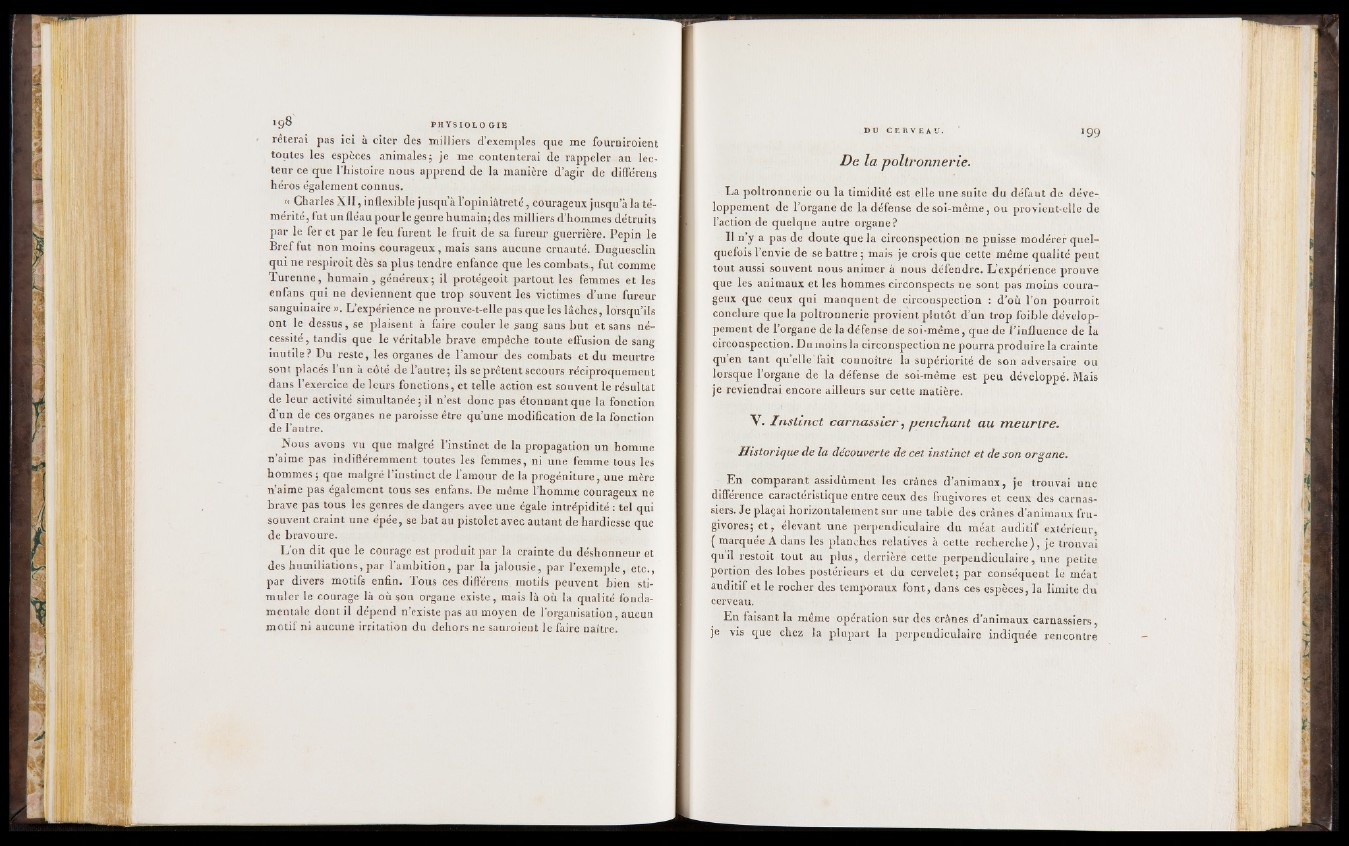
reterai pas ici à citer des milliers d’exemples que me fourniroient
toutes les espèces animales; je me contenterai de rappeler au lecteur
ce que l’histoire nous apprend de la manière d’agir de différens
héros également connus.
« Charles XII, inflexible jusqu’à l’opiniâtreté, courageux jusqu’à la témérité,
fut un fléau pour le genre humain; des milliers d’hommes détruits
par le fer et par le feu furent le fruit de sa fureur guerrière. Pépin le
Bref fut non moins courageux, mais sans aucune cruauté. Duguesclin
qui ne respiroit dès sa plus tendre enfance que les combats., fut comme
Turenne, humain , généreux; il protégeoit partout les femmes et les
enfans qui ne deviennent que trop souvent les victimes d’une fureur
sanguinaire ». L’expérience ne prouve-t-elle pas que les lâches, lorsqu’ils
ont le dessus, se plaisent à faire couler le sang sans but et sans nécessité
, tandis que le véritable brave empêche toute effusion de sang
inutile? Du reste, les organes de l’amour des combats et du meurtre
sont placés l’un à côté de l’autre; ils se prêtent secours réciproquement
dans l’exercice de leurs fonctions, et telle action est souvent le résultat
de leur activité simultanée ; il n’est donc pas étonnant que la fonction
d’un de ces organes ne paroisse être qu’une modification de la fonction
de l’autre.
Nous avons vu que malgré l’instinct de la propagation un homme
n’aime pas indifléremment toutes les femmes, ni une femme tous les
hommes ; que malgré l ’instinct de l’amour de la progéniture, une mère
n’aime pas également tous ses enfans. De même l’homme courageux ne
brave pas tous les genres de dangers avec une égale intrépidité : tel qui
souvent craint une épée, se bat au pistolet avec autant de hardiesse que
de bravoure.
L ’on dit que le courage est produit par la crainte du déshonneur et
des humiliations, par l’ambition, par la jalousie, par l’exemple, etc.,
par divers motifs enfin. Tous ces différens motifs peuvent bien stimuler
le courage là où son organe existe, mais là où la qualité fondamentale
dont il dépend n’existe pas au moyen de l’organisation, aucun
motif ni aucune irritation du dehors ne sauraient le faire naître.
De la poltronnerie.
La poltronnerie ou la timidité est elle une suite du défaut de développement
de l ’organe de la défense de soi-même, ou provient-elle de
faction de quelque autre organe?
Il n’y a pas de doute que la circonspection ne puisse modérer quelquefois
l’envie de se battre ; mais je crois que cette même qualité peut
tout aussi souvent nous animer à nous défendre. L’expérience prouve
que les animaux et les hommes circonspects ne sont pas moins courageux
que ceux qui manquent de circonspection : d’où l ’on pourroit
conclure que la poltronnerie provient plutôt d’un trop foible développement
de l’organe de la défense de soi-même, que de l’influence de la
circonspection. Du moins la circonspection ne pourra produire la crainte
qu’en tant qu’elle'fait connoître la supériorité de son adversaire ou
lorsque l’organe de la défense de soi-même est peu développé. Mais
je reviendrai encore ailleurs sur cette matière.
Y. Instinct carnassier, penchant au meurtre.
Historique de la découverte de cet instinct et de son organe.
En comparant assidûment les crânes d’animaux, je trouvai une
différence caractéristique entre ceux des frugivores et ceux des carnassiers.
Je plaçai horizontalement sur une table des crânes d’animaux frugivores;
et, élevant une perpendiculaire du méat auditif extérieur
( marquée A dans les planches relatives à cette recherche), je trouvai
qu’il restoit tout au plus, derrière cette perpendiculaire, une petite
portion des lobes postérieurs et du cervelet; par conséquent le méat
auditif et le rocher des temporaux font, dans ces espèces, la limite du
cerveau.
En faisant la même opération sur des crânes d’animaux carnassiers,
je vis que chez la plupart la perpendiculaire indiquée rencontre