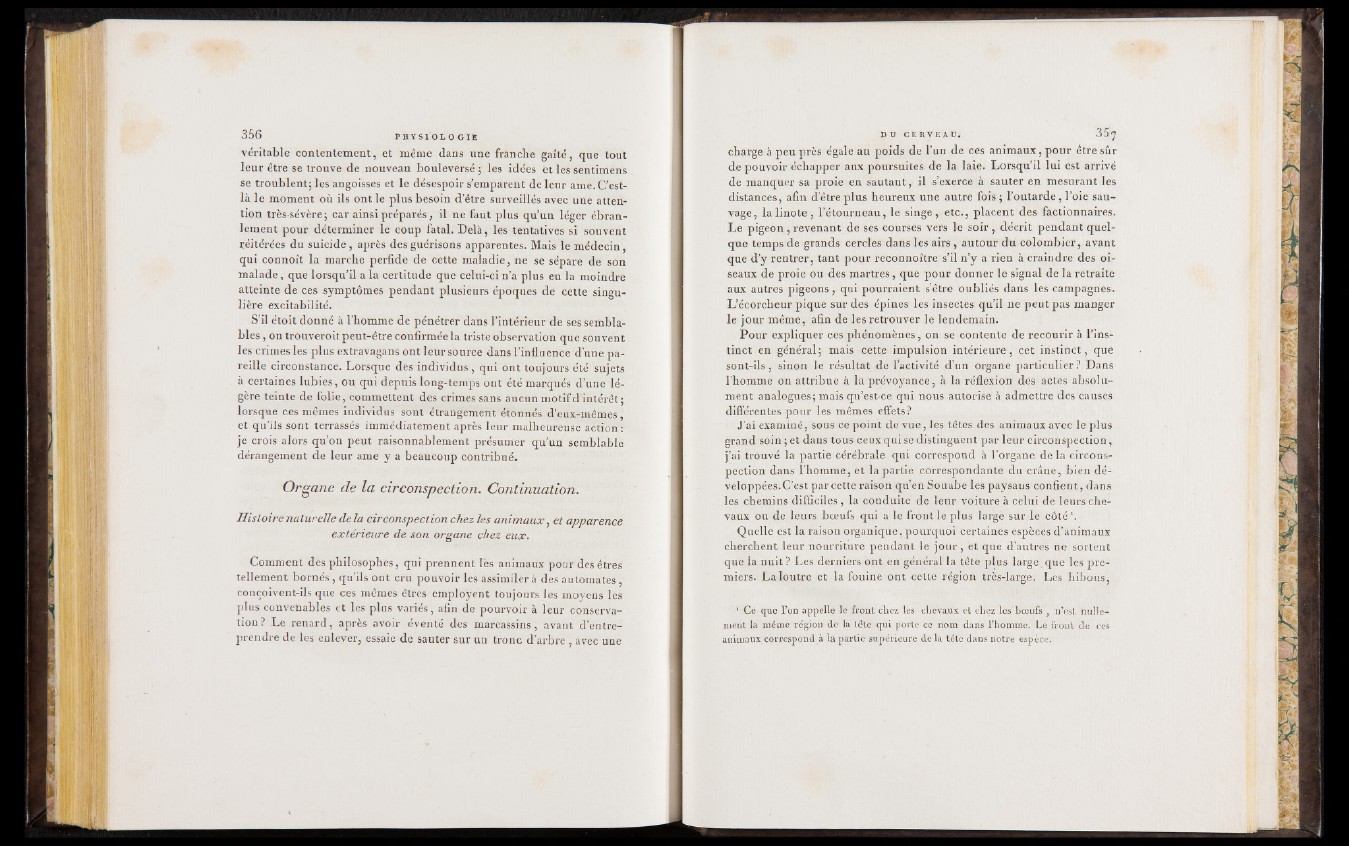
356 P H Y S I O L O G I E
véritable contentement, et même dans line franche gaîté, que tout
leur être se trouve de nouveau bouleversé ; les idées ët les sentimens
se troublent; les angoisses et le désespoir s’emparent de leur ame.C’est-
là le moment où ils ont le plus besoin d’être surveillés avec une attention
très-sévère; car ainsi préparés, il ne faut plus qu’un léger ébranlement
pour déterminer le coup fatal. Delà, les tentatives si souvent
réitérées du suicide, après des guérisons apparentes. Mais le médecin,
qui connoît la marche perfide de cette maladie, ne se sépare de son
malade, que lorsqu’il a la certitude que celui-ci n’a plus eu la moindre
atteinte de ces symptômes pendant plusieurs époques de cette singulière
excitabilité.
S’il étoit donné à l’homme de pénétrer dans l’intérieur de ses semblables,
on trouveroit peut-être confirmée la triste observation que souvent
les crimes les plus extravàgans ont leur source dans l’influence d'une pareille
circonstance. Lorsque des individus , qui ont toujours été sujets
à certaines lubies, ou qui depuis long-temps ont été marqués d’une légère
teinte de folie, commettent des crimes sans aucun motif d’intérêt;
lorsque ces mêmes individus sont étrangement étonnés d’eux-mêmes,
et qu’ils sont terrassés immédiatement après leur malheureuse action :
je crois alors qu’on peut raisonnablement présumer qu’un semblable
dérangement de leur ame y a beaucoup contribué.
Organe de la circonspection. Continuation.
Histoire naturelle de la circonspection chez les animaux, et apparence
extérieure de son organe chez eux.
Comment des philosophes, qui prennent lès animaux pour des êtres
tellement bornés, qu’ils ont cru pouvoir les assimiler à des automates,
conçoivent-ils que ces mêmes êtres employent toujours les moyens les
plus convenables et les plus variés, afin de pourvoir à leur conservation?
Le renard, après avoir éventé des marcassins, avant d’entreprendre
de les enlever, essaie de sauter sur un tronc d’arbre , avec une
charge à peu près égale au poids de l’un de ces animaux, pour être sûr
de pouvoir échapper aux poursuites de la laie. Lorsqu’il lui est arrivé
de manquer sa proie en sautant, il s’exerce à sauter en mesurant les
distances, afin d’être plus heureux une autre fois; l’outarde, l ’oie sauvage,
lalinote , l’étourneau, le singe, etc., placent des factionnaires.
Le pigeon, revenant de ses courses vers le soir , décrit pendant quelque
temps de grands cercles dans les airs, autour du colombier, avant
que d’y rentrer, tant pour reconnoître s’il n’y a rien à craindre des oiseaux
de proie ou des martres, que pour donner le signal de la retraite
aux autres pigeons, qui pourraient s’être oubliés dans les campagnes.
L’écorcheur pique sur des épines les insectes qu’il ne peut pas manger
le jour même, afin de les retrouver le lendemain.
Pour expliquer ces phénomènes, on se contente de recourir à l’instinct
en général; mais cette impulsion intérieure, cet instinct, que
sont-ils, sinon le résultat de l’activité d’un organe particulier? Dans
l ’homme on attribue à la prévoyance, à la réflexion des actes absolument
analogues; mais qu’est-ce qui nous autorise à admettre des causes
différentes pour les mêmes effets?
J’ai examiné, sous ce point de vue, les têtes des animaux avec le plus
grand soin ; et dans tous ceux qui se distinguent par leur circonspection,
j’ai trouvé la partie cérébrale qui correspond à l’organe de la circonspection
dans l’homme, et la partie correspondante du crâne, bien développées.
C’est par cette raison qu’en Souabe les paysans confient, dans
les chemins difficiles, la conduite de leur voiture à celui de leurs chevaux
ou de leurs boeufs qui a le front le plus large sur le côté '.
Quelle est la raison organique, pourquoi certaines espèces d’animaux
cherchent leur nourriture pendant le jour, et que d’autres ne sortent
que la nuit ? Les derniers ont en général la tête plus large., que les premiers.
La loutre et la fouine ont celle région très-large. Les hibous,
’ Ce que l ’on appelle le front chez les chevaux et chez les hoeufs , n’est nullement
la même région de la tête qui porte ce nom dans l’homme. Le front de ces
animaux correspond à la partie supérieure de la tête dans notre espèce.