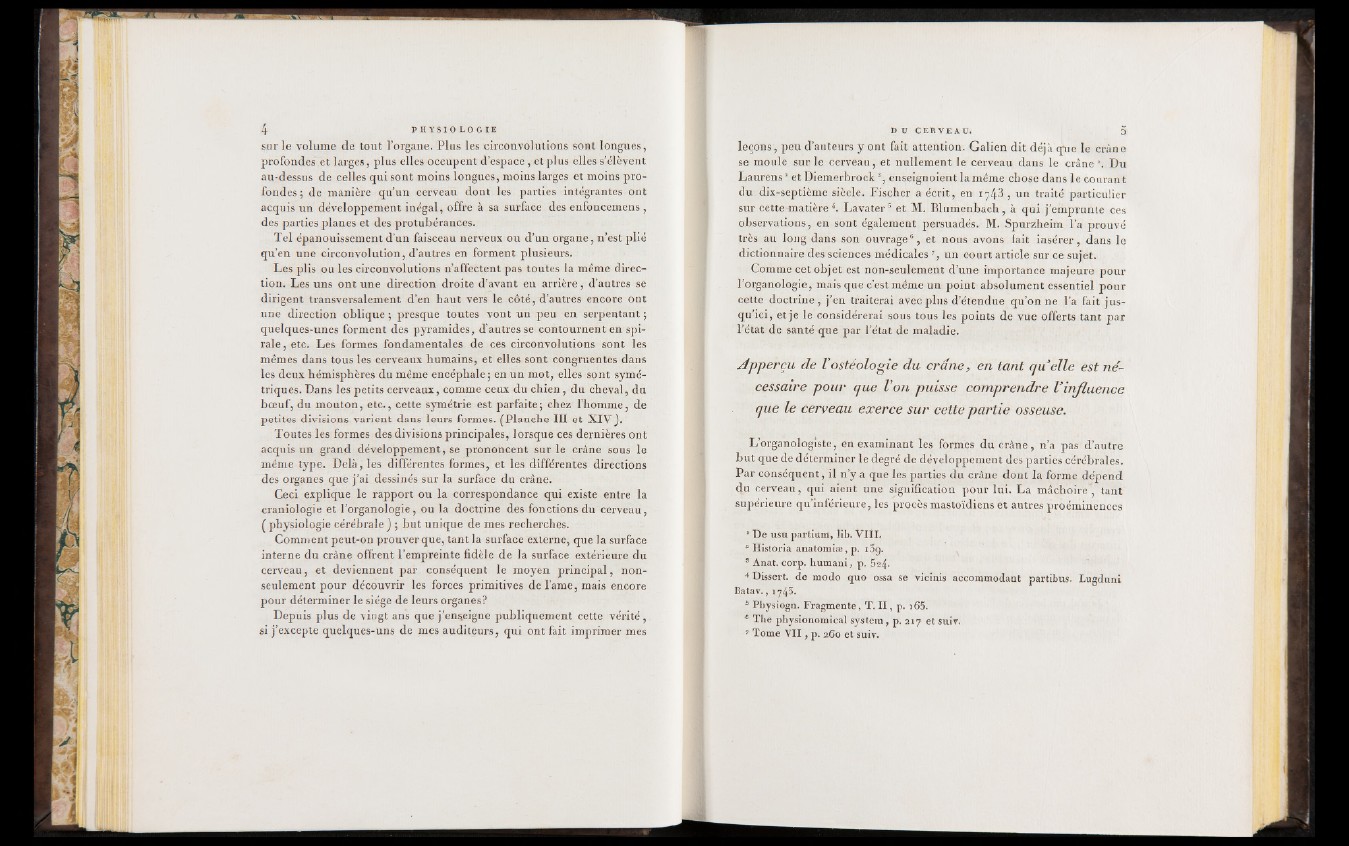
sur le volume de tout l’organe. Plus les circonvolutions sont longues,
profondes et larges, plus elles occupent d’espace, et plus elles s’élèyent
au-dessus de celles qui sont moins longues, moins larges et moins profondes
; de manière qu’un cerveau dont les parties intégrantes ont
acquis un développement inégal, offre à sa surface des enfoncemens ,
des parties planes et des protubérances.
Tel épanouissement d’un faisceau nerveux ou d’un organe, n’est plié
qu’en une circonvolution, d’autres en forment plusieurs.
Les plis ou les circonvolutions n’affectent pas toutes la même direction.
Les uns ont une direction droite d’avant en arrière, d’autres se
dirigent transversalement d’en haut vers le côté, d’autres encore ont
une direction oblique ; presque toutes vont un peu en serpentant ;
quelques-unes forment des pyramides, d’autres se contournent en spirale,
etc. Les formes fondamentales de ces circonvolutions sont les
mêmes dans tous les cerveaux humains, et elles sont congruentes dans
les deux hémisphères du même encéphale; en un mot, elles sont symétriques.
Dans les petits cerveaux, comme ceux du chien, du cheval, du
boeuf, du mouton, etc., cette symétrie est parfaite; chez l’homme, de
petites divisions varient dans leurs formes. (Planche III et XIV}.
Toutes les formes des divisions principales, lorsque ces dernières ont
acquis un grand développement, se prononcent sur le crâne sous le
même type. Delà, les différentes formes, et les différentes directions
des organes que j’ai dessinés sur la surface du crâne.
Ceci explique le rapport ou la correspondance qui existe entre la
craniologie et l’organologie, ou la doctrine des fonctions du cerveau,
( physiologie cérébrale } ; but unique de mes recherches.
Comment peut-on prouver que, tant la surface externe, que la surface
interne du crâne offrent l ’empreinte fidèle de la surface extérieure du
cerveau, et deviennent par conséquent le moyen principal, non-
seulement pour découvrir les forces primitives de l’ame, mais encore
pour déterminer le siège de leurs organes?
Depuis plus de vingt ans que j’enseigne publiquement cette vérité
si j’excepte quelques-uns de mes auditeurs, qui ont fait imprimer mes
leçons, peu d’auteurs y ont fait attention. Galien dit déjà que le crâne
se moule sur le cerveau, et nullement le cerveau dans le crâne '. Du
Laurens1 et Diemerbrock % enseignoient la même chose dans le courant
du dix-septième siècle. Fischer a écrit, en 1743, un traité particulier
sur cette-matière 4. Lavaters et M. Blumenbach, à qui j’emprunte ces
observations, en sont également persuadés. M. Spurzheim l ’a prouvé
très au long dans son ouvrage6, et nous avons fait insérer, dans le
dictionnaire des sciences médicales 7, un court article sur ce sujet.
Comme cet objet est non-seulement d’une importance majeure pour
l’organologie, mais que c’est même un point absolument essentiel pour
cette doctrine , j’en traiterai avec plus d’étendue qu’on ne l’a fait jusqu’ici,
et je le considérerai sous tous les points de vue offerts tant par
l’état de santé que par l’état de maladie.
ylpperçu de l’ostéologie du crâne, en tant qu’elle est nécessaire
pour que l’on puisse comprendre l’injluence
que le cerveau exerce sur cette partie osseuse.
L ’organologiste, en examinant les formes du crâne, n’a pas d’autre
but que de déterminer le degré de développement des parties cérébrales.
Par conséquent, il n’y a que les parties du crâne dont la forme dépend
du cerveau, qui aient une signification pour lui. La mâchoire^, tant
supérieure qu’inférieure, les procès mastoïdiens et autres proéminences
1 De usu partiüm, lib. VIII.
a Historia anatomiæ, p. 13g.
5 Anat. corp. humaui, p. 524.
* Dissert, de modo quo ossa se vicinis accommodant partibus. Lugduni
Batav., 1743.
5 Physiogn. Fragmente, T. I I, p. i 65.
4 Tbe pbysionomical System, p. 217 et suir.
7 Tome V I I , p. 260 et suiv.