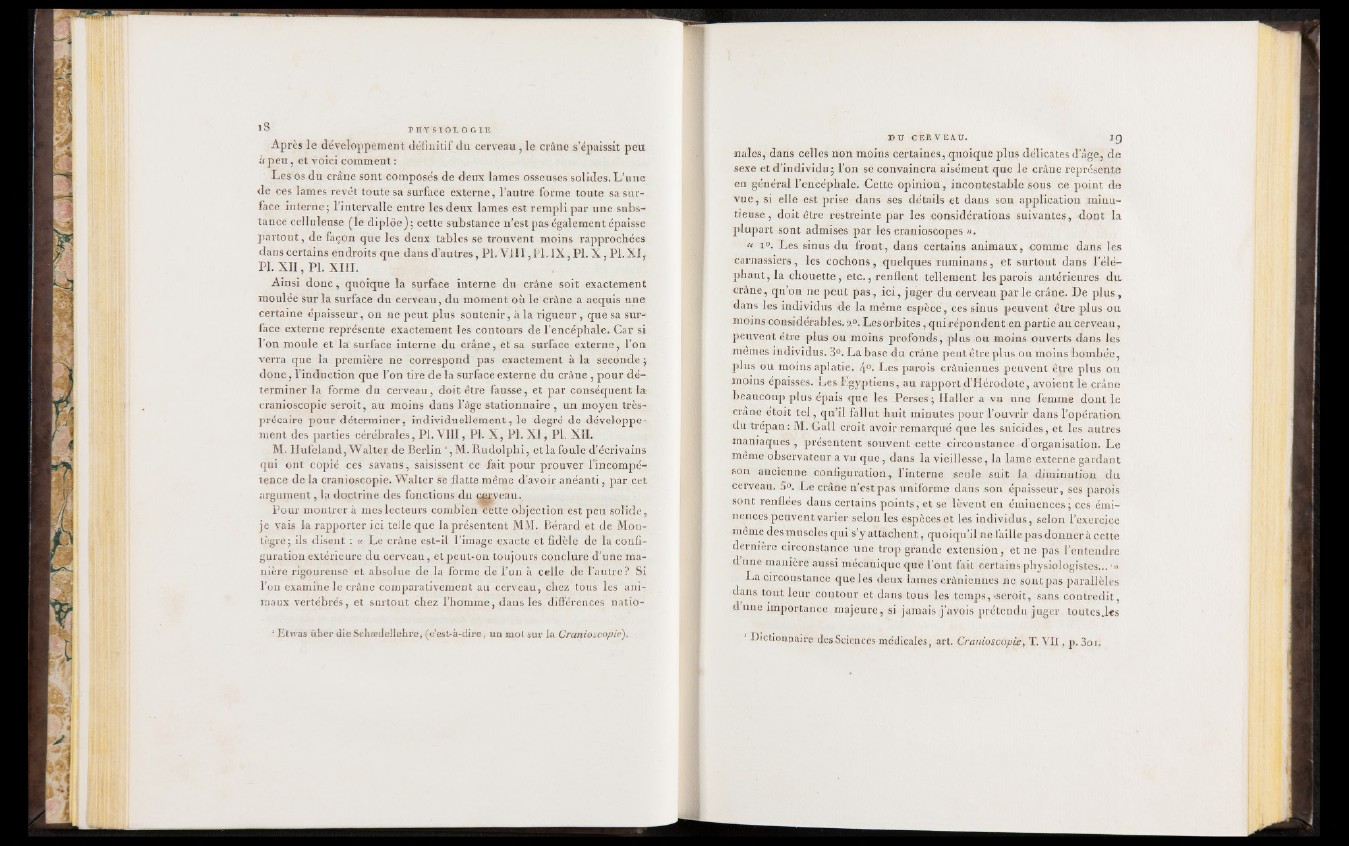
Après le développement définitif du cerveau, le crâne s’épaissit peu
à peu, et voici comment :
Les os du crâne sont composés de deux lames osseuses solides. L ’une
de ces lames revêt toute sa surface externe, l’antre forme toute sa surface
interne; l’intervalle entre les deux lames est rempli par une substance
celluleuse [le diplôej; cette substance n’est pas également épaisse
partout, de façon que les deux tables se trouvent moins rapprochées
dans certains endroits que dans d’autres, PI. V II I, PI. IX , PL X , PL XI,
Pl. X II, Pl. XIII.
Ainsi donc, quoique la surface interne du crâne soit exactement
moulée sur la surface du cerveau, du moment où le crâne a acquis une
certaine épaisseur, on ne peut plus soutenir, à la rigueur , que sa surface
externe représente exactement les contours de l’encéphale. Car si
l ’on moule et la surface interne du crâne, et sa surface externe, l’on
verra que la première ne correspond pas exactement à la seconde ;
donc, l’induction que l’on tire de la surface externe du crâne , pour déterminer
la forme du cerveau, doit être fausse, et par conséquent la
cranioscopie serait, au moins dans l’âge stationnaire , un moyen très-
précaire pour déterminer, individuellement, le degré de développement
des parties cérébrales, Pl. VIII, Pl. X , Pl. XI, PL XII.
M. Hufeland, Walter de Berlin 1 ,M. Rudolphi, et la foule d’écrivains
qui ont copié ces savans, saisissent ce fait pour prouver l’incompétence
de la cranioscopie. Walter se flatte même d’avoir anéanti, par cet
argument, la doctrine des fonctions du ç^r.veau.
Pour montrer à mes lecteurs combien cette objection est peu solide,
je vais la rapporter ici telle que la présentent MM. Bérard et de Mon-
tègre; ils disent : « Le crâne est-il l ’image exacte et fidèle de la configuration
extérieure du cerveau, et peut-on toujours conclure d’une manière
rigoureuse et absolue de la forme de l’un à celle de l ’autre? Si
l’on examine le crâne comparativement au cerveau, chez tous les animaux
vertébrés, et surtout chez l’homme, dans les différences natio-
‘ Etiras über die Sehædellehre, (c’est-à-dire, un mot sur la Cranioscopie).
nales, dans celles non moins certaines, quoique plus délicates d’âge, de
sexe et d’individu ; l’on se convaincra aisément que le crâne représente
en général l’encéphale. Cette opinion, incontestable sous ce point de
vue, si elle est prise dans ses détails et dans son application minutieuse
, doit être restreinte par les considérations suivantes, dont la
plupart sont admises par les eranioscopes »,
« i°. Les sinus du front, dans certains animaux, comme dans les
carnassiers, les cochons, quelques ruminans, et snrtout dans l ’éléphant,
la chouette, etc., renflent tellement les parois antérieures du
crâne, qu’on ne peut pas, ici, juger du cerveau par le crâne. De plus,
dans les individus de la même espèce, ces sinus peuvent être plus ou
moins considérables. 2°. Les orb Êtes, qui répondent en partie au cerveau,
peuvent être plus ou moins profonds, plus ou moins ouverts dans les
mêmes individus. 3°. La base du crâne peut être plus ou moins bombée,
plus ou moins aplatie, 4°- Les parois crâniennes peuvent être plus ou
moins épaisses. Les Egyptiens, au rapport d’Hérodote, avoient lé crâne
beaucoup plus épais que les Perses ; Haller a vu une femme dont le
crâne étoit te l, qu’il fallut huit minutes pour l’ouvrir dans l’opération
du trépan: M.Gall croit avoir remarqué que les suicides, et les autres
maniaques , présentent souvent cette circonstance d'organisation. Le
meme observateur a vu que, dans la vieillesse, la lame externe gardant
son ancienne configuration, l’interne seule suit la diminution du
cerveau. 5°. Le crâne n’est pas uniforme dans son épaisseur, ses parois
sont renflées dans certains points, et se lèvent en éminences ; ces éminences
peuvent varier selon les espèces et les individus, selon l’exercice
meme des muscles qui s’y attachent, quoiqu’il ne faille pas donner à cette
dernière circonstance une trop grande extension, et ne pas l’entendre
d une manière aussi mécanique que l’ont fait certains physiologistes... '»
La circonstance que les deux lames crâniennes ne sontpas parallèles
dans tout leur contour et dans tous les temps, «serait, sans contredit,
dune importance majeure, si jamais j’avois prétendu juger toutes.l«s
' Dictionnaire des Sciences médicales, art. Cranioscopie, T. V I I , p. 3oi,