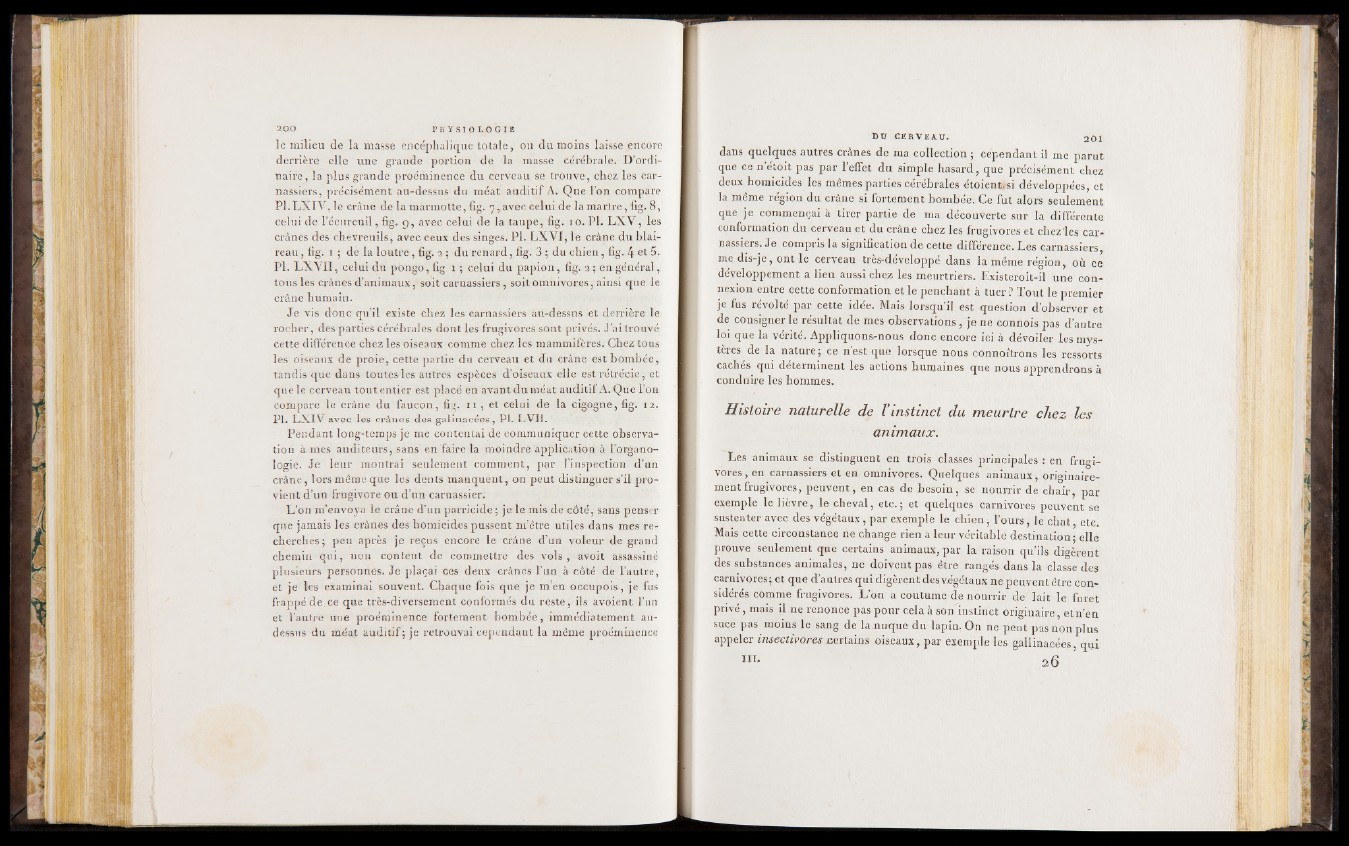
le milieu de la masse encéphalique totale, ou du moins laisse encore
derrière elle une grande portion de la masse cérébrale. D’ordinaire,
la plus grande proéminence du cerveau se trouve, chez les carnassiers,
précisément au-dessus du méat auditif A. Que l’on compare
PI.LXIV, le crâne de la marmotte, fig. 7, avec celui de la martre, fig. 8,
celui de l’écureuil, fig. g , avec celui de la taupe, fig. 10. PI. LX V , les
crânes des chevreuils, avec ceux des singes. PI, LXVI, le crâne du blaireau
, fig. 1 ; de la loutre, fig. 2 ; du renard, fig. 3 ; du chien, fig. 4 et 5.
PI. LXYI1, celui du pongo, fig 1 ; celui du papion, fig. 2 ; en général,
tous les crânes d’animaux, soit carnassiers, soit omnivores, ainsi que le
crâne humain.
Je vis donc qu’il existe chez les carnassiers au-dessus et derrière le
rocher, des parties cérébrales dont les frugivores sont privés. J’ai trouvé
cette différence chez les oiseaux comme chez les mammifères. Chez tous
les oiseaux de proie, cette partie du cerveau et du crâne est bombée,
tandis que dans toutes les autres espèces d’oiseaux elle est rétrécie, et
que le cerveau tout entier est placé en avant du méat auditif A. Que l’on
compare le crâne du faucon, fig. 11 , et celui de la cigogne, fig. 12.
PI. LXIV avec les crânes des galinaeées, PI. LVII.
Pendant long-temps je me contentai de communiquer cette observation
à. mes auditeurs, sans en faire la moindre application à l’organologie.
Je leur montrai seulement comment, par l’inspection d’un
crâne, lors même que les dents manquent, on peut distinguer s’il provient
d’un frugivore ou d’un carnassier.
L ’on m’envoya le crâne d’un parricide; je le mis de côté, sans penser
que jamais les crânes des homicides pussent m’être utiles dans mes recherches;
peu après je reçus encore le crâne d’un voleur de grand
chemin qui, nou content de commettre des vols , avoit assassiné
plusieurs personnes. Je plaçai ces deux crânes l’un à côté de l’autre,
et je les examinai souvent. Chaque fois que je m’en occupois, je fus
frappé de ce que très-diversement conformés du reste, ils avoient l'un
et l’autre une proéminence fortement bombée, immédiatement au-
dessus du méat auditif; je retrouvai cependant la même proéminence
dans quelques autres crânes de ma collection ; cependant il me parut
que ce n étoit pas par l’effet du simple hasard, que précisément chez
deux homicides les mêmes parties cérébrales étoientisi développées, et
la même région du crâne si fortement bombée. Ce fut alors seulement
que je commençai à tirer partie de ma découverte sur la différente
conformation du cerveau et du crâne chez les frugivores et chez’les carnassiers.
Je compris la signification de cette différence. Les carnassiers,
me dis-je, ont le cerveau tres-developpé dans la même région, où ce
développement a lieu aussi chez les meurtriers. Existeroit-il une connexion
entre cette conformation et le penchant à tuer? Tout le premier
je fus révolté par cette idée. Mais lorsqu’il est question d’observer et
de consigner le résultat de mes observations, je ne connois pas d’autre
loi que la vérité. Appliquons-nous donc encore ici à dévoiler les mystères
de la nature; ce nest que lorsque nous connôîtrons les ressorts
caches qui déterminent les actions humaines que nous apprendrons à
conduire les hommes.
Histoire naturelle de l’instinct du meurtre chez les
animaux.
Les animaux se distinguent en trois classes principales ; en frugivores,
en carnassiers et en omnivores. Quelques animaux, originairement
frugivores, peuvent, en cas de besoin, se nourrir de chair, par
exemple le lièvre, le cheval, etc.; et quelques carnivores peuvent se
sustenter avec des végétaux, par exemple le chien, l’ours, le chat etc.
Mais cette circonstance ne change rien à leur véritable destination; elle
prouve seulement que certains animaux, par la raison qu’ils digèrent
des substances animales, ne doivent pas être rangés dans la classe des
carnivores; et que d’autres qui digèrent desvégétaux ne peuvent être considérés
comme frugivores. L ’on a coutume de nourrir de lait le furet
privé, mais il ne renonce pas pour cela à son instinct originaire et n’en
suce pas moins le sang de la.nuque du lapin. On ne peut pas non plus
appeler insectivores certains oiseaux, par exemple les gallinaeées, qui
n i * 26