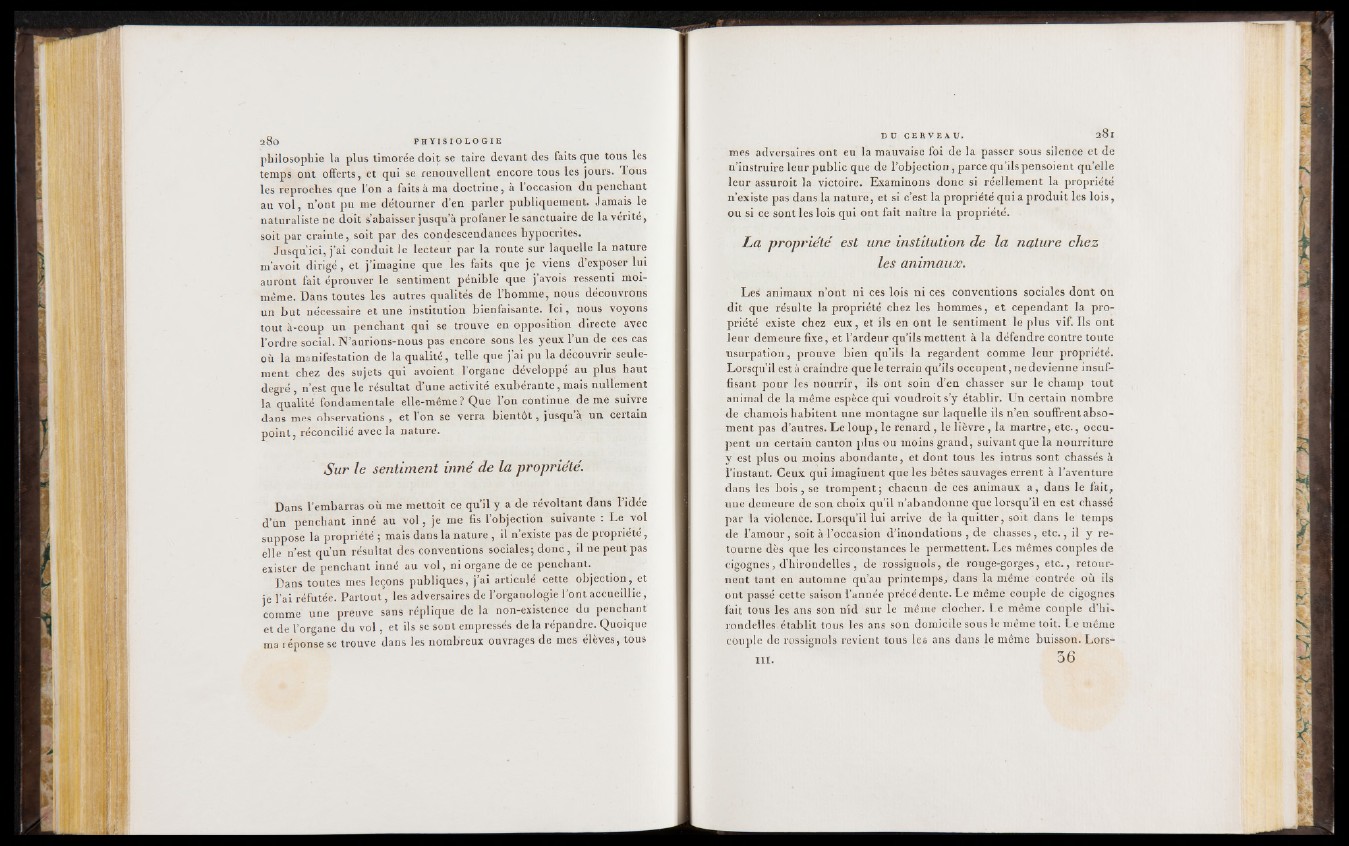
280 P H Y I S I O L O G I E
philosophie la plus timorée doit se taire devant des faits que tous les
temps out offerts, et qui se renouvellent encore tous les jours. Tous
les reproches que l’on a faits à ma doctrine, à 1 occasion du penchant
au vol, n’ont pu me détourner d’en parler publiquement. Jamais le
naturaliste ne doit s’abaisser jusqu’à profaner le sanctuaire de la vérité,
soit par crainte, soit par des condescendances hypocrites.
Jusqu’ici, j’ai conduit le lecteur par la route sur laquelle la nature
m’avoit dirigé, et j’imagine que les faits que je viens d’exposer lui
auront fait éprouver le sentiment pénible que j’avois ressenti moi-
même. Dans toutes les autres qualités de l’homme, nous découvrons
un but nécessaire et une institution bienfaisante. Ici, nous voyons
tout à-coup un penchant qui se trouve en opposition directe avec
l’ordre social. N’aurions-nous pas encore sous les yeux l’un de ces cas
où la manifestation de la qualité, telle que j'ai pu la découvrir seulement
chez des sujets qui avoient l’organe développé au plus haut
degré , n’est que le résultat d’une activité exubérante, mais nullement
la qualité fondamentale elle-même? Que l’on continue de me suivre
dans mes observations , et l’on se verra bientôt, jusqu’à un certain
point, réconcilié avec la nature.
Sur le sentiment inné de la propriété.
Dans l’embarras où me mettoit ce qu’il y a de révoltant dans 1 idee
d’un penchant inné au v o l, je me fis l’objection suivante : Le vol
suppose la propriété ; mais dans la nature , il n’existe pas de propriété,
elle n’est qu’un résultat des conventions sociales; donc, il ne peut pas
exister de penchant inné au vol, ni organe de ce penchant.
Dans toutes mes leçons publiques, j’ai articulé cette objection, et
je l'ai réfutéë. Partout, les adversaires de l’organologie l’ont accueillie,
comme une preuve sans réplique de la non-existence du penchant
et de l’organe du v o l, et ils se sont empressés delà répandre. Quoique
ma réponse se trouve dans les nombreux ouvrages de mes eleves, tous
mes adversaires ont eu la mauvaise foi de la passer sous silence et de
n’instruire leur public que de l’objection , parce qu’ils pensoient quelle
leur assuroit la victoire. Examinons donc si réellement la propriété
n’existe pas dans la nature, et si c’est la propriété quia produit les lois,
ou si ce sont les lois qui ont fait naître la propriété.
La propriété est une institution de la nature chez
les animaux.
Les animaux n’ont ni ces lois ni ces conventions sociales dont on
dit que résulte la propriété chez les hommes, et cependant la propriété
existe chez eux, et ils en ont le sentiment le plus vif. Ils ont
leur demeure fixe, et l’ardeur qu’ils mettent à la défendre contre tonte
usurpation, prouve bien qu’ils la regardent comme leur propriété.
Lorsqu’il est à craindre que le terrain qu’ils occupent, ne de vienne insuffisant
pour les nourrir, ils ont soin d’en chasser sur le champ tout
animal de la même espèce qui voudroit s’y établir. Un certain nombre
de chamois habitent nne montagne sur laquelle ils n’en souffrent abso-
ment pas d’autres. Le loup, le renard , le lièvre , la martre, etc., occupent
un certain canton plus ou moins grand, suivant que la nourriture
y est plus ou moins abondante, et dont tous les intrus sont chassés à
l’instant. Ceux qui imaginent que les bêtes sauvages errent à l’aventure
dans les bois, se trompent; chacun de ces animaux a, dans le fait,
une demeure de son choix qu’il n’abandonne que lorsqu’il en est chassé
par la violence. Lorsqu’il lui arrive de la quitter, soit dans le temps
de l’amour, soit à l’occasion d’inondations , de chasses, etc., il y retourne
dès que les circonstances le permettent. Les mêmes couples de
cigognes, d’hirondelles , de rossignols, de rouge-gorges, etc., retournent
tant en automne qu’au printemps, dans la même contrée où ils
ont passé cette saison l’année précédente. Le même couple de cigognes
fait tous les ans son nid sur le même clocher. Le même couple d’hirondelles
établit tous les ans son domicile sous le même toit. Le même
couple de rossignols revient tous les ans dans le même buisson. Lorsm
. 56
m.;/!£ & ? * * * £ .# _7T’y 1» j'j k ■ fy*