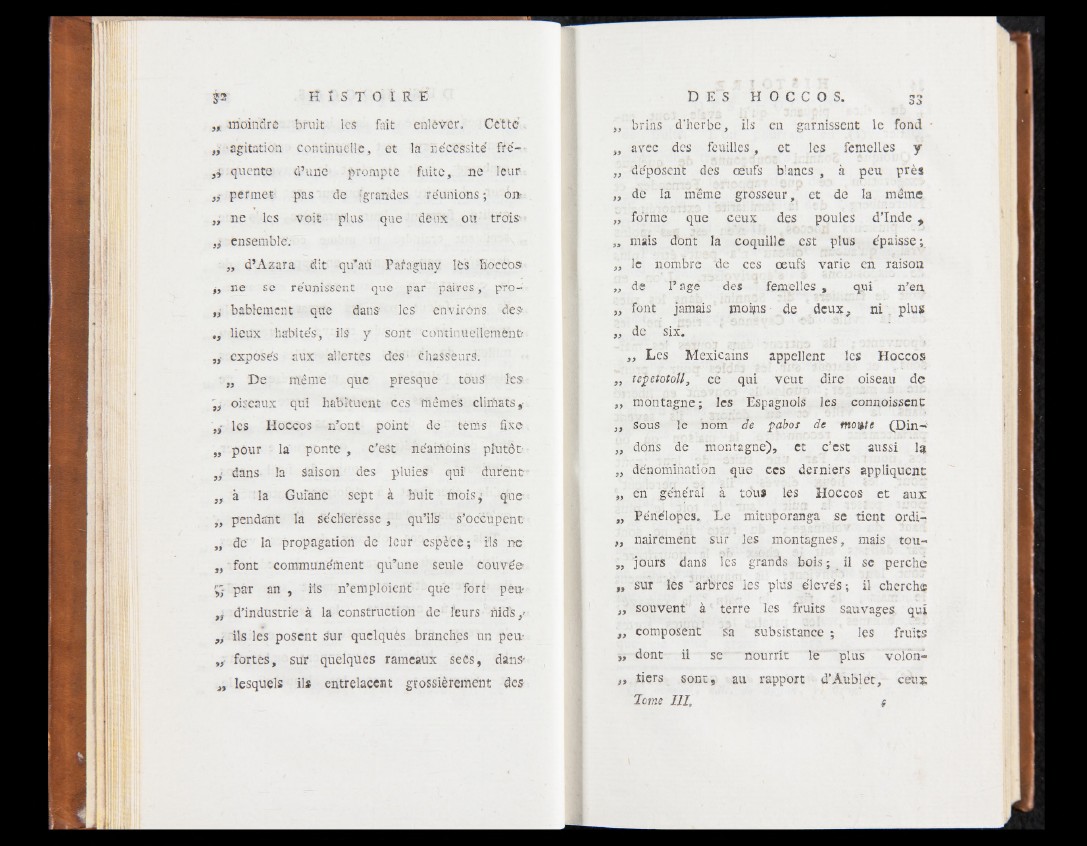
S2 H I S T O I R E
moindre bruit les fait enlever. Cè'ttc
b agitation continuelle, et la nécessité fré-
& quente d’ une prompte fuite, ne leur
« permet pas de [grandes réunions ; onne
les voit plus que deux ou trois
si ensemble'
„ d’Azara dit qu’au Paf aguay lés hoccos
b ne sc réunissent que par paires, pro-
„ bablement qtïe dans' les environs des
., lieux habités, ils y sont continuellement
,, exposés aux aller tes des chasseurs.
„ De même que presque ton S les
9i oiseaux qui habituent ces mêmes climats,-
,, les Hoccos n’ont point de tèms fixe
„ pour la ponte , c’est néanmoins plutôt
dans la Saison des pluies qui durent
,, à la Guîane sept à huit mois,- que
„ pendant la Sécheresse , qu’ils’ s’occupent
„ de la propagation de leur espèce ; ils ne
„ • font communément qu’ une seule couvée-
'f- par a n , ils n’emploient que fort peu*
„ d’industrie à la construction de leurs nids,*
ils les posent sur quelques branches un peu-
,, fortes, sur quelques rameaux sees, dans-
„ lesquels ils entrelacent grossièrement des
D E S H O C C O S . •y *>
O ù
„ brins’ d’herbe, ils en garnissent le fond
„ avec des feuilles, et les , femelles y
,, déposent des oeufs blancs , à peu près
„ de la même grosseur, et de la même
„ forme que ceux des poules d'Inde,
„ mais dont la coquille est plus épaisse;
„ le nombre de ces oeufs varie en raison
„ de F âge des femelles , qui n’en,
„ font jamais moijis de deux, ni ; plus
„ de six.
„ Les Mexicains appellent les Hoccos
„ fepetotoll, ce qui veut dire oiseau de
,, montagne; les Espagnols les connoissenC
„ sous le nom de pabos de mo&tc (Din—'
,, dons de montagne), et c’est aussi la
„ dénomination que ces derniers appliquent
„ en général à tous les Hoccos et aux
„ Pénélopes. Le mituporanga se tient ordi-
„ nairement sur les montagnes, mais tou-
„ jours dans les grands bois ; il se perche
„ sur les ‘ arbres les plus élevés; il cherche
„ souvent à terre les fruits sauvages, qui
,, composent sa subsistance ; les fruits
„ dont il se nourrit le plus volôn-
„ tiers sont, au rapport d’Aublec, ceux
Tome III, ç