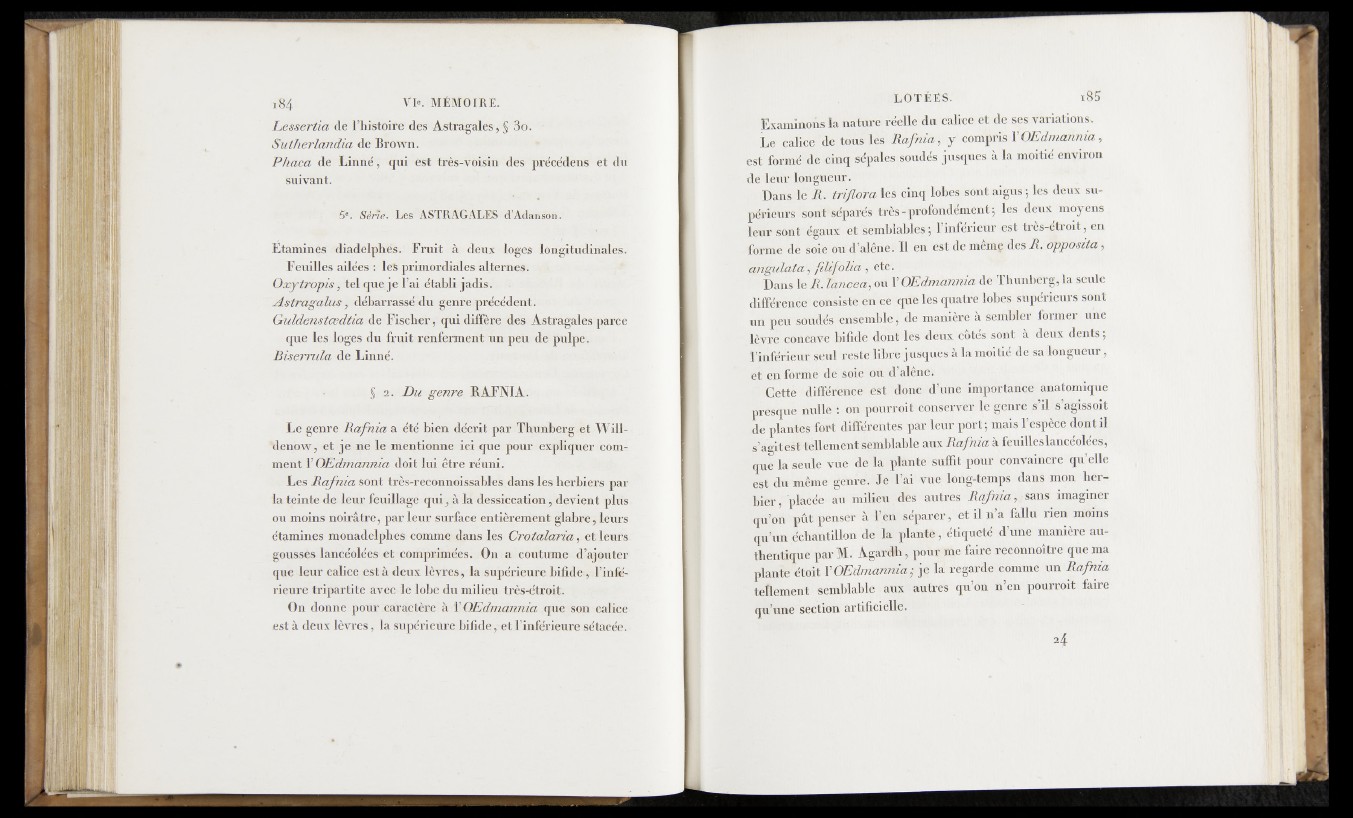
184 VI«. wamamamm
Lesse/tfiAdé^rhistoire* désAétragales', ^ ‘ô1. /s*
SUthmî$W0 e$§Êk Brown.j
P hm à de ' Linnéy ;qui èStë très-voisin^ d^prëcédens1® du
suivant.
'5fe. 'Sl/%. -LësJ%VSîi'Iy]S^fVii3^^â’Adaïi§'éfl.'
Etamines' diàdelphés.' Eruit à, deux loge® lônigitudinales.
FeuilMsiairlëe's'^ les primordiales alternes.
Qapytropis, tel que jieil’ai établi jadis.
AàtpcbgaMs ,v?débarrasséidu genre,précédent : -
Guldemsièecltia fde Fischery, <|ùd diffère desi; Astragales-parc e
que les loges du. fruit* renfermerïHun peu* dé? pulpe*..
BiserrulM diMLinné. -
D u <genpe RAFNIA.
Le genre RafhzaW È^ bien décrit par Thumbergï|it.W i 11-
Henibwj, et je ne.de-mentionne ici que. poujr'expliquer comment
FGEmnàrmicb 'dditUuiplre réuni.
^Rfes : E afm a «ont très-reconméissables dans lés herbiers par
la tpinte deJeur feuillage qui, à lâjvde^s^;cation ^ e# e n t plus
ou moins noirâtre, par leur surface entièrement glabre, leurs
étamines monadelphes commc^îdans les Gr&t'evluTiu ÿ etdeurs
gousses lancéolées et ^comprimées. On - ajj coûtujMe^ d^jouter
que leur cabeepst à deux lèvjfces,y- la supérieure bifider,t,L’infié-
rieure tripar.tite.av.ec4e lobe du-milieu très-étroits I
On donne pour .cAaptèreArl’ OEdmammez .que -son calice
est à deux lèvres, la supérieure bifide.,” et rinfèriéure.»sëtacée. •
LOTÊËS. iB5
' Examinons la natureVrëelédu calice et de. ^ v a r ia tio n s ,
Le c â îâÀ e ito ù â ie^ RizfâM % j'com ;pis YOEdmannia,
fet'4ôKîhé£devcin|fsëpaltes^oud jks'q^e^-ai^ moitié enyiron
DafÉ le Ginq.'lobeskdntfàigm'à^ les deux supérieurs
^soîifcpa^sC'fer'è's - profondément ; les^leux moyens
leur l^ ^ ^ f e i f c e t t ib î a b l e s } lu f if fïïe h r g t 'très-etroit, en
-formé d è i% ^ o û d ’^ p | Il ën^ fe fe mêmg des B . âppdéta >
*f''n i {> ' ' i
b- ou r ‘0 ^ ^ r e p ^ 'd # 4 h u n b é r g , la seule
i d iffèWx flêlî^ iË ÿ êi^® qb'e les quatréfoll^supérieurs sont
un peu^ètiïdé^énsèmble ,,%te manière à sembler former une
bifide d o n t ® - deux dents*,
j^ P® 3^ 3- moitié É | sa longueur,
WlcreSëfàtiffliir^d’une importance; anatomique
’ 'pesijue nulle : on p o à r r li^ cW e^M V ^ ë îir è 's ’il s’agissoit
de planfëstfok dîÉ^rentes^parlfep'port *, mais l f ë s f l^ | n t il
ataxMkfâiiâ effeuilles lanceolees,
H k sëd fë fSè "de la plante suffit pour convaincre qu’elle
ek. d h 'm im ën ^%W e l ’ai vue long-temps dans îffito ffier-
b i e r ^ ’l^ é è ' - au milieu -dfes sÉuft^ Rdfrâa^ sâns imaginer
qu’on p û ^ ^ s ^ à +’om^éparer ,’Jèt il n’a fallu tien moins
qu’un échantillon de 5 la- plante, étiqueté d’une manière au-
thentique par M. A g a r ih , pour Me fffiiçèireconnoitré que ma
' plahlî^toit Y D E d m a m i^ e 6 regarde comme un E afkm
tellement semblable aux autres qu’on n’en pourvoit faire
qu’une section artificielle.