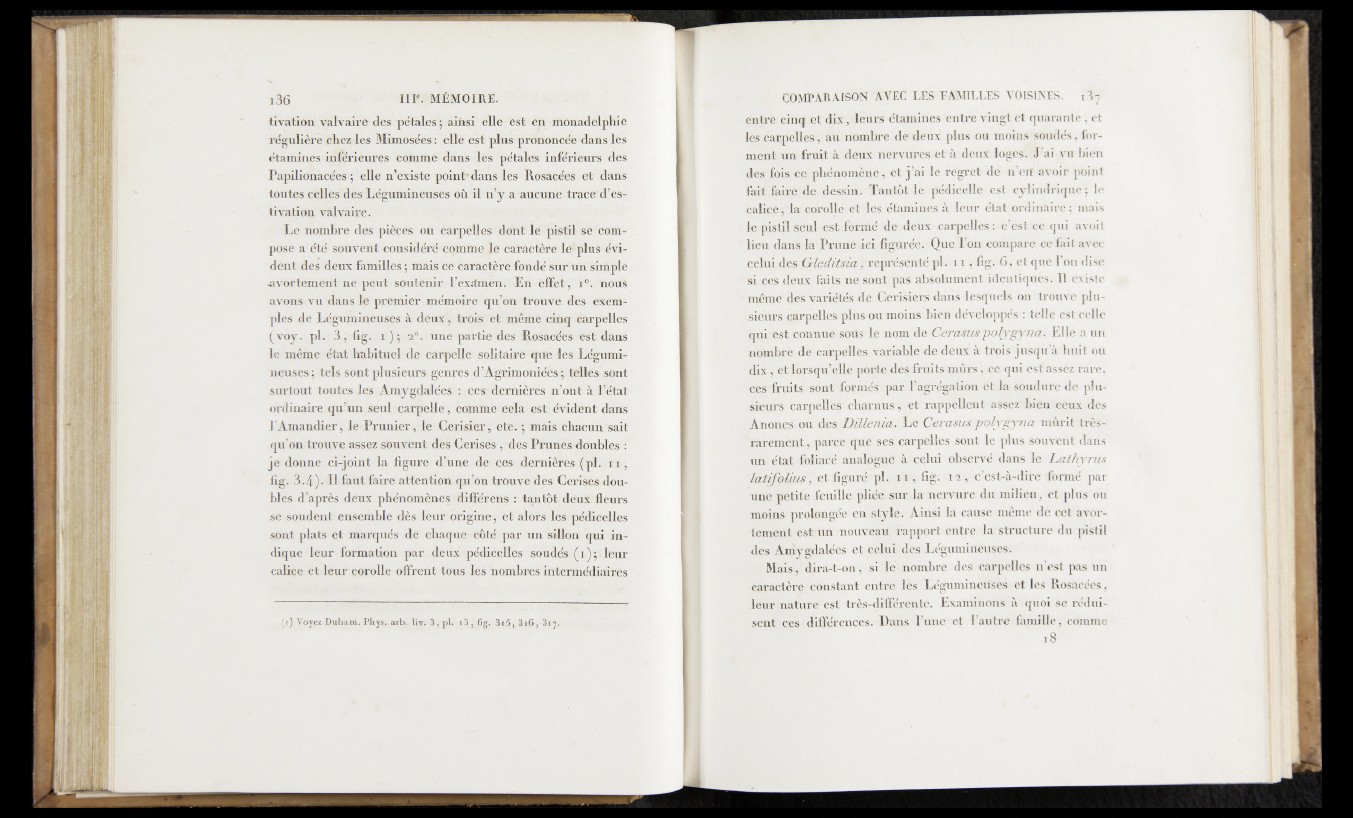
tivation valvaire des pétales'yaifisi .elle est en monadè'lphie
régulière chezdes M-imosées: elle est plus prÔlà'Ônceë dans les
étamines-inférieures comnmdans dés''■ pétales inférieurs’ des
Papiliônacées j eïlë n’existe poin#dans des Rosâfcé^ et ;;daûs
toutes celles’des Légumineuses' où il n’y a auGutte trâce*(fesy
tivation valvaire.
Le nombre des^piè’cès ou carpellè<s*';dôRl?4ë ‘pistil‘ sè^'ÔTH»
pose ni;#é’ souven t "considéré ’comme jte caractère’ leiplùs-*evi-
dëhtdésdeüx familles ; mais cé’cafrâbtèrë fondé sur un'Siifi^ië.
nvortement ne peut soutenir l ’examen. Ln^Me£i|^v?n^^
âvons vu dans le premier .mémoire qu’on trouvé dlêS 'Oèêïri^
pies de Légumineus^à* deux 'trois' et'mêrtie Gèffq 4£fcrp!eH#
(vo y. pl. 3.; fig . i*)^ à°. une p a r t i e è s t , Idràns
le même état habituel de catfpelhr solitaire quelles Légumineuses
; tels sont plusieurs genres d’Àgrimon'î^^ telles çSïftit
surtout toutes les Àmy gdalées.. jg - qes* dsemèèrés n’ont àH^tat
ordinaire qu’un Seul carpelle I comme éVidfênt dàhs
1 Amandier, le -Prunier, le Cerisier, ete*. 5 mais.ohacun^Sait
qu’on trouve assez souvent dé&Gefclsfé'ss^es Prunésf#dubles :
je donne ci-joint la figure d’une- de qes *dernièreSt'| p l . : t i ,
fig. 3i.4).dl faut faire attention qu’on trouve djfs Gerises-dôn-
bles d’après deux phénomènes différens : tantôt; deux fleurs
se soudent ensemble dès leur origine, et alors-lesipédicelles
sont plats et marqués de chaque-côté par u n ‘siflon qui indique
leur - formation par . deux pédicelles soûdésï(^)^ileur
calice et leur corolle offrent tous les ’nombres intermédiaires
(î) Voyez Duharn. Phys. arb. liv. 3, pi. i3 , fig. 3i5 , 316 , 317.
COMPARAISON AVEC LES FAMILLES VOISINES. 137
entre cinq et dix, leurs étamines entre vingt et quarante, et
les carpelles, au nombre de deux plus ou moins soudés, forment
un fruit à deux nervures et à deux logés. J’ai vu bien
des fois ce phénomène, et j ’ai le regret de n ’en' avoir point
fait faire de dessin. Tantôt le pédicelle est cylindrique; le
calice, la corolle et les étamines à leur état ordinaire ; mais
le pistil seul est formé de deux carpelles : c’est ce qui avoit
lieu dans la Prune ici figurée. Que l ’on compare ce fait avec
celui des Grleditsia, représenté pl. 1 1 , fig. 6 , et que l ’on dise
si lëes deux faits né-sont pas absolument identiques. Il existe
‘même îjés variétés de Gerisiers dans lesquels on trouve plu-
tsi'é^s ^pirpelles plus ou moins bien développés : telle ëst celle
qui est connue sous le nom de G erasuspoljgyna. Elle a un
nombre de carpelles variable de deux à trois jusqu’à huit ou
dix, et lorsqu’elle porte des fruits mûrs ic e qui est assez rare,
ces fruits sont formés par l ’agrégation ét la- soudure de plusieurs
carpelles charnus, et rappellent assez bien ceux des
Ânones ou des D illen ia . Le Cerasus poljgyna- mûrit très-
rarement , parce que ses carpelles sont le plus souvent dans
un état foliaéé analogue: à celui observé dans le Lathyrus
la tif& là is, et figuré pl. n , fig. i a , c’est-à-dire formé par
une petite feuille pliée sur la nervure du milieu, et plus ou
moins prolongée en style. Ainsi la cause même de cet avortement
est un nouveau rapport entre la structure du pistil
des Amygdalées et celui des Légumineuses.
Mais, dira-t-on, si le nombre des carpelles n’est pas un
caractère constant entre les Légumineuses et les Rosacées,
leur nature est très-différente. Examinons à quoi sê réduisent
cès différences. Dans l ’une et l ’autre famille, comme
18