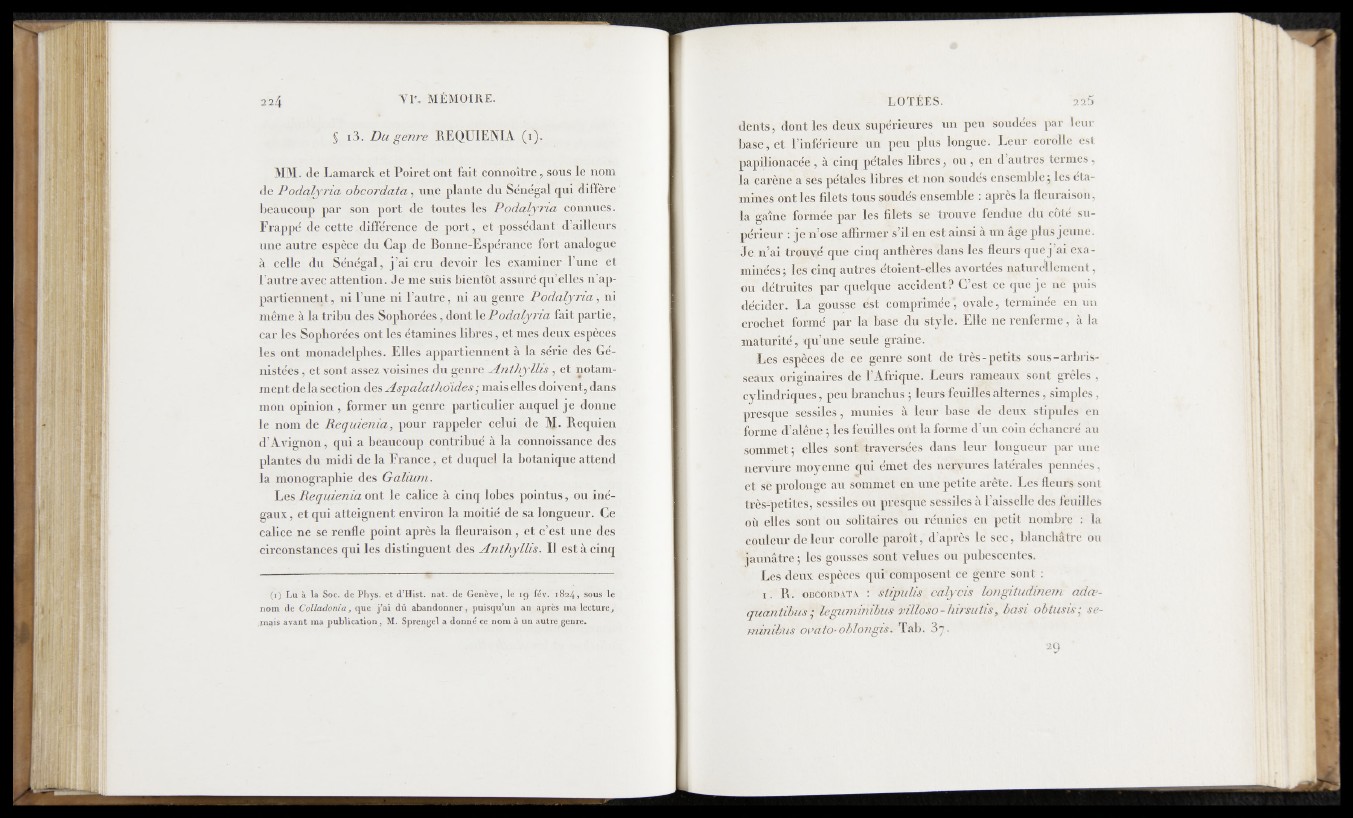
224 Y Ie. MÉMOIRE,
S i 3. genre REQUIENIÂ (i),
MM. de Lamarck et Poiret ont fait .connoître, sous llp iom
de Podqbyria obcordata, une plante du Sénégal qui diffère
beaucoup par son port de tou te lle s Podalyria connufe^
Frappé de cette ..différence de port , et -possédant' d’ailleurs
une autre espèce du Cap ,,de Bonne-Espéçanee fort analogue
à celle du Sénégal, j ’ai cru devoir les examiner l ’une ;et
l ’autre a$?ec .attention. Je me suis hientèt aSsmé_qu’.elle^ nun-
partienne^y ni l ’une ni l ’autre, nj»au genÉè.,Podalynuiram?
meme.à la tribu des Sophorées, dont 1 e-Ppâ^^riafait partie,
car les Sophorées ont les étamines libres, et mes deux eapècès
les ont monadelphes. Elles appartî('nnen| à la sëijir dos Cé-
nistées, et sont assez voisines ,du genrè^Antr ^ ^ è , et notamment
delà section des Aspalathoidesp mais elles doivent, dans
mon opinion, former un genre particulier auquel je JbniÉe
le nom de R equienia, pour rappeler cçlui de ]\J. Requien
d’ÀAÛgnon, qui a beaucoup contribué à la cOnnoissance des
plantes du midi de la France ? et duquel la botaniste attend
la monographie des Gaïium.
Les Requienia ont le calice, à cinq lobes pointus, ouiné^
gaux, et qui atteignent environ la moitié de sa longueur. «Ce
calice ne se renfle point après la fleuraison, ftt,c!e|t une des
circonstances qui les distinguent des AhthyÙ&.:\\ est à cinq (i)
( i) L u à la Soc. de Phys , e t d’Hist. -nat. de Genève, le_igf ïév p iS zp .t sous le
nom de Çolladonia, que j ’a i dû abandonner,, -puisqu’u n an après ma lecture,,
>m#is ayant ma p u b lic a t io n , M. Sprengel a donné çe nom è un autre Renr,e.
tOTÉES. 220
-dents, dont les deux supérieures un peu soudées par leur
base, et l ’inférieu^^ùn peu plus longue* Leur eorolle est
papiliônacéë, à cinq pétales libres, o u , en d’autres termes,
la |â|Mie%^s pétales libres et norisoudés ensemble -y les étamines
oift'Jes filets tods s|udés-ensemble : après la fleuraison,
la ga-iriê formée par ;les mets se trouve fendue du cote supérieur
: je n’dlp affirmer s’il en est ainsi à un âge plus jeune.
■ Se. n ’ai trouvé que cinq anthères^dans les fleuri que j ’ai examinées
j ï^ c in q irutré/'étOiênt-ellès aVcrtëes naturellement,
oiFdétruites par quelquédécidentf G’eSt..ce que je ne puis
décider,. La goUsseMsl 'coiùjulmée * qvale, terminée en un
'crochet Formé par la base du 'style. Elle Ue renferm|||à la
maturité, qu’ô t e fseule 'graine
LeÊ-:espëce|' de^eê genre soiit de” très-petits sous-arbris-'
if^ux'originaires de l ’Afrique. Leurs rameaux sont grêles ,
Cylindriques , peu branchus leurs feuilnS alternes, simples,
presque s ^ ^ & j munies à leur baséWë-deux stipulé^en.
rifor-me d’alêne ; les feuilles ont la forme d’uüfcôin écbancré au
sommet ; éîlës sonliraveTsées dans leur? longueur par une
nervure moyenne qui émet des nervures l'atérâles pennées,
e t sê prolonge au sommet* en une petite arête. Les fleudfesont
^très^petites', sessileS ou preâque sessiles à l ’aisselle des feuilles
où elles âont‘ou solitâires ou réunifS en petit nombre : la
couleur de leur corolle pkroît, d’après le sëc, blanchâtre ou
jaunâtre ; -les gousses sont velues ou pubéscentès.
f Ees deux espèces qui*composent ce gènte sont :
• i . R,-. ûïcôîtikïA r stipulis^ càlycis longitudïriem adoe~
-h ir su tîs^ a s i obtusis; se-
miniMs*odâtO’ oblongùslïàb. 3ÿ. : '