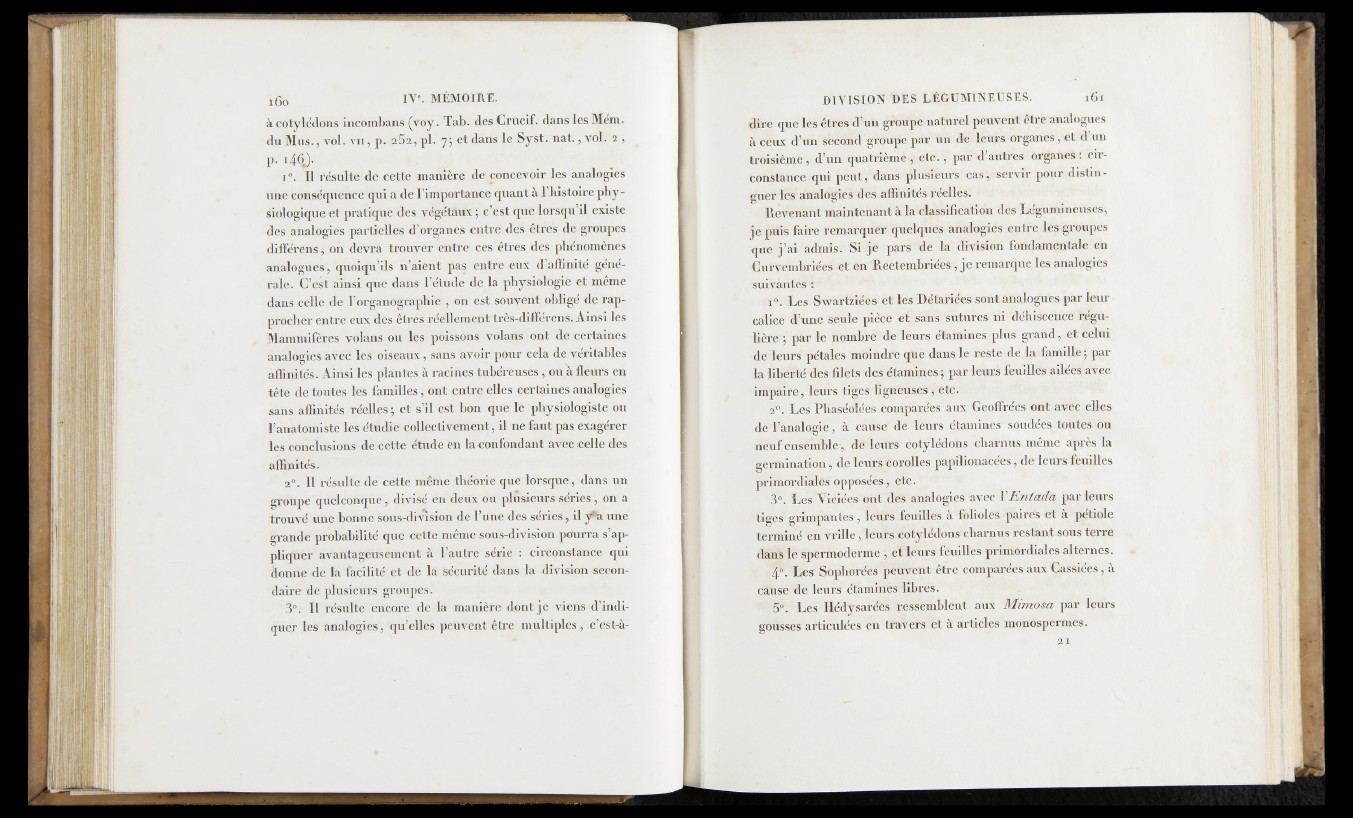
à cotylédons ineombans (Voy. Tab. des Crucif. dans les Mem.
du Mus., vol. vn, p. a&2, pl. 7', et dans le Syst. nat., votï'2.,
p. i 4^)<
II'résulte de cette manière de concevoir les analogies
une conséquence qui a de l’importance quant à Tbistoire physiologique
et pratique dés végétaux} c’est que lorsqu il existe
des analogies partielles d’organes entre des êtres de groupes,
différens, oh devra trouverëntrei-cës: êtres des phénomènes
analogues,' quoiqu’ils n’aient pas entre eux dtaipnité générale.
C’est ainsi que.daüs l’étlide de la physiologie et même
dans celle de Porganogràphie , on est souvent obligé de rapprocher
entre eux des êtres réellementtrès-di^ïerens^ Aâns#lèst
Mammifères volans ou les poissons^ volafe • ont delëè|taines
analogies avec les oileàhx, sans avoir pour fc<pf|de ^véritables
affinités. JKnsi les plantes à racines-tubéreuses $o#à fleurs eh
titè de toutes lfes familles fcent entre elles e^tednés anaîdgies
sans affinités réelles^ et s’il rest bon que lè physiMogjste ou
l’anatomiste .lesntudin-coUectivèment, il né faut:pàp:ex^gérèr
les conclusions de cette étude en la confondant avec celle des
affinités.
20. II résulte de cette même théorie que lorsque, dans un
gréUpe quelconque, divisé en deux ou plusieurs séries, <flÈoa
troüvé u n e bonne seus-division de l’une des séries ,' il ^fe«ne
^aridepr^Ébilité que cette même sous-division pourra s’appliquer
avantageusement 10 l’autre série :< circonstance qui
donne de la facilité et de la séeurité dans la division secondaire
de plusieurs groupes
t f 0. Il résulter<éncore de la manière dont je viens d’indiquer
lès analogies;, qu’elles peuvent être multiples >.e?éstudire
que les êtres d’un groupe»naturel peuvent être analogues
à clux d’un Sècônd grôupo pah un d'àleurs, organes, et d’un
troisième, d’uiàïjuatrièmê^l.ete- paé d’autres organes : fcir-
constàiîce’iqui jié^lysians' plusifffir'yeàsysêrvir pour distinguer
l^ ’analc^esdes affinités réellésb* ‘‘
Refëîfant maintenant à la clftssificatiou dès légumineuses,
je phïs faire i’emarquérquelques' analogie^ leptre les-groupes
qùe^j’ai admis. '?pà<#r^eîd i division fondamentale en
#urvembriéeS!>et ëK^MectembriéesS je remarque,k^anfedogies
;snivàntd$fw
ï °. Les Swai’fziéès et les"I>éta.riées sOntaSélogues par leur
f e l l ^ f e n e seule pïèce'ëh salê'^u tubes ffiélkhi&enoe Régulière
• par le nomlM*dfev; leurs étanïines^plus grandy*et%êîui
déiféUîp^pétalfes mèindre que dansde .reste de dp*;famil|ë'5 par
la lihèrté des filets des^étamines ; par lefeâ feuilPes-ailées-abep
impair ê .M r s tqfesf'ngnbfees ^tpY-r | *
|R ||. LesThaséaîefes ‘conf^téfesaux Gèoffrées^nt.aV’ee elles
d^nàlpgïe, aÏÆâ#së' d ÿ 'fe h t sÀ ou
neuf en^êhfble-, dê^led^ co^édobs^charnus mêin^Vprès ïa
germination ^ de ïeuy^%orGÎl’esffia|iïlio'riaÊées, dedêuWÉeuRles
primor dialês^p | àjsébs^ c fc '.^
Les'Vi-ciéès'-oÉl dë£ ahialqgie^veevr i? 72^siz( par leurs
tiges grimpaUteSs|^fâÈKSfèmlM§ à folioles .pairés^ét S pétiole
terminé envrille ,”'1 êübs;côtÿlédons^charnusrestant sous terre
dan's lë spèrfhoderme , et leurs feuilkàprimordiales alternes.
» Les^SophoréeS'pèiï^ëUti^re',1compâ'rêesaux Gassiéês’; à
cCuse de leurs étamihês^Iibres.
MjJ|i Ces Hédysaréèlïï®e'&sembléhf aux Mîlrh&êk par leurs
gousses articulées t f trajets* ët à articfes monospermes.