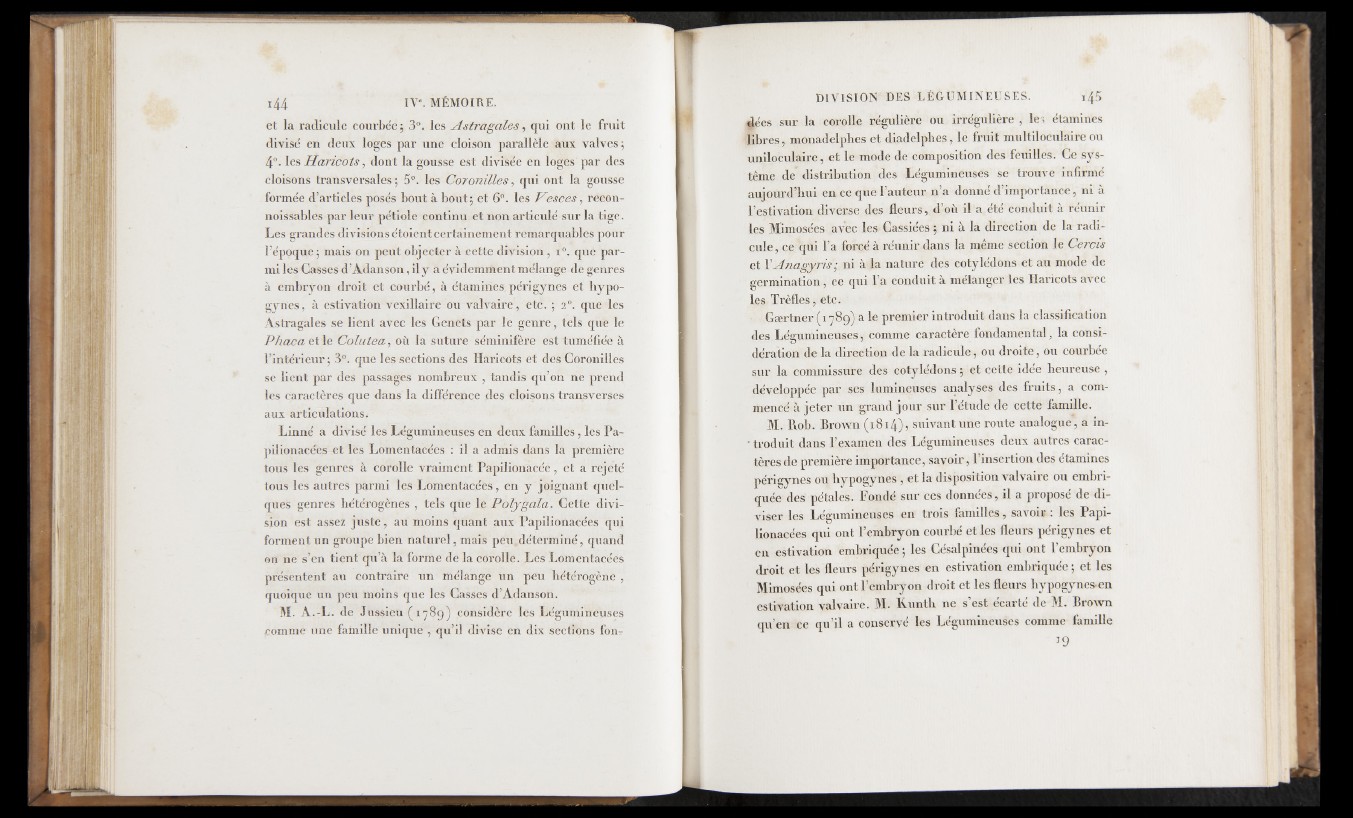
et la radicule courbe'é ^ 3°; \es Astragales. ■, qui ont le fruit
divisé ëii deux logespar une cloison parallèle'aux valves1'}
4°. les H a rico ts, dont la goiiSse est divisée en logés par des
cloisons transversales^ 5°. les G o ïon illes, qui ont la gousse
formée d'articles posés bout à bout} et 6 * -les rê%onnoissables
par leur pétiole eontinuèet non articulé sur la tige .
Les grandes divisions é toient certain cment remarquables pour
l ’époque; mais on peut.objecter àteètte t°. qué parmi
le^dsteseS d’Adanson, il ÿsa ëvideraAeül mélan^ dè ^feiÉèS
à embryon droit et courbé, à étamines,périgynes ^èt hypo-
gyteês;; à estivation vexillaire ou valvaireî^'etc.'^0. que les
Astragales se lient avec lë& .Genêts par Le.1 géh¥ë-, fiels què 1er
P h a ca et le Colut&a, où la suture séminifère estquméfil’ê*à
l ’in té rie« ; M. que Ies%ections des Haricots' ef deàCloronillës
se lient par dés passages nombreux , tandis qù’ëfrrie prend
les (ÿiractèrés que dans’ la différence des poisons trapsvers.es
aux articulations.-*
Linné a divisé lés Légumineuses en deux familles, lés Pa^
pilionacéés -et lès Lôménîacées : i l a ’admis .-dans la première
tous tes i^liis’és à corolle vraiment Papilionacée, et a'répété
tous lés autres parmi lesLbmentàcët;«“, en y ‘ jéignaht quéL
qué§ ’ genres hétérogènes , tels que le P olÿgm k. Cette division’est
assez jxistè, au moins quant aux PapilioAâcéés' qui
forment un groupe bien naturel, mais péu^déterminé, quand
on ne"'s’en tient qu’à la forme de la cOrolle. Les’ Lomeritacéés
présentent au contraire un mélange un peu hétérogène ,
quoique un pèu moins que les Casses d’Adansoh.
M. A .-L. de Jussieû (1789) considère lés Légumineuses
comme une famille unique , qu’il divise en dix sections fon?
i 45
Jees sur la corolle Bégulièreou, irrégulière | les étaminés
fibre s, mena<fel^«S-'e^4i^delphe$le fruit multiloculaire ou
uniloculaire, et le mode de composition dés feuilles. Ce système
de* distribution f^es sjîéguminëusés sé;: trouve infirmé
aujourd’hui e%cequè Fauteur, n’a donné d’importance, ni à
l ’e&tivation diverse des fleurs^dhù il aiëtéteonduit à réunir
les Maniosées ,avhcde»!Ëassiées^ni à là direction de lar radi-
cule, çp,^#i l ’a forcé à réunir.dans la même section le Çercis
et 1’ i à«$fca naturé1 deS‘ cotylédons »et au mode de
germinatiouï|me qui l’va conduit à mélanger "les Haricots avec
lj^ Trèfles ^étejj.' -
„.GærtneÈ riiÿBgiiJm le premier introduit-dans la classification
des. Légumineuses * comme caractère fondamental| la considération
de la direction de la radicule^ ou droite, ou courbée
sur la commissure des cotylédons ; et cette-idée heureuse ,
développée :par sés lumineuses analyse» des fruits, a com-
mencésà jeter lin grand jour ;sùr l ’étude de cettë famille.
M. Bob. Brown- (jB 14) ^suivant une route analogue , a in-
• troduit dans Pexaqien des Légumineuses deux autres caractères
de-première importancej^v°ir 5 l ’insertion des étamines
périgynes oiihypogynes, et la disposition valvaire ou embriquée
des pétales-Fondé sur ces données-^ il a proposé de diviser
les Légumineuses en trois familles, savoi*: les Papi-
lionacées qui ont l ’embryon courbé et les fleurs périgynes et
en estivation embriquée ; les Césalpinées qui ont l ’embryon
droit et les fleurs périgynes en estivation embriquée ; et les
Mimosées qui ont l ’embryon droit et les fleurs hypogynes>en
estivation valvaire. M. Runth ne s’est écarté de M. Brown
qu’en æe qu’il a conservé les Légumineuses comme famille