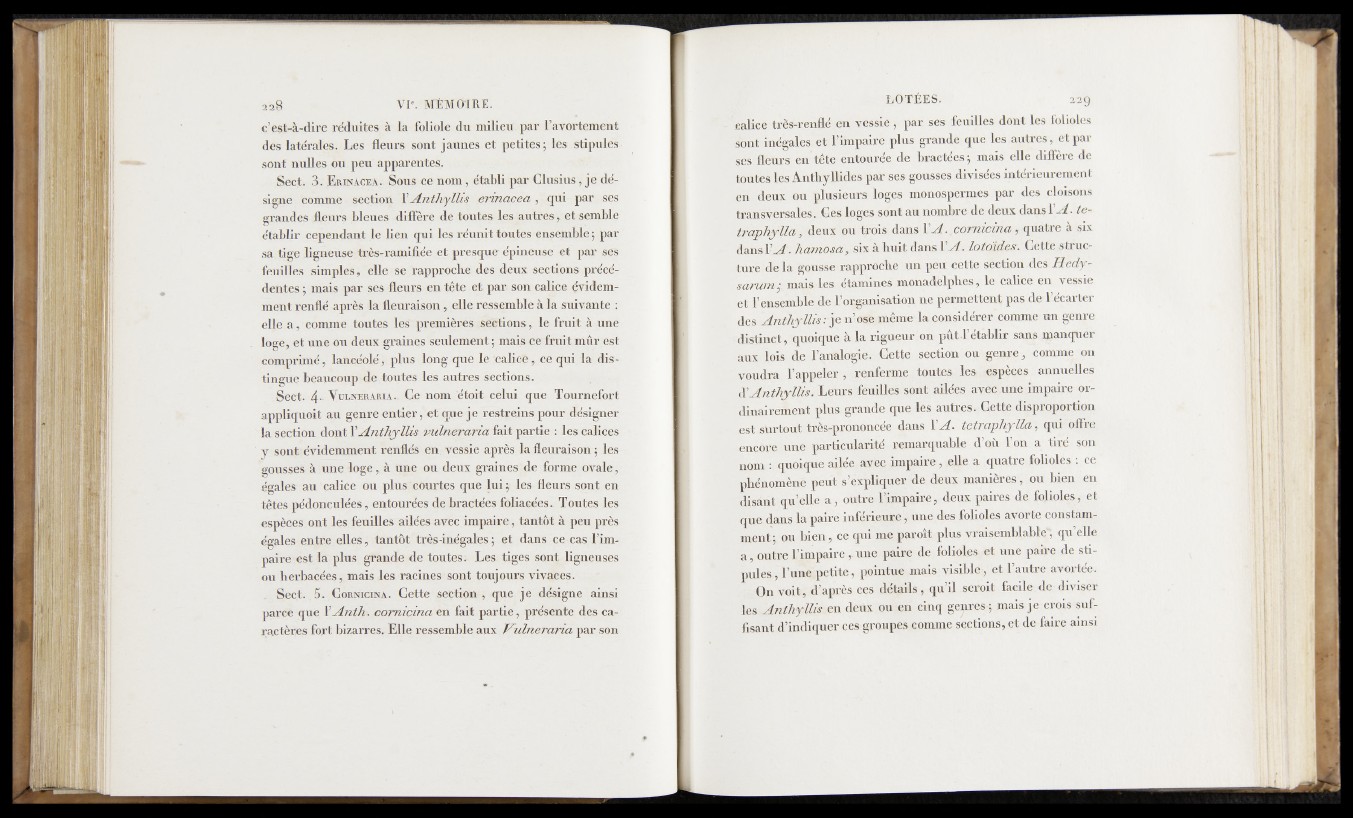
c’est-à-dire réduites* à la foliole du milieu par l ’avortement
des latérales, Les fleurs sont jaunes et petites; les stipulés
sont nulles ou peu apparentes.
Sect. 3.. Erinaçe'A. SqUs ce n om , établi p ar Glusius^ljé^dé^
signe comme section YAnthyttrs prinaicea ,;,q u « ip a r |ses
grandes .fleurs bleues -diffère de toutes, les a u tre s | et .semble
établir cependant le lien q u i les ré u n it toutes* ensemble ; p a t
sa,tige ligneuse ^ès-ramifiée et presque- épineuse' et p ar »ses
feuilles simples,*êUe-:seRapproche des deux sections ^précédentes
; mais p a s s e s -fleurs en tê te e t pan son. calice évidemm
en t renfle -après la fleu ra iso n , elle ressemble à la suivante :
elle a , comme toutes»;les'“ premières ^sentions, le fru it à -une
loge, e t un e ou deux graines feu lemen t ; maisÆetfruit naunnst
comprimé, lanæéolé, plus long que le ic a licÉ ^ te qui la dist
in c t e -beaucoup» de ftoutes les autrps^sêetionsd c-
Seçt. 4- YéjLN®EARiA. Ce nom étoit celui que Tournefort
appliquoit au genre entier,’ et q.ueqefestreins pour désigner
la section dont Y A n ih y llis mdrsegaria fait partie : les calices
y:sont-Tévidemment renflés en-vessie âprès la fleuraison ; les-
gousses à : une lo g é , à ttpe ouvdeux graines de .ferme-ovale,
égales au 'calice ou plûs$côurtes que lui ; les fleurs sont, en
têtes pédonctdées, entourées de bractées foliacées.. Toutesles
espèces ont les, feuilles ailées-avec impaire, tantôt à peu près
égales enjtre elles, tantôt très-inégales ; et dans|||ë^cgs, l ’impaire
: est fa plà$; grande de toutes:- Les: tiges sonf ligneuses
ou herbacées vmais -les racines-sont toujours vivaces.
, Sect.. 5., Gornicïna . Cette section , que-jè désigne ainsi
parce que YAntfa. ,oomicsina en fait partie, présente dés caractères
fort bizarres. Elle ressemble aux T^ulneraria par son
calice très-renflé en vessie par. ses feuilles dont les folioles
sW igÉfgâfesiet rimpâiéjLplus g ran d e que les a p tre s, et p ar
| | L fleurs en- fêfe entouré|îdêK braeféfiS j'.'ffliais elle diffère de
toàt'éslI^A-ntby llides p ar s e ^ g p n # s e ^ îiÿ é ^ ^ aW - euren:,!eilt
iéri dpfft ou ÿuMe.riar>$fog<»v feonospermes p ar des .cloisons
f ^ n ^ e r ^ a f e s ^ G a ^ ^ ^ l i au nomfere-dedeux dans Y A . je»
tveçjsJ^nllct /Vdeux p à f j^ i^ é a è s ; flu a tre à'. six
d a n s l’^/'. six à h u it dans Y A . loüqjjj^çs?: Cette structùreède
la gQusse^rapprdcMe u n p ^ ç e t ^ ^ | ^ | d ^ ^ . ^ l ^ ^ '
saruiW^ mais >fes émir^ines-auonadfelpb.,es%;,^i9ÿ L^ ^ t ^vessie
et l ’ensemble de l’o m a n i s a t i p p , , p a „ % , d e t 3r,écarter
n ’o^mêmeda.ç.©ns;id^^f comme u n genre
critgtt^gt«flqiii.03que-àila, r ig u e u ro n g pW jé ta b lir saja^ jjiancfuer
aux lois d# d ’a n tlo g i e jÿ ^ t t^ S’ectipn: ou gçpjje, comme on
voudra l ’appeler ,» renfermp, f e ÿ i | ^ ^ s ^ p p e s , annuelles
K H h H B B Leurs feu ifle^ sp n t^ a ilé êsja fé||u n edm p aire ord
in a irem e n t plus^grande qued ès a u l î p ^ ^ p r o p o r t i o n
l e s t ,s tirto u t||# ^ p to p pG é e - ^ a n s Y A f^ $ ^ a fp ,y jlâ , qui-offre,
ÀenÇÔrfèÿUne" particularité remarquable .4 ’ op.-l’on. a tiré • sim;
nom : quoique aÿée» ^ ç j a a p a i r e ? | § | » q u a tr e f |d i( ^ s |ÿ 4 *
phénomène p e u ^ e x p liq u e r -de deux manières ,fe u bien ien
disant q u e lle a , o utre-l’impaire,^ eu x<p a ire s,d ë fojioles, et
qne dans la paire in fé rieu re , une^Les.folioles:avorte constamm
en t; Qfivbien , ce qui me p a roitfplûs v ra isem b lab l^ qu ’e l|f |
a , outre l ’impaire , une paire de foli&fes^t u n e pa^-e de sti-
.pules., l ’u n ^ p e tite , poinfu$pnais. visible«) et l ’au tre avortée.
» sfeQ-n'v 4 t , d ’après ces d é ta ils, q u ’il seroit facilèÿde, diviser
les A nthydlhk& ix deèx ou,4en cinq geprps-; mais je erois suffisant
d ’ind iq u e r cesvgroupes»comme sections, e t dp faire ainsi