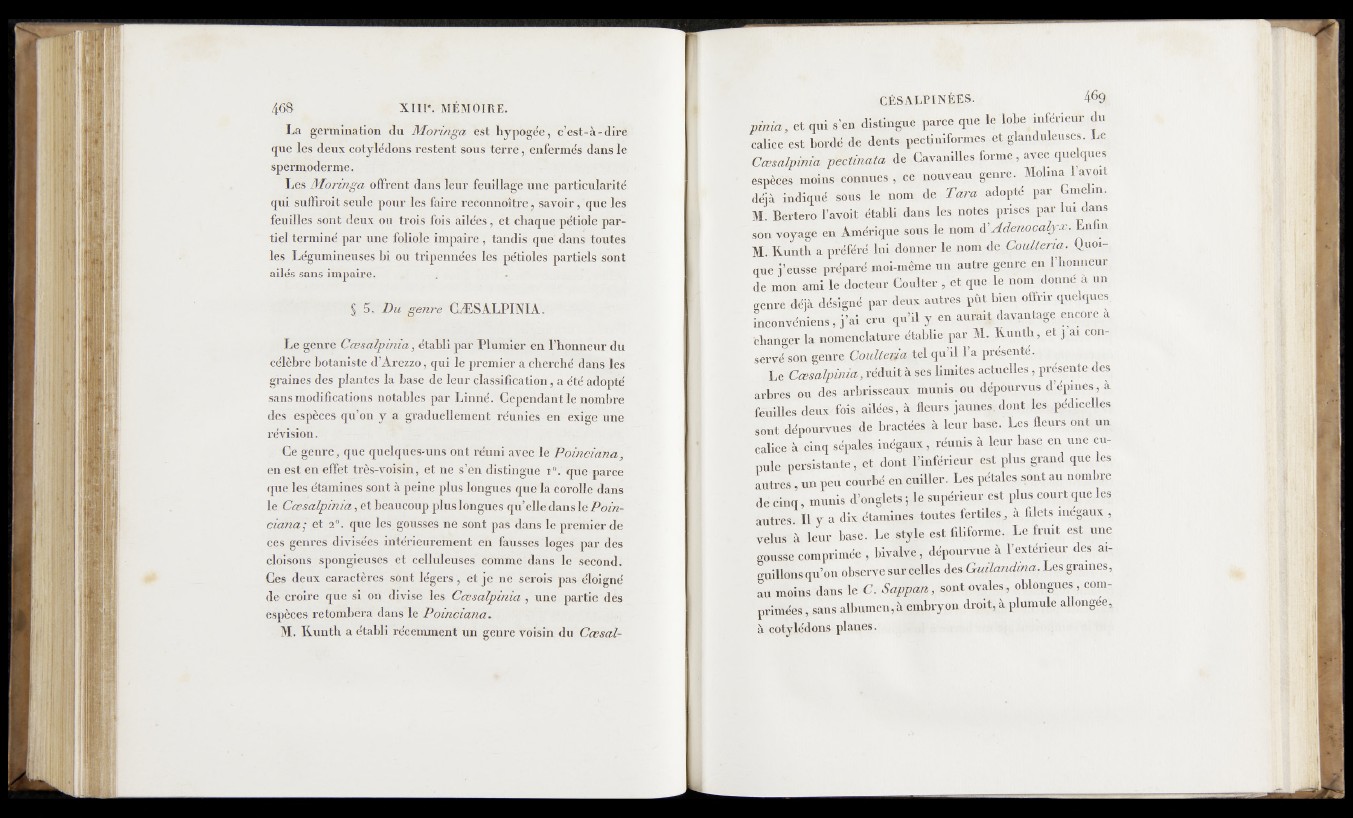
La germination au M oïm ga èst hypogée, c’est-à-dire
que les deuxllpyïédons Vestent sôus'terre-, enfermés dlins le
spermoderme.
Les Moringà offrent àafTs fèïir feuillage une pârtioulatit é
qui suffiront seule pour les faire reconnoître. savoir, , Jqüe les
feuillesS(«ftïdéux ou trois, fois ailées',' et chaquepétiôle partiel
terminé par une foliole impaire , tandis que! dans toutés
les,Léguntineùses bi ou tripenne'es les pétioles partiels sont
ailés sans impaire. * . . .
IS É B l j j genre CÎÆSÂLPINIÀ.
Le genre Coesdipiriia, établi par BMïédfer en l ’honneur du
célèbre botaniste d’Àrezzo, «fur le premier a OT^^emaasJes
graines des plantes la -base de Murglassiffeation , a
sans modifications notablpïjpar Liüh'é. ijpépvendant le nombre
des J©sjlèces qu’on y JC gfâduellement Munies en ,èâfe*une
révision.
Ce gençe, que quelques-uns "ont réuni aèècflÊ ^æ û r.Pfr-n*,.
en est en effet très-voisin', et ne s’ën distingue i 0.' que-parce
qùe'ïes étamines sont à peine plus longues quedâ-eorolle dans
Xe 'Çoesalpihia, et beaucoup plus longues qti’ellqdàns le Pôirz1
cicPiïà; et i° . que, les/gotisses ne sont pas" dans le premier de
cgs genres, divisées intérieurement eh fausses ‘logés par dés
cloisons, spongieuses ef celluleuses comme dans 1© Secônd.
Ces deux caractères sont légers , et je.ne serais pas éloigné
de croire qu'e£*u on divise les Cçèsetlpinîa , une partie dés
espèces retombera dans le Poifibîanàll,
M. Kunth a établi récemment Un genre voisin du Coesalpiniafyî
et qui s’en distingue parce que le lobe inférieur du
e a lic itib o rd é ^ q ^ t^ p e c tin ifo rm e ^ e t glanduleuses. Le
@ M Pm k -pêëfymta de Gavanilles;forme, a ^ , quelques
espèpïs,moins Î h | | nouveau; genre, ^ o lm a l avqit
déiàV indiqué ‘sous le nom ;d e ^ « ^ a d ° p t é -par Gmelxn.
M. Bertero l’avpit établi dans les. notes pri.sesivpar lui dans
son vioyagemn Amérique«qpjgyfô Enfin
1®.: Kunth a,p<4féré lui donner ^ Quoique
M B B f cB B B moi-même un 'autre,gen^e ep^’honneur
mon ami le docteur Coulter , et, que le nom donne a un
genrë^éiâÜési|ni panyieux autres | | H offrir quelques.
— M i S B R y. en aur%da^antagq4S p ^ à
'changer, la, nomenclature dtabliecpar M. Kunth „ et ja^cop-,
segrsgfeïgenrem id ie^ a tel,qu’il l’aprésenté. , -, | |
helGcfÿdiïgmiâi^réduit à sg^limites a c tu e ll^ préspute.des
ambres nu de« arbr(isseaüx munis ou dépourvus d’épinesj,u
fëüiliês d e u ^ ïq ^ lé é s , à fleurs jaunes, dont l^ p fd ic e lle s
m n t dépourvuesvde braefép^à leur basé. Les fleur^iont un
lealice à cinq sép#s. inégaux, réunis à leur ^ a ^ e n ^ iÿ ch-
pule,psrsistante4et dont l ’inférieur est plus gra^â qpp les
afftrife un peu courbé en cuiller. L e s ^ é ^ s q n t a i i nombye
de cinq, munis d’onglets ; l|^ipérieur ^ p^us.equr^qpe les
autres. U y a dix-jétamines t o u t e s f e r t i l e s ^ j^ inégaux ,
v’elus à leur base. Le style est filiforme. Le fruit est un©
gousse, comprimée ., bivalve, dépourvue à l’extérieur d^s aiguillons
qu’on observe s u è d e s des Gmlandina. Les graines*
au moins dans le Cs '.SapgfW,osjiles. » b lo q u e s , con,-
priniées, sans aJbnmenyÀeipbryon droitjà plumule allongé?,
à cotylédons planes.