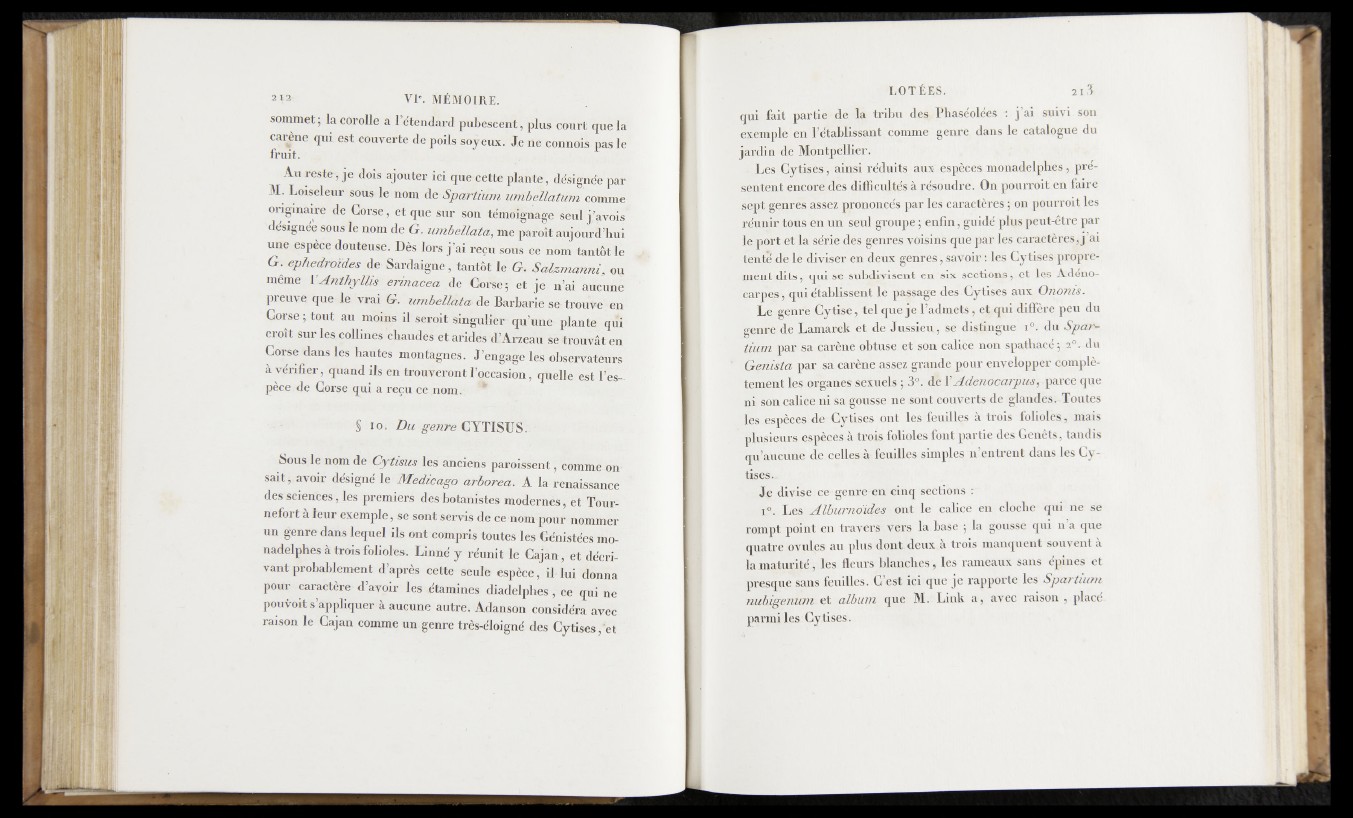
sommet; la corolle a l ’étendârd pubescent, plus court que la
car|ne qui est couverte de poils soyeux. J.e ne connois pas le
fruit. , ,
Au reste, je dois ajouter ici queteétte plante, désignée par
M. Loiseleur sous le nom à&Spartàim u%b^LlaMm comme
originaire de Corse, et que sür sln témôfgiïUgé seulj/avoiif
x désignée sousîe nom de-G. umbellatâ, me paraît aüjturd’hui
une pspèée douteuse. Dèsrdore j ^ ç b ^ . ^ e n o k tantôtde
G . ephedr’oïdes de- Sardaigne, tantôt le G , Sà^m anni, ou
même YA n fhy iîis* 'ennaé&a de ai aucune
preuve, que le vrai G se-trouve en
Corse ; tout au moins il serait singulier q u^ ïï^ jtan t^ qifi
croit sur les, collines chaudes et arides ’dèArzël^l^Lrouvât' en
Corse $lans les hautes montagnes. JW ^ ^ f f ib s e r v a t e u r s
a vérifier, qpàand ils en trouverontI^^si^il)hfs, qtielle est-l^spèee
de Corse qui a re^bèé nom.
-•*$ WÊ D u getïre GYTIS1l | | |
Sous, le nom de'Cy-tkusAês Anciens p a r a ie n t , comme on
sait „avoir désigné le M edictigo^frorea. A la rënaissÂce
derserêiftés J e s premiers des botanistes^ modernes/êt Touï-
nefort à leur exemple, se sont servis de ce nompour nommer
un genre dans lequel ils ont compris toutes lesfrénistées mo- '
nadelphes à trois folioles. Linné y réunit le Cajun, et .décri:
vant probablement d’après cette seule espèce, il lui donna
pour .caractère-d’avoir les .étamines diadelphes, ce qui ne
poutoit s appliquer à aucune autre, Adanson considéra avec
raison le Cajan comme un genre très-éloigné des Cytises ,*et
LOTÉES. 2 l 5
qui fait partie de la tribu de^, Phaséolées : j ’ai suivi son
exemple en l ’établissant comme genre dans le catalogue du
jardin-de Montpellier.
X-Lès Cytises, ainsi réduits aux espèces monadelphes, pré-
sjeptent encore^des difficu|||ÿà résoudre. On pourrait en faire
sé-pfe genres assez prononcés par les caractères ; on pourrait les
réunir tops en un seul groupe ; enfin, guidé plus peut-être par
le port èipafsérie des genres voisins que par les caractères, j ’ai
tenté de le diviser en deux genres/savoir : les Cytises proprement
dits, qui se subdivisent en r six sections, et les Adéno-
-car^s-vqui établissent le passage des'-Cytises aux Ononù.
" L ^lgen^ É y tise , tel que je l ’admets 5 e| qui diffère peu du
genre de Lamarek et de Jussieu, se distingue i° i du Spar*-
tiüm■ par. saV^arène obtuse et son calice non spathacé; du
[ Ç ^ iïsta par sa carène assez grande pour envelopper complètement
les organes sexuels ; 3?: de YAdenocarpwtjyaxce que
n i son calice ni sa gousse:ne sont couverts de glandes. Toutes
les Cytises ont les feuilles à trois folioles, mais
plusieurs espècesià;trois folioles font partie des Genêts, tandis
qu’aücüne îe;celiesàjg feuilles simples n’entrent dans les C y tises..
Jp ditdse îçe 'gepEeïen cinq sections r
1«. Les Albumoïdôs: ont le calice en cloche qui ne se
rompt point en travers vers la base ; la gousse qui n’a que
quatre ovules au plus dont deuxvà trois manquent souvent à
la maturité, les fleurs blanches, les rameaux sans épines et
presque.sans feuilles,.C’est ici que je rapporte les Spurtium
nuàdgenum et album que M. Link a , avec raison , place,
parmi les:Cytises.