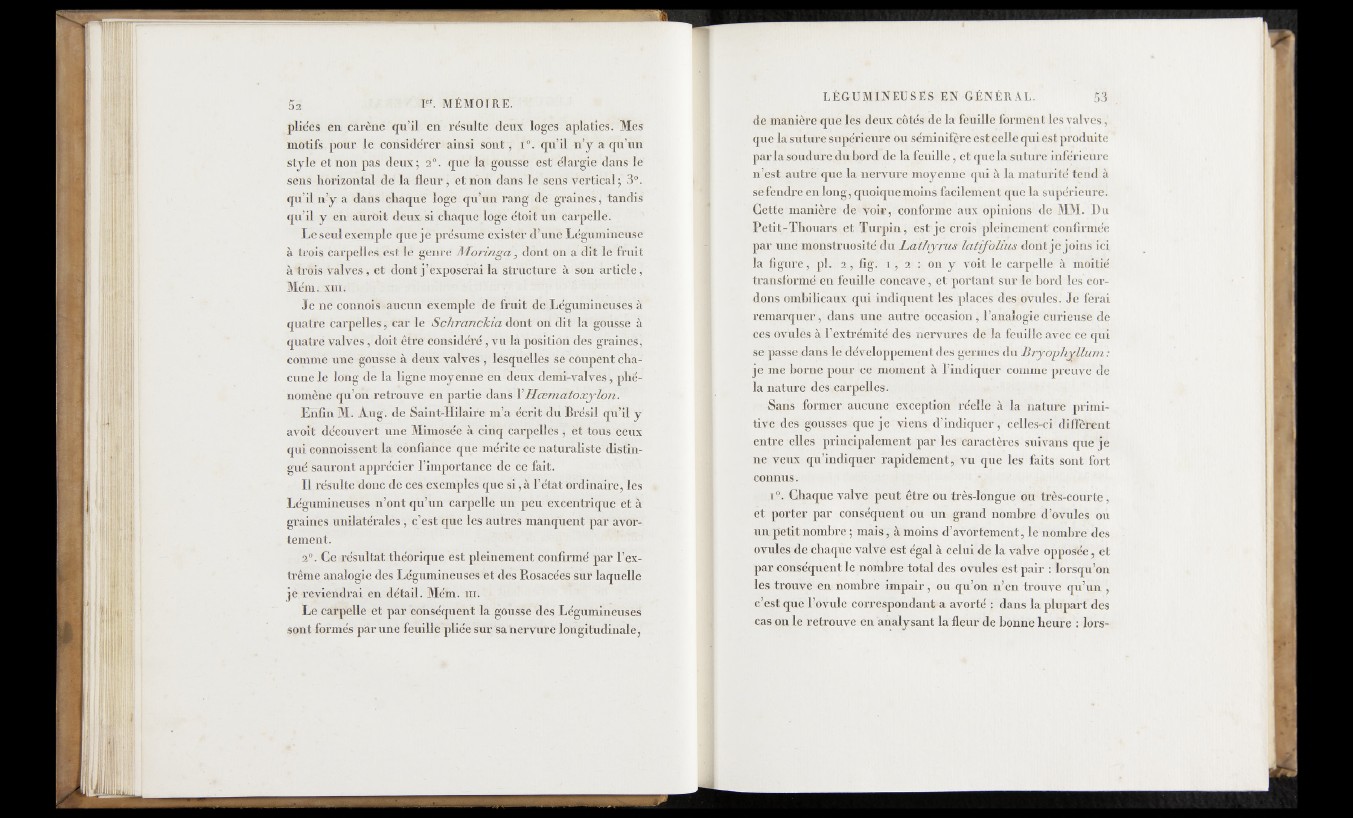
Rliéës étfi;é^tëiié qu’il, en résulte' deux loges aplaties. Mes
motifs pour le: eOrisïfléréfi'ainsi sont'7\|?t-!^flïÉ4r5y a qu’im?
style ét non pas deux quW la * gousse est élargie' dans lé
sens horizontal dé la .fleur, et* mon dans lé%2ns- vertical
qu’il nfyf a daüs chaque loge qu’un rang dfe^grâiriéPiptandik
qu’il ^ j^ a u r o it deux; si :ehâque* îôgë ëtoit un'Càf^<e lî# i| ?
t e seul exemple que jé^resum^exîslâr d’untlEëgdfiiiiïèfiSe
à trois carpelle^esl le genre dofit“ Orfia uît le fruit
à^trôis vàlvés^, et dont j • ëxppseVâi’ 1 a structure à ■ sèn article
Mémcxm^l i
Je në;côhnois *lmcnn èxëmple‘ !'dé fÉuii ,d^t^amin%uJës^
quatre > carpelles }t:ar le\Sch?y!McAi&^Wût^oîi ditfflp*gf>u;|sé à
qtiatre valves ■ ^doitrêtr’e* considère , vudàjbo'sitiôri d^S^graiflëâ,
comme unevgOûileià déiix valves , lësqùèü^k^ëxîôüpeht dlià-'
cimele ldïig'de la ligire’ïho^raelmaeux'denfe-valviê'§\;pjîë-'
n om è h é * ’on;retrouve eU paftié-flansd
Enfin M. Aug. de iâffiét-Hilàire m’a etritififi^Rfésil qu’il y5
avoit découvert une Mamoséca ciiîq carpelles^ ë f tous ceux
qui eomioissent la* codfiairce'que mérite ^^iSturalis te disran-
guë sauront appUeeier l ’importance de^ee* fait.
Il réiSulfeMonc de ce&Çxémples que s i, à Tétai hfdiïfâii’e,des
Léguixiiner&ês «’ont qu’un Carpelle un péu%5téTéMrique et à
graiiïfs unilatérales est'que les autres manquent par*aY8f,jï:
tement.
,*. 1/2.°.. Ée ^résultat.théorique est pleinement confirmé par TÇx-
trÉfie analogie des Légumineusès%t des Rosacées sùr laquelle
j è;'reviendrai tqâdétailMéin. ni ! - g
t e carpelle et* par Conséquent la , gousse Mes Légùmineusëà
sont formés pâr une feuille pliee sur sa nervure longitudinale,
de manière qtfës j'èstdeux cètésKd’e la fouille forment les valves.,I
que la sutfire supérieure ou séminifgre est c elle qui est produite
parlasoudure duhord de la feuille, ef qüela suture inférieure
n^bst.autre queJa^nervure moyenne qui à .la matiÉ,^ stend à
sëÉendreJenit6pg^qpqique-|as.oins facilelmenf.que la supérieure;
Getfe manièreîde -’t'ofo,. conforme aux Opinions de MM. Du
Pe ti t î 3^<mam4ie t Turpin, esfrj eforois -pleinement confirmée
par une' vmnst^w^ïté(Au-La^y-'m,slla^ ^m is dofitjë joins’ic f
lafi'gùre, pl. t l 1# fig: on y voit le carpelle à' moitié
transformé? en feuffle'eèûpi^e, et poftariTsiir^Ië bord les cordons
ombilicaux qui indiquent lesfîpTgbes des|,ovules. Je forai
remarquer, dans une autrèflOecàMon, l ’analogie-fiurieuée de
ÿulp.Sjàl 1 ’ extrémité* dès nervures dè&la fouillé avèe’cé1 qui
sefpasse^daüs le développement des germes du Br‘^bph%Llum :
je me borne pappîoe moment à l ’indiquer comme preuve de
la fia turë? des^carpetles. .
• Sans former; aucune exception^- réelle^ à; la naitufii primi-
ti^é;de%gâiusseS5î que je T viens d’indiquer, 'cèïTëdeï diffèrent
entre elles principalement par les caractères- suivans que'Je
ne veux qu’indiquer rapidement, vu que les faits Sont fort
•connus.
Chaque valve-peut1 être ou très-longue ou 4rès-courte,
et porter par conséquent ou un grand nombre d’ovules ou
un petit nombre : mais r à moins d’avortement, le nombre des
ovules de. chaque valv&ést égal à celiïildë la valve oppose , et
par conséquent le nombre total des ovules est pair :Âorsqu’on
les trouve en nombre impair, ou»qu’on n’en trouve qu’un |
c’est quédrovule correspondanfra avorté : dans la plupart des
cas on le retrouve en’analysant la fleur de bonne heure : lors