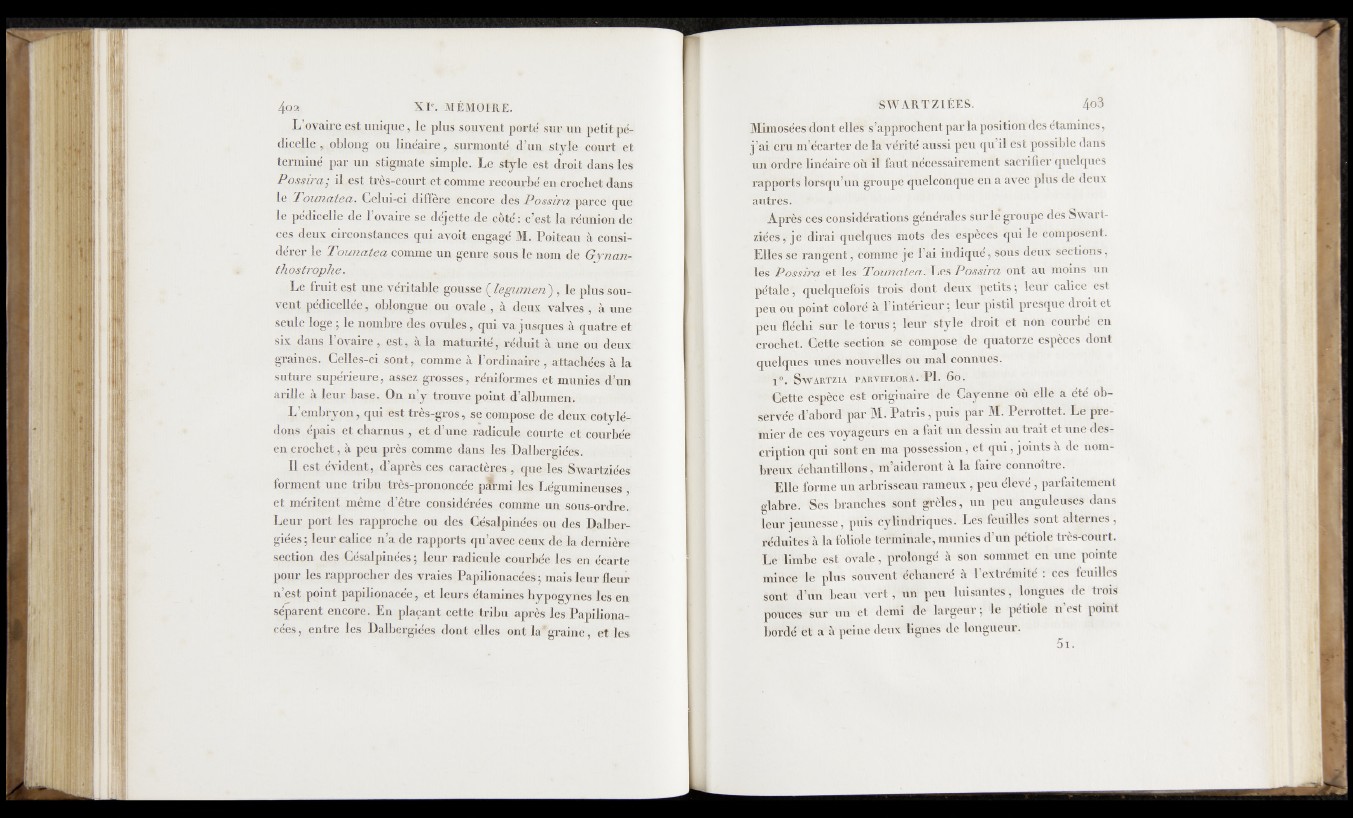
L ’oyaira ^§|ÿinique, le plus souvent porté sur un petit,pé-
diee|le ÿs!()bloug ou linéaire , surmonté, d’un,*stylfc court et
terminé par un stigmate simple, Le style^est droit dans les
Powiçq,; il^st.trèi-coprtÿet comme recourbé eu crochet dans
Ig T o^72ff^<z^ï.Qelyj^i différé ,encpre des P os$%ycl parce que
lu pedicelle de 1 .Qvnirnse„dèjetteT,de ç©t,df|piQSJfe la .-réunion de
' eqs, (JeMf circonstances; qui ayQitç engagé M. Pejitgau à eansi-
dérer Je Tounatea comme un geiuusouste nQW ^
thostrqphe, n
Le fruit e^t une- ve^jtable goussUj(j^î^7Ufiz^V lg, plusîsou-
v.e^pédieellée, oblongue ou ovale ,^à deux vafvasyA une
seule loge,; le nombre des ovules, qui va ju s q u e ^ q u a te e t
dans 1, ojyaipç ,T e§t,,.ap,la maturit^si^édiui^ÿà; pmg.oii deux:
graines. Celles-ci sont* comme/àî 1’ordmaîre , attachées à-da
suture.;supérîeure, as^z, grosses, yéniformçs et munies, d’un
arille à leur base. On n’y trouve point d ’albumen.
Jj^’embryon, quivssttrès^grqs, sepojpposeîde deu^eoilyléf
dons jéppis et charnus , et d’unau^dicu]® courte et courbée
en croch e t , à peu près.eom*ne dans le^Dalbefgipps. ,
Il est,évident, d’après ces cara ct^s., .quedes M-warteiées
forment une tribu très-prononcée p *m i les Légumineuses ,.
et méritent meme d’êfre considérées comme un seusiojrdm.,
Leur port les rapproche ou des.Césalpinées mu des ftalber-
giées; leur calice n’a de rapports qu’aVeo Geux de la dèrhièrê
section < des Césalpinées; leur radicule courbée les, en écarte
pour approcher des vraies Papilionacées ; mais leur fleur
n’est point papilionacée, et leurs étamines hypogynes les en
séparent eneq^e.. En plaçant cette tribu après les PapiMema*
cées, entre les Dalbergiées dont elles ont la*graine, et les
Mianoséesddnt elléèVapprochent par la position' des étamines,
j ’ ai cru m’écarter de la Vérité aussi pféu qu’il est possible dans
uri ordre linéaire oh iï fafÈft’xtécessairement sacrifier quelques
rapports lorsqu’un groupe quêlconque en a avec plus de deux
autres. ■ 11
ApfèS'cesconsidératiorts-générales sur le groupe des Swart-
zi’ées, j e dirai quelques mots dès especes qui le composent.
Elles’se rangent, comme-je l ’ai indiqué, sous deux sections,
les T^fèsivet, >ët *lésf TôÜfiMea .^Les Possird ont au moins un
pétale*5' quelquefois tftnh dont deux petits-, leur calice est
peh ©h point ^ lo r é ^ l ’intérieur': leur pistil presque droit et
jfeVfléehi sur te torus ; leur style droit et non courbé en
ferodhët. «Gette section së composé de quatorze espèces dont
quelques- raies nouvelles ©u mal connues.
ivSvWrziA pAitvïFËbKl.'TPl. 6b.
;Gg'tte espèce ést originaire de Cayenne où elle a été obé
it ^ d ’abord: pâ^M^^ M. Perrottet. Le premier
déèes myageûrs en a fait un dessin au trait et une description
qui sénat ën ma possession, et q u i, joints à de nom-
b r e u x à la faire ténnoître.
Elle forme un arbrisseau rameux, peu élevé , parfaitement
glabre P *Ses brahlhes sont grêles, un peu anguleuses dans
leur f in e s s e , puis cylindriques. Lés feuilles sont alternes ,
réduites à la foliole teiîninale, munies d’un pétiole très^cowrt.
Le limbe est ovale, prolongé à Son sommet en une pointe
mince* le plus ,Sôù^eùt:éthaneré à l ’extrémité : ces feuilles
sont d’un beau vert ,'u n peu luisantes, longues de trois
pouces sur un et deniî de largeur; le pétiole n’est point
bordé et a à peine déni lignes de longueur.
o i.