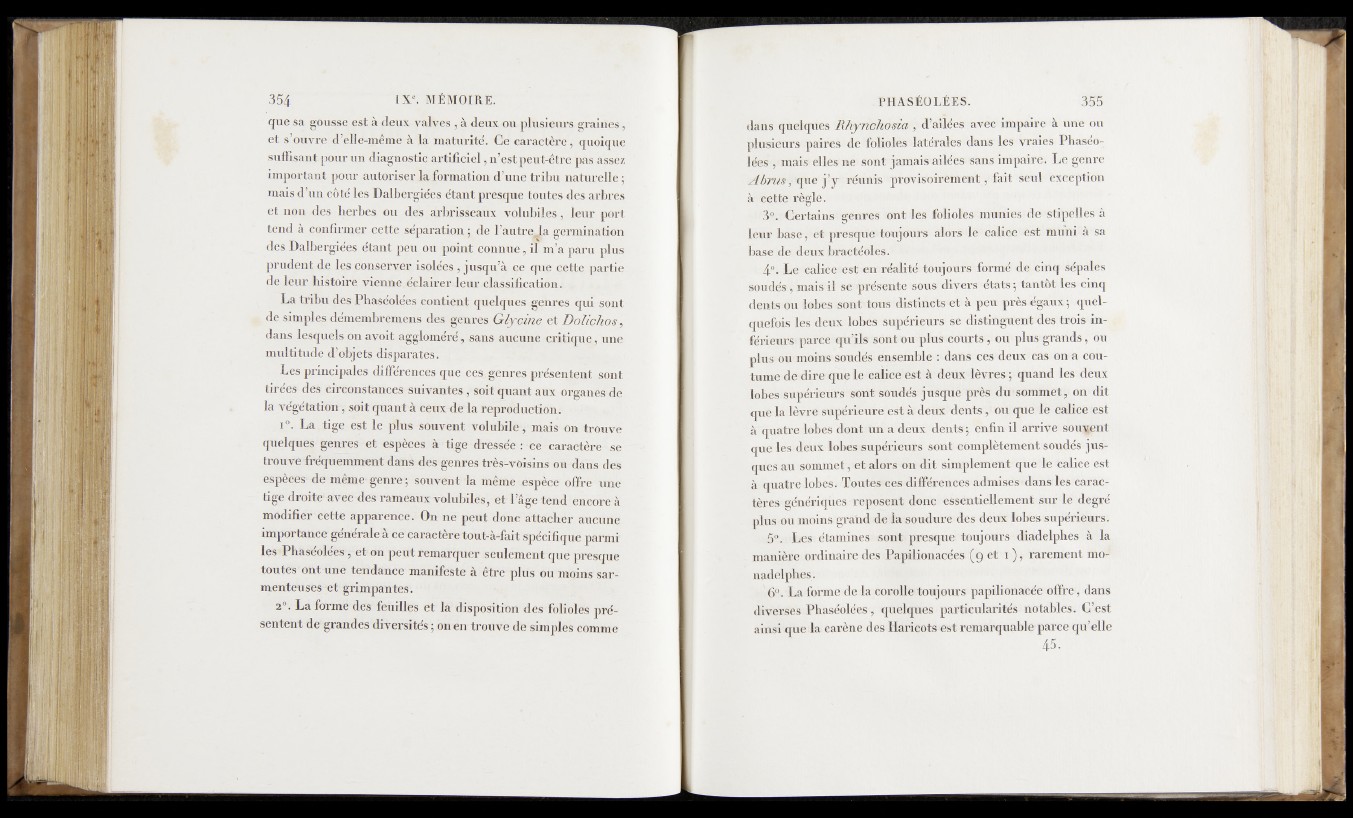
que sa gousseest à deux- valves, à deux ou plusieurs graines,
et s’ouvre d’elle-même à la maturité. d e caractère, quoique
suffisant,pour un diagnostic artificiel, n’est peut-être pas assez
important pour autori*er;la formation d’une,tri bu naturelle ;
mais d’un côté lés Dalbergiéês étant presque toutes des arhre§
et non des herbes ou des arbrisseaux volubile%, leur port
tend à Confirmer .cette séparation 5 de l ’autrtUa germination
des Dalbergiéès étant peu ou point cqnpOe, il m’a/paru plus
prudent de lqspônserver isolées, jusqu’à cp.que cptte partie
de leur «histoire vienne éclairer.»!emûelassifination. ^
La tribu des Phaséqlées contient quelques genres qui sont
^ p ÿm p le s démembretnens des genres Gtycme et Doliç&os*,
dans lesquels onavoit aggloméré, sansouçune critique, une»
multitude d’objets disparatéiof
Les principales différences que-ce^ genres .présentent sont
tirées deseirconstancessuivantes /soit quant aux organéJdg
la végétation/ soit quant à ceux de la reproduction
, L°- La tige est le plus souvent volubile, mais on feèuve
quelques genres et espèces à-1 tige dressée : 'bë-caractère sp';
trouve fréquemment dans desJgënres très-v0isins*OT^dnhs des
espèces de même- genre ; souvent la même .esfèceoffre unê
tige droiteaveedesrameaux volu bilCs,nbPâge tend' encorna
modifier cette apparence. On ne peut donc attacher aucutffi
importance générale à cë caractère tout-à-fait spécifique parmi
les*Phasiédléèseh oii peut remarquer iseülement que presque
toutes' ont une tendance manifeste à être plus ou mqins $ar-
menteuses^et' grimpantes.
La forme des feuilles et lâ^diÿpôsition des folioles présentent
degrandes diversités ; nnen- trouve de simples comme
quelques 'Rhyvkfk&séa ; d’ailées aver impaire-à une ÔU
plusieurs paires1 de ifôlioles s latérales dans iesvrâies> Phaseo-
lées /mais ellesf-Ue»Sont‘ jamais*ailéesi^ans impaire. Le genre
j ’y réunis provisoirement ,* fait seul exceptièti
à cette règle.
Certain s: genres ont les fdlioteS'mu»wes de stipules à
leur -bas©et presque toujours alors- le dalioedêst' m'uni-’à^sa
base de deux bna^téMës J- '*’
Le 'Calièe*estcn réalit<Môr^u<rfeformé‘dcJëinq sépaleS
sondés‘4* mais il seoprésente î^tÉ^'d.iyierSï'ébats 5 tantôt lçs^ëàùq
dentsfduîidbes^stmt «tousJ distinets 'Ctrà peu près égaux 5 quelquefois
lfës deuxl^Ms^iipérieurs distmguentMUs'troisûn^
féricqrsipareoqudlsrsêM ou plus-COurts , ou plustgrauds ^ôu
plusfôiftmoins soudés ensemblê«udanét’Cè^cleux^tMS- on<-a enù^-
iume de dire quelle calicdestà' dedscdèvresi;- quand les' deux
tebes^supérieurs sont 'snfàlé'S^ùsque près- du<sommet jjj ourdit
que la lèvrësupérieurC-est àldetüM'enoe / ourqnè4 c calice est
àquatredobes dont un a deUx dentsifwfin il arrive sou^ppnt
que; les,deux lobcs’ssupérieurs sùnt; Gomplètement's®udésqUs-
qutes.au soinnieÉ, et alors on dit simplement ‘ (fuêtbe #eLice est
à quatrédobfes j »llo'utesïe essdifférences admisësftdansffes: caractères'génériques
^reposent donGresséntiellement-suE^lëAetegré
plus oumninsgranède^'souduretdies deux lèfeëS^supérieurs.
. vS^S. = Lesî étamines sont>presque tOÉijp(Ë^pdiadelphes! à la
manière ordinaire des .BapiMoriae^elsî^ et!x rarement iftéP
. nadelpb-es, -
fe lià 'Laforme de /la corolle»'touj ours papdionacéë offre, dans
diverses Phaséolées:, • quelques particularités notables.,(u^est
ainsi que la ea®èiMd^»Hati®ots^-isOTaâi^ed^|i8£i»ei^^éne
m