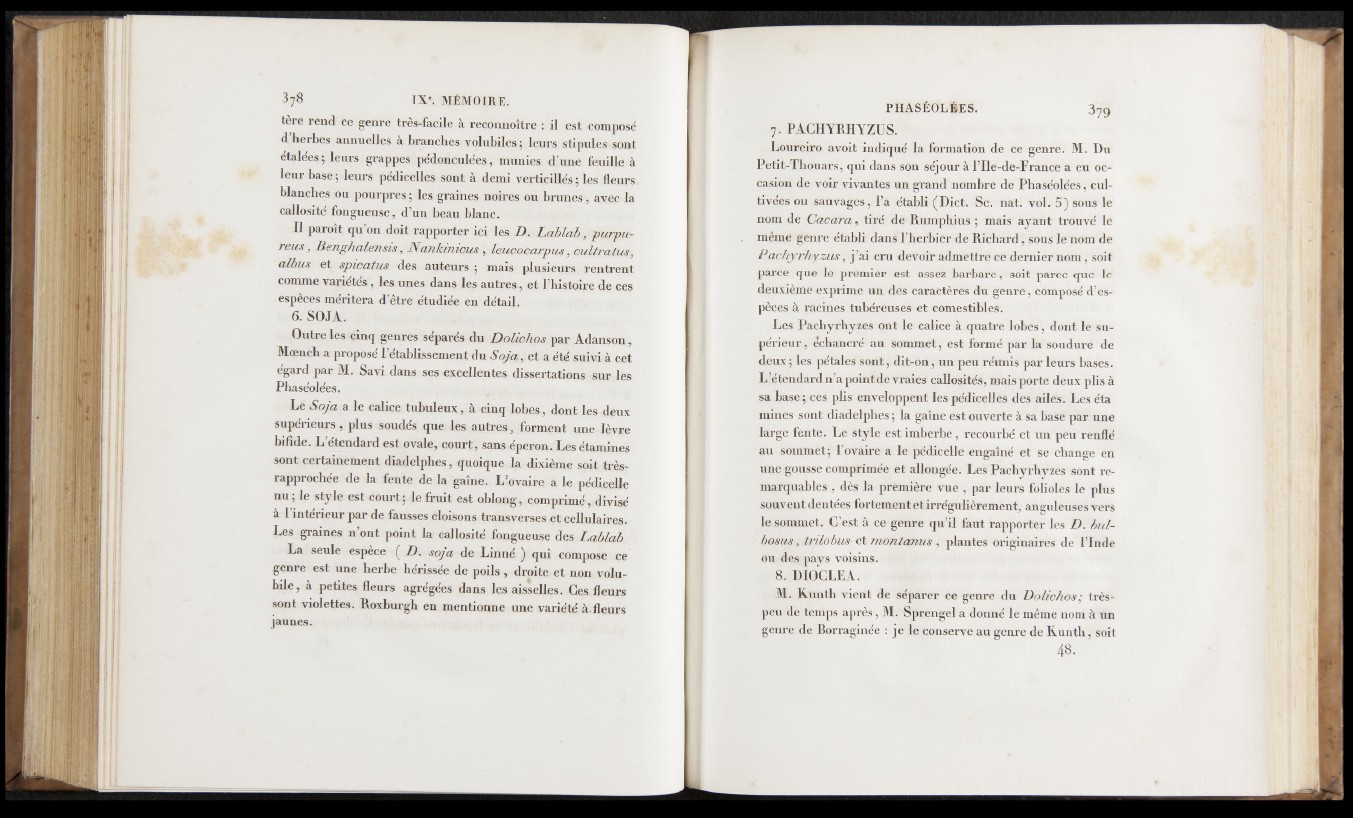
tère rend ce genre trèsdacile à reconnoître : il est composé
d herbes annuelles à branches vqlubiies; leurs stipules sont
étalées; leurs grappes pédonculées, munies, dune feuille à
leur base; leurs pédicelles sont à demi verticillés ; les fleurs,
blanches ou pourpres; les graines noires ou brunes, avee la
callosité fongueuse, d’un beau blanc.
Il paroît qu’on doit rapporter ici les D i I>a£lah pw pu-
reu s, R en g h a len sisN a n k in iem , l&m^barpus, m ltm tm
aüxus et spioatus des auteurs ; mais plusieurs rentrent
comme variétés, les unes dans les autres, et l ’histoire de ces
espèces méritera d’être étudiée en détail.
6. SOJA.
Outre les cinq genres séparés du D&lichos par Àdanson,
Moench a proposé l ’établissement du et a été suivià mt
égard par M. Savi dans ses excellentes, dissertations sur les
Phaséolées.
h é S o ja a le calice tubuleux, à cinq lobes, dont les>*flfux
supérieurs, plus soudés que les autres, forment u,ne.lèv=nç
bifide. L ’étendard est ovale, court, sans éperon. Les étamines
sont certainement diadelpbes, quoique la dixième sfitntrès.
rapprochée de la fente de la gaine. LWaire a le p é d « *
nu; le style est court,;.le fruit est oblnùg, comprimé.,flivké
à l ’intérieur par de fausses èloiSons^ansverses ;ef cellulaires,.
Les graines n’ont point la callosité fongueuse Aç& Lahlqb.
La seule espèce v ^ D . s&ja de Linné }-qm compose-ce
genre est une herbe hérissée de poils , droite et non volu-
bile, à petites fleurs agrégées dans les aisselles. Ces.fleurs
sont violettes. Roxburgh en mentionne une variété à.fleurs
jaunes.
M PAGHYRH YZUSv
Löureiro avoit indiqué la formation de ce genre. M. Du
Petit-Thouarsqui dans son séjour à l ’Ile-de-France a eu occasion
de voir vivantes un grand nombre de Phaséolées, cultivées
ou sauvages, l ’a établi (Dict. Sc*. nat. vol. 5) sous le
nom dê Gacoera, tiré de Rumphiùs ; mais ayant trouvé le
même genre établi dans l ’herbier de Richard, sous le nom de
P a èh yftk fzü s, j ’ai cru devoir admettre eë dernier nom, soit
parce que lépremier est assez barbare, soit parte que le
deuxième exprime un dés caractères du genre, composé d’es-
pèces à racines tubéreuses et comestibles.
Les Paehyrbyzes mit le calice à quatre lobes, dont le supérieur,
êebaneré au sommet, est formé par la soudure de
dpiixf ies pétale# sont, difi-oU;un peu réunis par leurs bases.
L ’étendard n’a pointde vraies callosité#, mais porte denx plis à
sa base ; ces plis enveloppent les pédicelles des ailés. Les éta
mines'sont diadelphes ; la gaine est ouverte à sa base par une
large fente. Le style est imberbe, recourbé et un peu renflé
au sommet; l ’ovaire si le pédicelle engainé et se change en
une gousse comprimée et allongée. Les Pachyrhyfces sont remarquables.,
dès la première vue , par leurs folioles le plus
souvent dentées fortement et irrégulièrement, anguleuses vers
le sonuneti -G’est à ce genre qu’il faut rapporter les />. hul-
basi*#, irilobus- et îmmtanus , plantes originaires de l ’Inde
ou des pays voisins; H
,é'-a,:'Di#.GLEY.r
M. Kunth vient de sépàrer ee genre du D olichos; très-
peu dé temps après, M. Sprengel a donné le même nom à un
genre de Borraginée : je: le conserve au genre de Kunth, soit