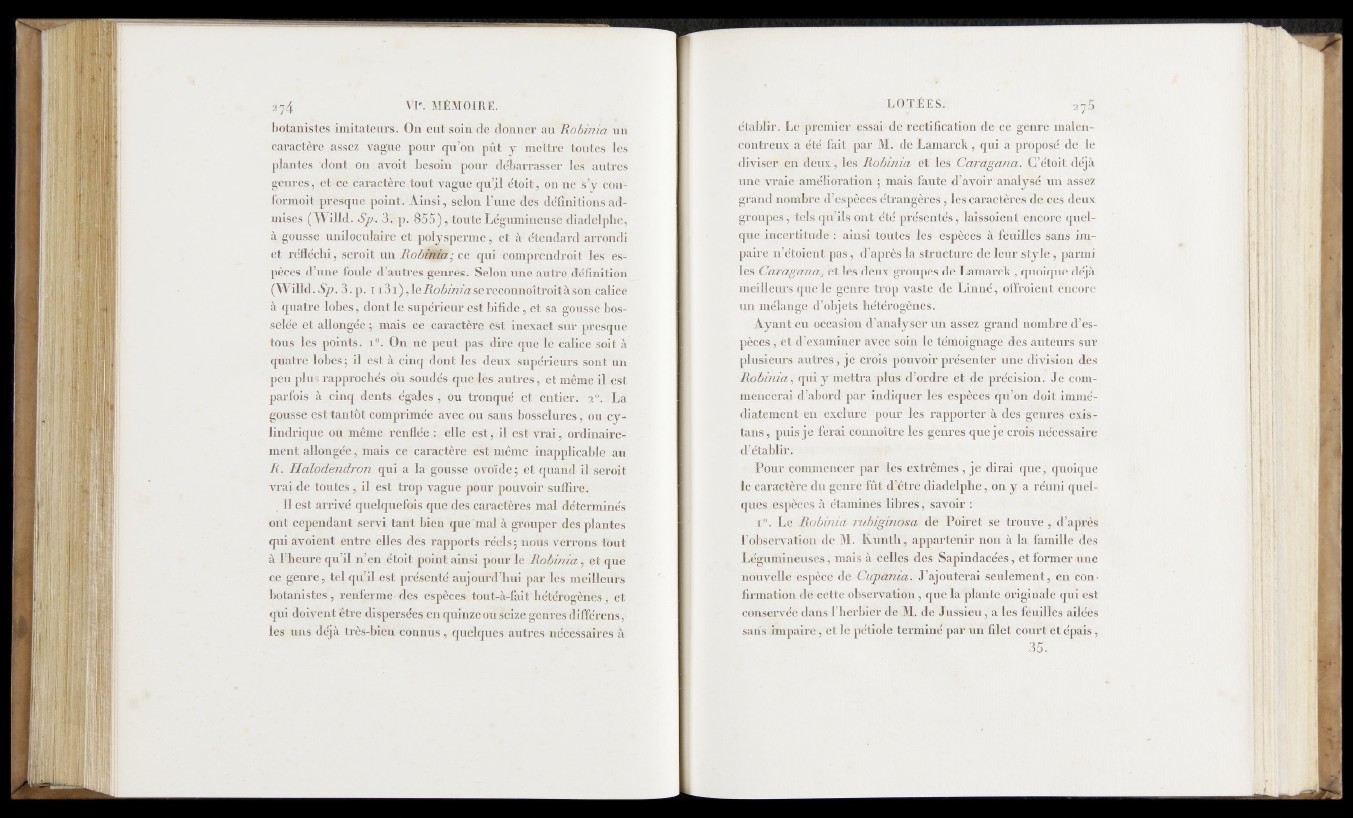
botanistes imitateurs. On ,eul soiri-cffe donner âW^ôb^nid un
caractère »assez ' vague pour qu’on pût y mettre toutes^lês
plantes 'doM^oq Ayfiit hesdSi'jxour débarrasser Ieî%ûtres
genres ;$ej|be -baÿactère Jout 'va^ue^qu’jil étoit-', onne^sy eoif-
formoit presque point, j Ainsi, .selon l ’une ,dres demitiàns admirés
( Willd. S p l ;^|ppV#S5§^bdte Légumineus'fe'diadêlphe,
^ q u s ‘s?e uniloculaire et polyspérmeJ|aût’,àr> e'tend^rd arrondi
et j^dgolli ; :seroit.un RobUÊtfo; eè qui. ;fenmpreM?oit les espèces
d’une foule dsautons genres. Selonnnétvauître définition
(W illd .6^1^. p. i x31).;leEbbinm^erecbnnoîtroif'à'slm-calice
à quatre-lobes, dont leipF^rieur est bifide 3 !&t sa^gof^se bos-
selée^et allongée ; mais - Ge-%earaetêrêlé§1? inexact sûr pKëéqûte
tous les points. ||1 On ne<pcuf pas/diré que le calice sdi( û
qûatre lobés'; il est a cinq- ddntfîlbs^déû^üp®^^^®| un
peu plus rapprochés ou -soudés quedès :autres y ét même illest
parfois à cinq denfgf égalés , ou tronqué e f; entière
gausse est*tantôt comprimée àvee e^saüs, hosselur'es.; ou eyv
lindrique où même renflée :4 elle est-ÿllesftvrai, ordinairementallongée,
mais ce? caractère: -éstrmême inapplicable au
R: HâloÏÏëhdfon qui alrfgoùsse- ovoïde; et quand-il seroit
vrai fie toutes, il est trop vague pèur podvoir suffire.
11 est arrivé quelquefois que des caractères mal déterminés
ont cependant servi tarit bien que‘mal à grouper des .plantes
qui avoient entre elles des rapports réels; uons verrons tout
à l ’heure qu’il n’en étoit point ainsi pour le R&frmM j êtqué
ce genre, te lq itïl est présenté aujoûfd’hui par les meilleùfl
botanistes^; renferme'des e‘spèceâutoutrà-faitahét§fogèfi$§', et
qui doivent être dispersées en quinze d ^ k e genres dxfféreas,
les uns déjà très-bien connus ^ quelques autres nécessaires à
x^Mxr . Léqxremierj^safi^de rectification de- ce^gëifre malen-
■ patrén^iÛ.^é‘faifî(ppar M. dé-'ILamaecIv^ qui a proposé1 de le
divise3^tellieu^é^l^^fe^inz ’ et les G’étoit déjà
Uhe rvra-ie. jamélidra%fé|É^ mais- faû'teïfi%^Q&1 analyséran; âssez
géand nombre |l|nspèces étrangères), a^-eès. aèux
-groupes*, -tels qu’ifenn|pi^|^lfèjife#, l^soient encore quell
e incertitude^ iAlnvîn impaire*
nétorexltlpas, < I a près; 1 a?s Ir'ui t1 f 1 ^ de iêilnp'lyle /parmi
J^'déui^gf^n^p'dèslj^xriafck, quoique jaéjp
înéiHeÙtaîque lé* gciT©■ ‘tt'^vuûs'ïfcydt'fl/lu né(mTOWiilTfm^ei
un mélalflK^I?objeti^^^M^Éfefett
AyE^^Uijdeca^dri'M’analj^^^LfÉn^è^Ërarid nombre;d|ésf
pègfJÉliÉêîdiexaminer5&yêfc?sôi.rn le lémOi*^ofg™des auteurs Inpr
plu^deuaîSv autres pjë-ctois pouvoir pré§êntèr une division filés
ïi&birhia f qMi^|Uëttrà; plus. dVrdreifet.de p’rébisiqn- Jéxcom-
mencèrin^'abdrd par xhdiquerÿe^^^êies^^’di^MraÉi.-immé-
diatement; ekxëxëterê&poür lés rapporter Jes' exi®:-
tans /pnis je ferai conuoitre 'Msjçpnres'- lu e j erroik nécessaire
d’établir. ;
■ Pour domxrien-éêr par |fes e^rêxries , jje/âiràr ipîeyqûoique
fecaractère du genre'fût ddêtre fiiadéiphe, on y a déum qüél-
quès séspèceà-à étanâMès libre s , savoir :
-x°.-L ^^tobimet rubiguiêsa, de- Pdiret su tion-ve ; - d’après
^observation de M. Kunth,. appartenir noir à la famille aes
Légumineuses ; -mai^ià celles desÊ Sapindacées, et foimtîrûne
nouvellé'espèce de Cupêbrùia.- J’ajouterai seellement^erneon•
firmation dé^eette-ribser^^^n, que la plante prigiriale qui est
conspvée dans l ’herbièr de M. de Jussieu, aies feuilles ailées
saris «impaire ,*et le pétiolè terminé par un filet cùû fttt épiés >
P B ' . -