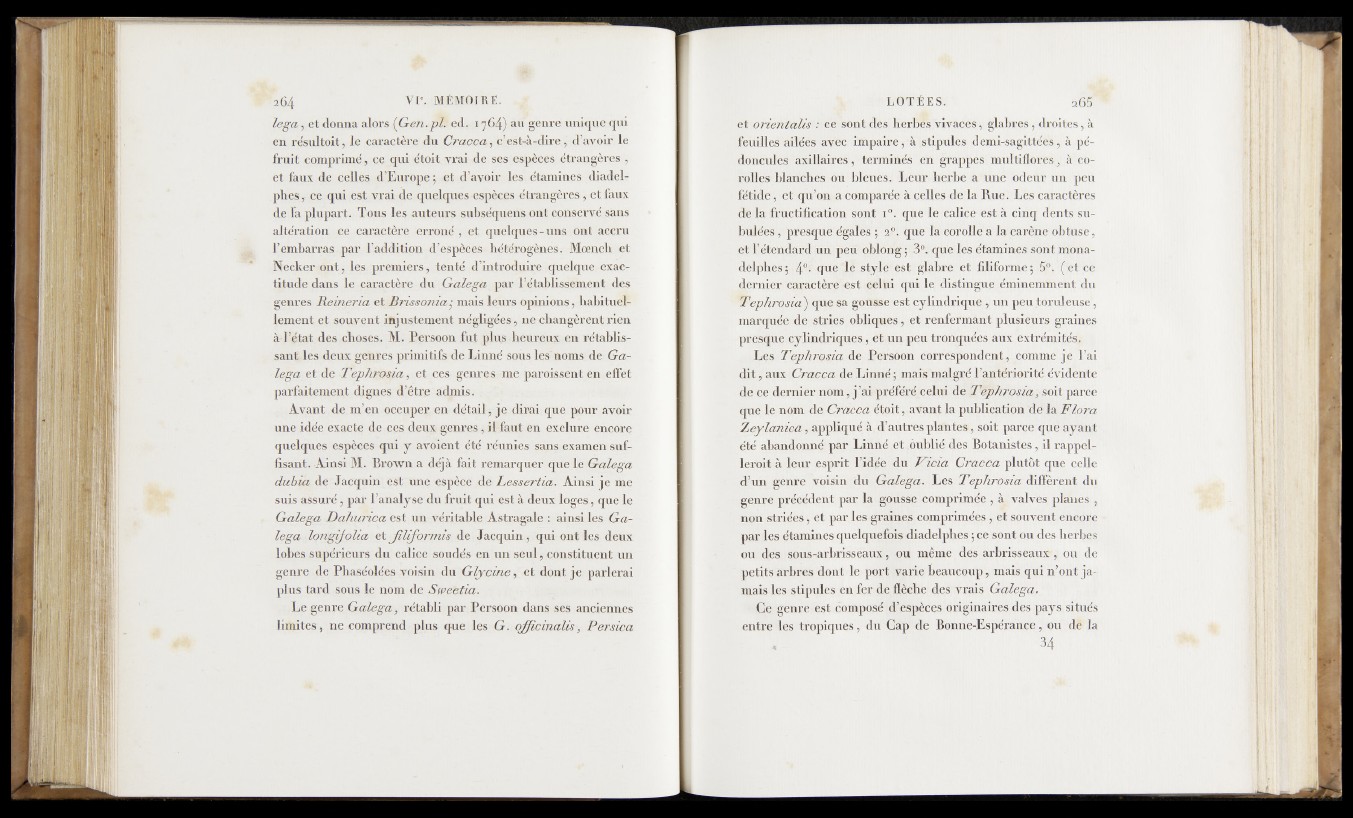
lega ,,et donna alors (.Gen.pfc ed. $4^.au”genréhuinique qui
en résultoüt, le caractère ,du Gracoa, $ è^s%à-dire„j-d’avoirT’ le
fruit comprimég ce jjui vrai .de ses „espèces, étrangères
èt faux de celles d’Europe $ et d ’avoir de% étamines {diadelr
pheSÿ H| qui est vrai de^q|iig|qués espèces é t a g è r e s , et-faux
de fa plupart. .Tous les auteurs subséquents ont conservé sans
altération ee caractère erroné , et quelqjies- ulasjOnÉ-jagCï'u
l ’embarras par l ’addition d: espèces*,hétérogènes r Mcenoh, et
|ièc]ser«unt, les. premiers, tenté d’introduire .quelque exactitude
dans le ^caractère du fra ie g® par l ’établissement
genres Reinçria etgBrissotâia; mais leurs opinions, habituep
lemënt et sonnent injustement négligées , ne. Rangèrent rien
à-l’état des choses. M. Jlersoonfut plujsjtbenReux en rétablissant
les deux genres primitifs de Linné soup les noms det %&-
lega et:de Ueph^esia,_ et< ces- genres me, paroissent en effet
parfaitement dignes d’êtrp adniis. , s
Avant de .m’en-occuper, en détail,-je.dirai que pour avpir,
une-idée exacte de ces deux genres, il faut tèn exclure gjjuiQrç'
quelques espèces qui y avôien®*é^ réunies sans; examen sjÆ
lisant. Ainsi M. Brown a déjà fait remarquer que \^&al,egà
dubia Ae' Jacquin ê&t*une espèce,d&Eessgtâi/îl Ainsi je éae
suis assuré, par l ’analyse du fruit qui est à deux loges, que le
G alega Dahuirica est un véritable,:Astragale : ainsi les Ga-
lega -.,lon^ [p lù iet J i1tâowjnisK de Jacquinv^^|diont -less deux
lobes supérieurs du' calice, soudés en ion seul ^constituent im
genre d e Phaséolées voisin dujGJ/y^ine ,_>et dont je parlerai
plus tard sous le nom de.
:X e genre rétabli par Persoon dans ses anciennes
1 unités, ne comprend plus que les G .:officinaUs, Persica
9t k > t > ëéfsbufedfesîHerl^*vivac'Aâ;ing1abr.es, droites, à
leililtés^aitléâs’ ^vf^Èfiifupaire, ^Istipulèkddê^i^a'gittéés.: piji pé-
donculesrâxillaires, terminés en grapf^|^multiflOÉés'é|^lt7
rolles blàmches ou bleuèsi®l^i^^ëisb0]|a unetfodfeijr un
|qfe|d^|i ’ e t qu ’ on^a. c o'mpârée? à; coUéfld'efla Rue-|fj^^^afaé)fèr,és
dê la fructificatién sont' i 0. quë^e^càî'lié^feb’à -ciriq!(dentsIfèt-
bUjléëS, presqué é^rm'sî^tç.î°i que ,
,et l ’étendard un ped’ gbloù^:|i|^°.^qufe5les étamineà|ti|^jmpna-
delphes ; 4° • fIue ’ glabre, f|e-Ihfidifornte1 jaKiiffit pfe
derni«carac tèrë^stsçjtélfii qui le, distmguégéminenünent' du
3 go'tee estfeÿlindrique ,
marquéeédfe' S'tries obliques , et renfermant plusiéjÿfrs égraines
presque cylindriques, èt unj^u.trohquejesjaux’extrémig^ ^ k
T^à^h'^s^fi^^éèsùon correknoi1 (I cli L^àftntbm.lé l ’ai
d it , an é ; mais m^^M l ’anxérioritq^yideûte
dètefë dernier nom, j ’ai^préféré^oeltri de .soit par.ee
S|ïuc le nom d(^6Jr«c ca c toi t , avhnt la publicatiunyî^là^^aÀY/
appliqu4-à/d’aû1^,s plante^,pâiirpar^^qué a y ^ t
été abandognélpar Linnël^ nubli^dèsjB^.tàn^tës , !! fappélr
lë^M p leu r espritM’idpe du- 0 £ëtic£K frappa plufnb que celle
d’un genre Voisin du G a leg ci.^ es ' Tm nfffsitô diffèrent dm
genre précédent par la. gousse ébmprimée , à* valvës planes ,
non -striéps'^ et par les graines- comprimées pbgpüveritsënc^rk
par le s |^ 3®aines quelquefois tdiadelphes ^pê*SènM|p;des lïerbqs
oh des sous-arbrisseaux., ou même,d$s<-arbrisseaux,' ou' dq
petits arbres, dont le port .varie beaucoup, niais; qui n’ont ja-
%uis les stipules èn fer dje flèche désfvrais
Ce*, genre.sest composé ?dJespèces originaires dés pays, situes
entre les tropiques, du Gap de Bonne-Espérancè, ou d l la
■ k >!' ,