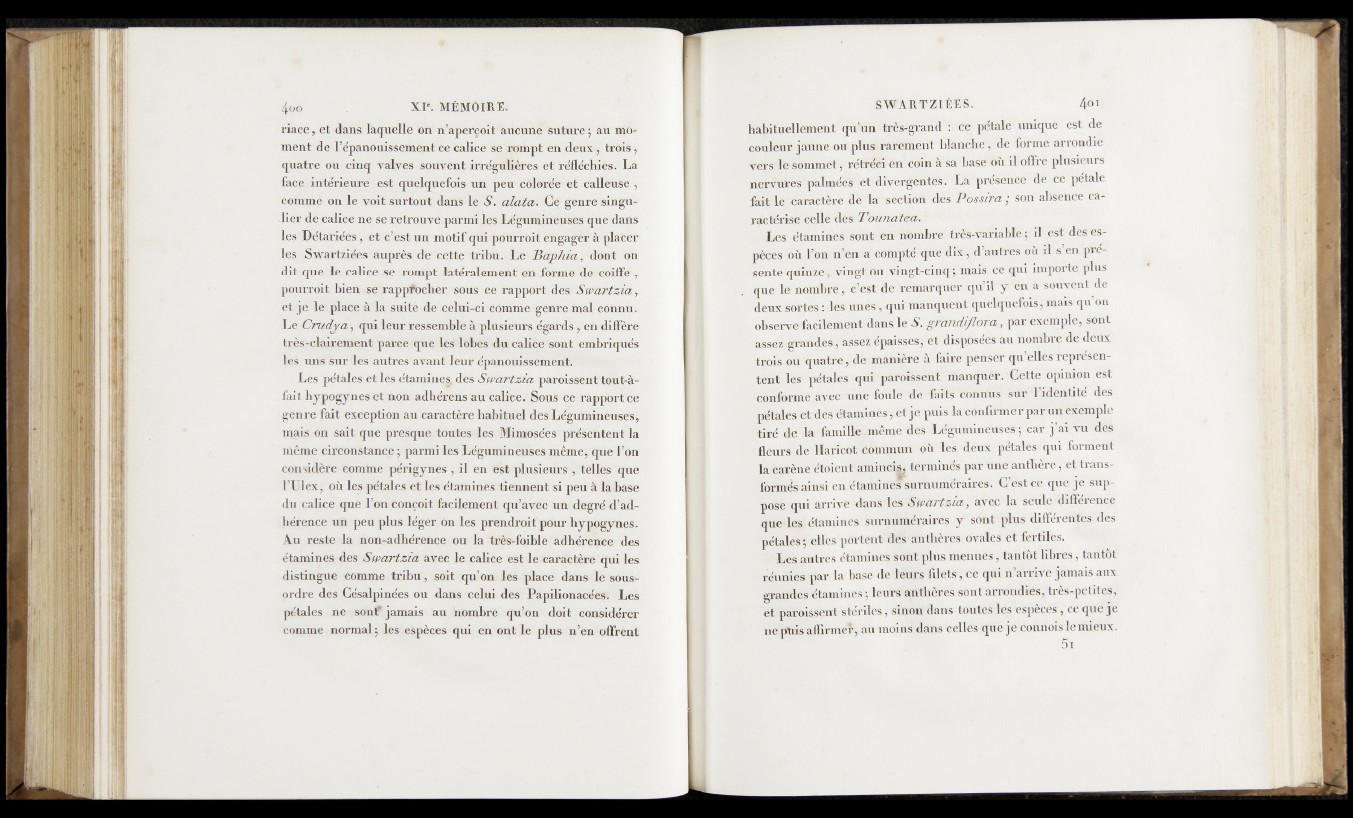
riaçe, et dans laquelle on n’aperçoit aucune 'suture 5 aü moment
de l ’épano uissement-ce calice se rompt en deux<$ trbis
quatre ou cinq values souvent irrégulières et réfléchies. Là
faep intérieure est; quelquefois un peucôlé ré eè t Calleuse §
comme on le voit surtout dans le S i alata. (le genre singulier
dë calice.ne se retrouve parmi les Légumineuses que dans
les Détariées, et c%st un motif qui pourroit én'ga^ér àplaîeer
les Swartziées auprès de cette tribu. Le B ap hia, dont on
dit que le calice ;së rompt latéralement en forme de coiffe ,
poufxoit biem^è“ rapplbcher sous Ce| rapport QèSS&fatitàfziâ,
et je le. place à-la suite de celui-ci comme genre mal-connu.
Le Gii4êya\ qui leur ressemble à plusifeürs égards, en diffère
très-clairement parce que les' lobes du càlièe sont embriqüés
1||S; üjïs sur Lei aufrès avant lèur épanouissemëiîÉflP
Lés pétales et les étamineades'^âxitsfa paroisâèntM;dut-à-
fait hypogynes et non adhérons an calice. Souâ-tefe* rapport 'ce
genre fait exception au caractère habituel des Légùmin&UseS;
mais on sait que presque toutes les Mimosées présentent la
même circonstance ; parmi les Légumineuses même-,que l ’on
considère comme périgynes , il en est plusieurs », telles que
l ’Llex^ où;les pétales et les étamines tiennent ^if|p|lu à la base
du calice que l ’on conçoit facilement qu’avec tin degré-d’ad-
hérence un peu plus léger on les prendroif pour hypogyn.es.
Au reste la non-adhérence on la très-foible àdhéfe|.ce dés
étamines, des Swccrtzià avec le calice est leaearkctèfe qui les
distingue comme tribu , soit qu’on les place dans le sous-
ordre des Gésalpinées ou dans celui dès Papilionacées. Les
pétales ne -sonlf jamais au nombre qu’on doit considérer
comme normal ; les espèces qui en ont le plus n’en offrent
habituellement qu’ùn très-grand : ce pétale unique est de
couleur jaune ou phtsàèarement blanche, de forme arrondie
vers Ife sommet, rétréci'en* coin à sa base^'ëu il offre plusieurs
nervures'palmées et divergentes . lia presence de ce petale
fait le caractère de la section dès Pw^Jra ) son absence caractérise
Celle des-T-ewnktâ&a, 1
r"Les étamines sont nombre très-vëriàhle ; il est des espèces"
qù rWtm'én^a compté que dix» , d’autres où il s en pre-
, séntè quinze, vingt ou vingt-cinq"; mais ce qui importe plus
qùèîde nombre; c^est de remarquée* qu’il y"éh ^souvent de
deuxéortes : les unes , qui manquent quelquefois, mais qu’on
observe facilement dkns \% S :g tandîfià ra , par exemple, sont
Jksseiîgrandes passez- épaisses, %t»disposéesau nombre de deux
trois ou quatre, de-manière à-faire penser qu’elles représentent
les pétales qui paroîsseht manquer. Cette opinion est
conforme avec^uhelcmle de Tait s connus sur l ’identité des
'pétales^d^s étamines, et je puis la confirmer par ttù exemple
t i é derla famille^nême des Léguminéuses’ffèar j ’ai vu des
• fleursfd'e Haricot c’ommun où les deux pétales qui forment
la carène Éfoiefît aniinc% terminés par une anthère, et transformés
ainsi emétâùlinePsurnümëraires . C’éÉhe que je suppose
qui arrive -dans'ieS *§fpartzià, avec la seule différence
qtteHe^ étaminé#surnuméraires y sont plus différentes des
pétales; elles portent ^ anthères ovales et fertiles. ‘
Les autres étamines %ont plus menues, tantôt libres, tantôt
réunies par la bkSe de leurs filets , ce qui n arrive jamais aux
grandesétamines ; leurs anthères sont arrondies, très-petites,
et paroissent stériles, sinon dans toutes les espèces, ce que je
ne puis affirmef , au moin^dans celles que j e connois le mieux.
5i