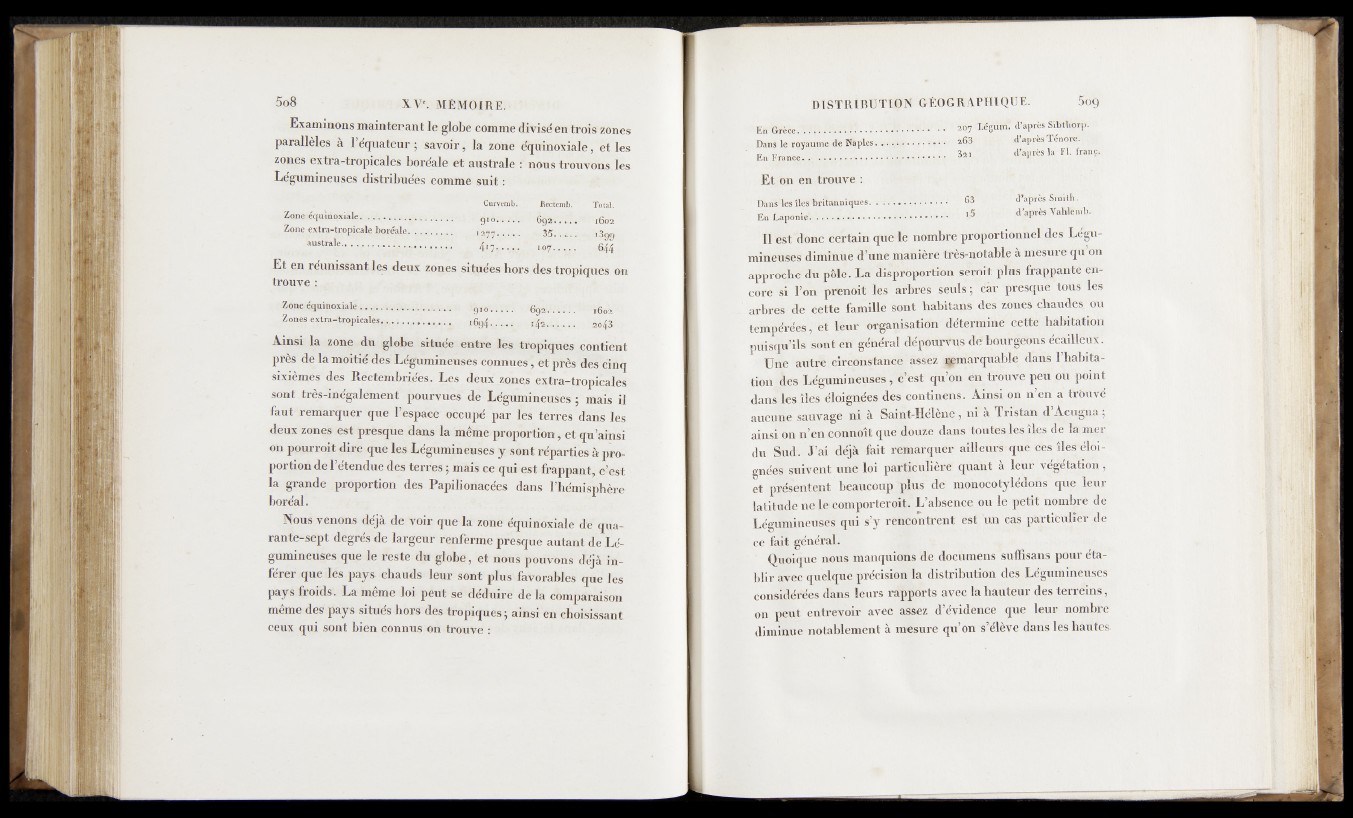
Examinons maintenant le globe comme divisé en trois zones
parallèles à l ’équateur ; savoir, la zone équinoxiale, et les
zones extra-tropicales boréale et australe : nous trouvons.les
Légumineuses distribuées comme suit :
\ • ’‘<Ço,ctàL^' '
Zqpe-équinoxiale..................................4 $ g i f e r .R 692, ,
^australe.. ........ .. ^ ^ f 644
¥*18® réunissant les deux zopes situées hors des tropiques on
trouve;,^;
Zone, équinoxiale.......... .v-î. » &3 .J. \ AUt % ô. . . *5 .* ‘69! ËttÉj
Zones exlra-tropicalës.j..................... 1694. . >‘&>43h-
Ainsi la zone du globe située entre les tropiques contient
près de la moitié des Légumineuses connues* et près’def^cinq
sixièmes des Rectembriées. Les deux_zones extra^ropiGales
sont ..très-inégalement pourvues de Légumineuses ; mais i|
faut-1 remarquer que l ’espace occupé par les ïerres dans le s
deux zones est presque dans la même proportion, et qu’ainsi
on pourvoit dire que les Légumineuses y sont réparties à proportion
de l’étendue des terres ; mais ce qui est frappant, cè#st
la grande proportion des PapilioriaEcées dans l’hémisphère
boréal.
Nous venons déjà de voir que la zone équinoxiale^ â ë quarante
sept degrés de largeur renferme presque autant cfe Légumineuses
que le reste du globe, et nous pouvons dejài»-
féreyoque ilés pays chauds leur sont plus favorables que lés
pays froidsl La meme loi peut sè déduire de la cÔmJjâtaison
meme des pays situés hors des tropiques 5 ainsi en choisissant
ceux qui sont bien connus on trouve : f
'EitÈ l'1»: i“î ? . . .
Dans le royamne.dte Naples
H • ••
i f ! Légupf? d’après I
iê3£‘ ;4i’aprà^ Ténoi^«®
33 dr.ùjn <• la 11 tranr,:'
, Et on en trouve :
' Dâiîheà !léS‘R r i t a n n i è i é s r*. ' 63 ’ #l|fees Snirtli
»VL i ............^ 2<%B*^JVahiembv
Il 'ettijbnc certain que*lë nombre prôportionflélj^-Cs Légumineuses
diminue d’une mahière très-no table à mesure qh on
approfclië'du pôle. La âisprbportion"sèroit plus frappànte ën-
cdre^si l ’on prenoit les,Ji # t ó s W i s f ^ , ' ^résq^tous^les
arbr^tîe^cètte famille so it h abita^ ou
t em ^ r ë ÿ f èt leur débilisation déterminë cetfë habitation
püistó’ii^ tó h éh 6géhéral dépourfus
>XJ#e ^aüt^lcirodhstanee 'ds'siéz jgpmarquabië’ datais l’habità-
tion le s Légumlrieqë^ r# e s f quÔh point
danîles îles éloignées des continensC Ainsÿpn n’eiî a trbuvé
ancuiae sauvage, ni à Saint-Hélèn^^i^à.jT’ristan d Acugna ;
ainslon n’en conppît. que jj'ouze .dans toutes les îles de la mer
du Sud. J’ai’ déjà -fait remarquer’ aïPeürfrquf^|èteréloi-
gnéJ| suivent une loi particulière quant à" le u f ;v e |^ A ^ i,
et pimentent beaucoupjpîus de mghooQfyléàodr* que/,leur
latitude’ne l e comporter oit f L ’absence.ou le petit nombre de
Légumineuses qui s’y rencontrent est un cys p àr titîiftr^ e
^ée fait général.,
Quoique nous manquions deijfócumenssuffisans pour eta-"
blir avec quelque précision da distribution de^Légumih’euses
consistées dans leurs r^ |ô rts avëe la hauteur des.terymnk,
on peut entrevoir avec afcsez d’évidence cpie leur nombre
diminu e notablement à mesure qu’on s élève dans l’es haines