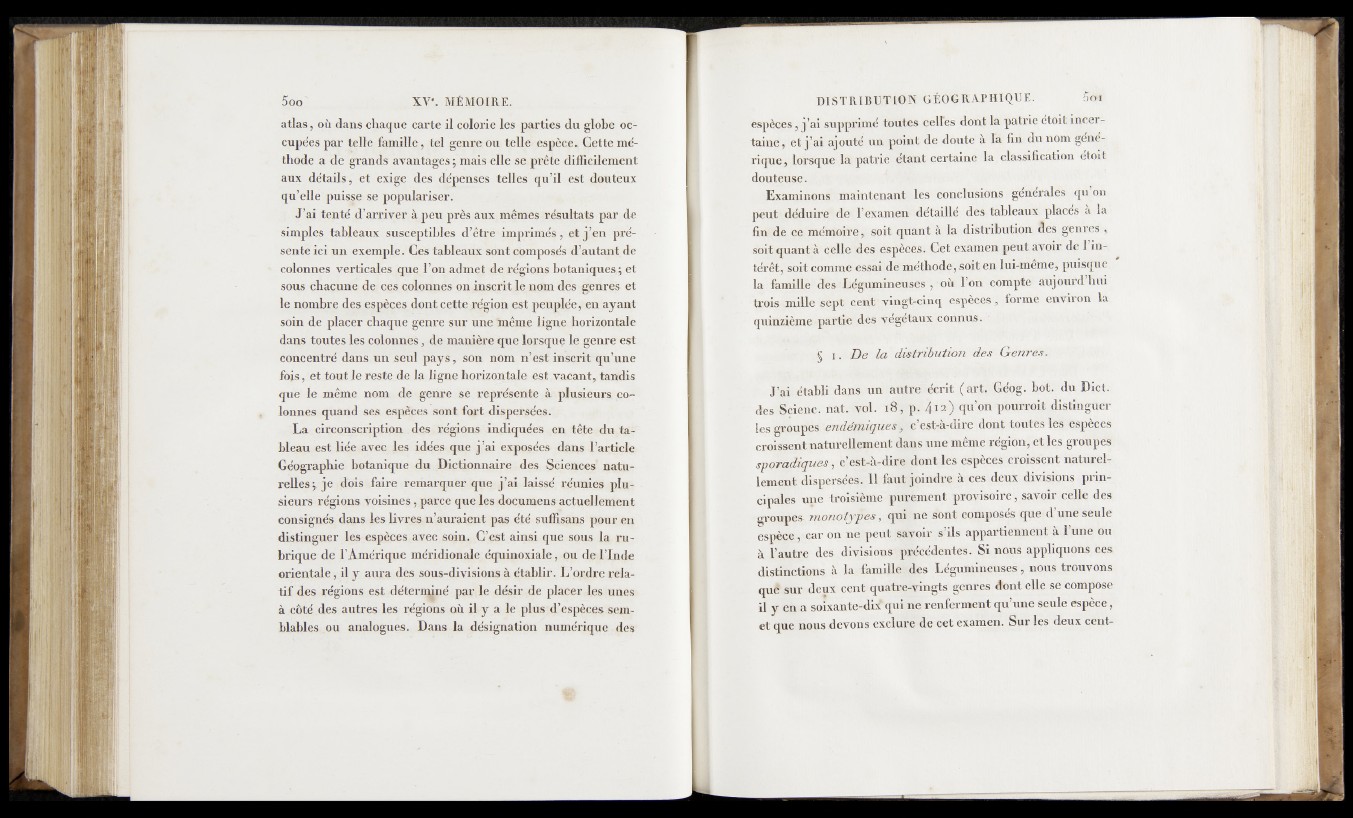
atlas , où dans chaque carte il colorie les parties du globe o c cupées
par telle famille, tel gcmpou telle espèce«. Cette méthode
a de grands avantages; mais elle seprête difficilement
aux détails, et exige des dépenses telles qu’il est douteux
qu’elle puisse se populariser.
J ’ai tenté d’arriver à.pcu près aux mêmes résultats par de
simples tableaux susceptibles d’être imprimés, et jj’en présente
ici un exemple. Ces tableaux sont composés d’autant de
colonnes verticales que, l ’o n s a d m e j b o t a n i q u e s , ; et
sous chacune d e '^ colonnes on,inscrit le nom dès genres et
le nombre defefi|«iÉPes dontcette régionest peuplée, en ayant
soin de placer chaque genre sur unefinême ligne.horizontale
dans toutes les colonnes, de manière que lorsque le gcui?e est
concentré dans un seul pays, son nom n’ëst inscrit5qu’une
fois, et tout le reste de la ligne horizontale est vacant, tandis
que le même nom de genre se représente à plusieurs colonnes
quand ses especes sont fort dispersées.
La circonscription . des régions indiquées en; têfe<ÿdu ta^
bleau est liée,avec les idées que j ’ai eppù§ées dans l ’article
Géographie botanique du Dictionnaire des Science^ naturelles;,
je «dois faire remarquer que j ’ai laissé réunies plusieurs
régions .voisines, parce que les deepmens-actuéllement
consignés dans les livres n’auraient pas été-suffisans pour en
distinguer les espèces avec soin. C’est ainsi que sous la rubrique
de l’Amérique méridionale équinoxiale, ou de l ’Inde
orientale, il y aura des sous-divisions à établir. L ’ordre rela-^
t if des régions est déterimné par. le désir de placer les unes
à côté des autres les régions où il y a le plus d’espèces.semblables
ou analogues. Dans la désignation numérique • des
espèces, j ’ai supprimé toutesi'çelfes dont la patrie étoit incertaine
fîètjjjai a|4d^^un poinlÿde dôuW^ laffiih du nom
riquej lorsque» l'à| patrie étant certaimffla. cfes,sàfieiîitipn ■ etoifc
doutif^éî,:,;:^
Examinons «.m’aintenarr^lés1' conduisions generalè^ qu on
peut déduire de» l ,examei^d^t,âi||llé’ .,dé^febleaiit^q)léces 'a la
fin*‘dé ce mémoire; spit quant à la ,distribution aes genr-eS ,
soit-quant à celle^èj^spêejliSs Çet,examen peuiavoiA de 1 inn
1érêt,1soit comme- essairdëîmétliode, sdibeUdui-meme^püJSqné
la famille des^L'égumineùsesV'oùf l ’on coitilplji^;aujourd’hui
tr.ois..mille sept cent5 vi-i^^inqïs!.6^4%f'|&rme environ la
quinzième.« partie des ÿ^é^etàux ^ÇQnnus.
. i . D e la distribution de'& &énf&s£> \fr
J’ai, établi dans un autrèïîéèrist ( ârt.\($éog. bot. du Dict.
destlcienc. nat. vol. 18e, p ^ i^ q u o n pourroit distinguer
les groupes 'endé^niques^pst^-àire dontStpji|#lfcspèces
croissent naturellement dans une même<égièn, e y ^ g r ^ | #
s p o r a d iq u c'est-à-dire. dont les espèces croissent naturels
lement dispersée^ll faut joindre à èes'ideux divisions principales
upe troisième piièèment provisoire^savoir celle des
groupes monotypes, qui» ne êont composés que? d’une seule
espèce, car on\mq£peut savoir s’ils appartiennent A i ’une ou
à l ’autre des diyisionsypfécédentçifè>Sivp'Ous appliquons éeà
distinctions à la familiè re s Légumineuses, nous trouvons
quê sur deux cent* quatretvingts genrès #ont elly/se compose
il y en a soixante-dif'qui ne renferment qu’une seule espèce,
et que nous devons exclure de cet examen. Sur les deux cent