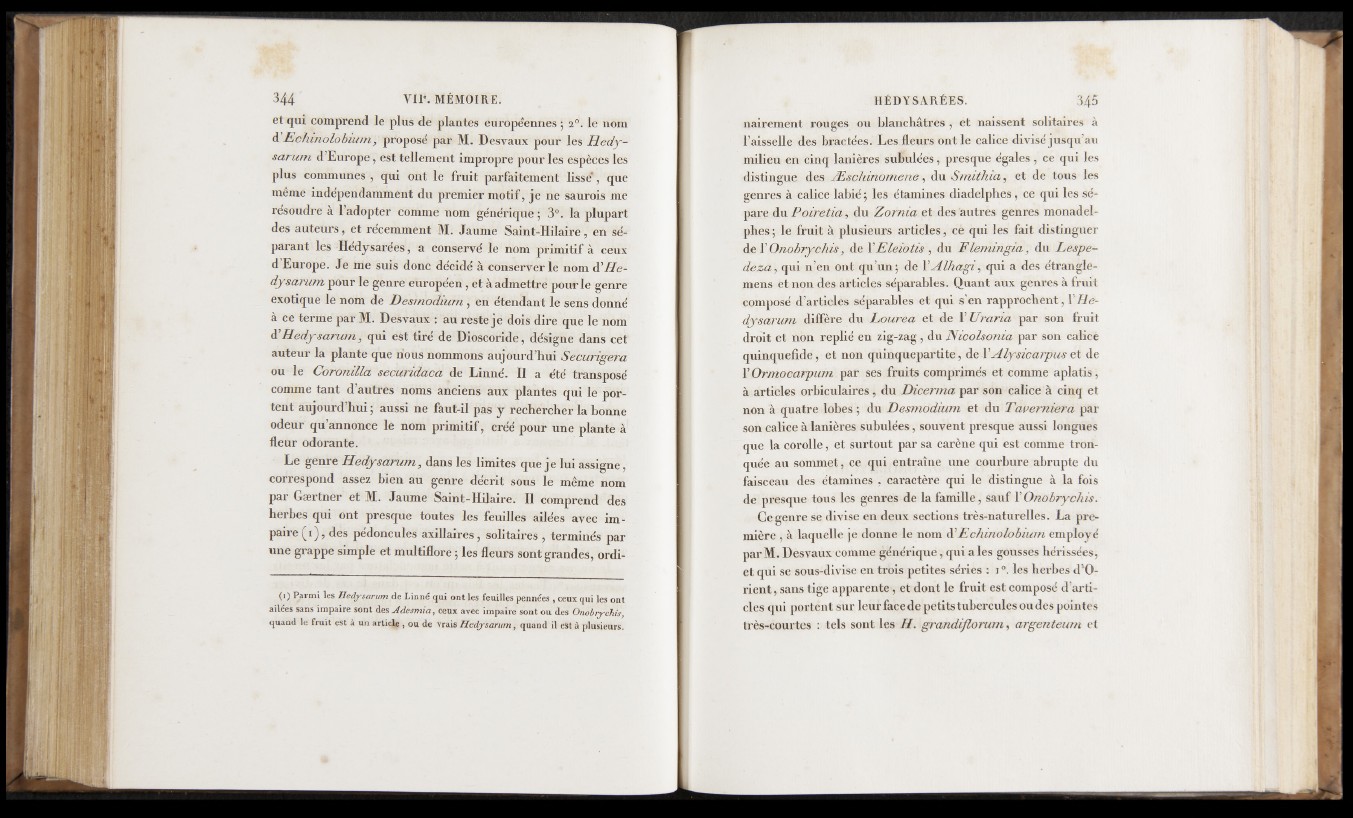
et qui comprend le plus de plantes européennes ; 2d. le nom
à'Eokm olobiüm , s proposé par M. Besyaux pour les Redy®
sarum d’Europe, est tellement impropre pour les espèèès les
plus communes , qui ont le fruit parfaitement lisse?, que
meme indépendamment du premier motif, je ne saurois me
résoudre à l ’adopter edMmè nom la plupart
des auteurs, et réceBùÉtènfr M; Jaumë Saint-Hilair^'eii-^é--
parant les Hedysarèes, a conservé ‘îe ’ nom primitif à ceux
d Europe. Je irie suis donè décidé à conserver le nom d’R b i
dysarum pour le genre etiropéed,; et à admettre pour le genre
exotique le nom de Desrnodiurh, eri eteriâknt lé sens donné
à ce terme par M. Deèvaux : au reàtè jd'tiois'dire que le nom
à’ tledysa rum , qui èàt tiré dé I>iôscüf!de, désigne dans cef
auteur la plante que Sous nommons aujourd’hui^'^vciâig&a
ou le Coronilld sécûrïdàcà de Lifmé. Il a été transposé
comme tant d’autrès noms anciens aux plantes qui le portent
aujourd’hui ; aussi Ue faut-il p a s ÿ rechercher la bonne
odeUr qu’annonce le nom primitif, créé pour une planté à5
fleur odorante.
Le genre Hedÿscùrum, dans les limites’ que je lui assigne,
correspond assez bien au genre déèrit sous îé même nom
par Gærtner et M. Jaume Saint-Hilaire. Il comprend des
herbes qui ont presque toutes les feuilles ailées atfec impaire
f i ) , des pédoncules axillaires, solitaires , terminés par
une grappe simple et multiflore 5 les fleurs sont grandes, ordi- 1
(1) Pprmi les Hetysprifip. f a jL in p é g a i ont les feuilles pennées , ceux qui Je* put
ailées sans impaire sont des Adetmia, ceux avec impaire sont ou des Onàbrychis,
quand le f ru it eSt à un artic j^, ou de Vrais Hedysa rum, quand il eSt à plusieurs.
nairement rouges ou blanchâtrés * et -naissent solitaires à
l ’aisselle des bractées. Les fleurs ont- le calice divisé jusqu’au
milieu, eft oin^Unièhes subulées, presque égale®, ce qui les
distingue des ^A&ehinortiene^ du SmiEkîay et de tous les
genres ù^eajieelabié ; les étamines diadelphes y*ee qui les sépare
du Zornia. ptides-autres genres monadelphes
jde' fruit à plusieurs articles qui lés fait distinguer
deqT , d e^ E le îb tis , du Wd&rékïgiû,:, du Lèsjre-
■ dèg&, qui n’en ont qu’un % d e ¥ A lh a g i , qui a des étrangle-
mens Ct non des articles séparables; Quant aux genres à fruit
composéid’artifâléS: séparables et qui s’en rapprochent, VHe-
é^sarum diffère dvtL ourea et de l ’i/ raz là'pa r son fruit
droit et non replié en zig-zag, àxi fflicolsonia ÿzx son calicè
quinquefide., et non quinquepartite, de X Alysic&rpus et de
V Orm&ectrpum. par ses fruits comprimés et comme aplatis,
à, articles orbiculaires , du Dicerma par son calice à cinq et
non a quatre;lobes $ du Desmbdèum et du Taverniera par
son calice àlanières subulces, souvent presque aiussi longues
que la corolle ÿ/et surtout par sa carène qui est comme tronquée
au sommft, cp qui ^fraine une courbure abrupte du
faisceau des étamines , caractère qui le distingue à la fois
de presque- tous les genres de la famille, sauf VOnbbrychis.
, ; Ce genre se divise en deux sections très-naturelles. La première
, à laquelle je donne le nom X Echinolobiurn employé
par M. Dèsvaux comme générique, qui a les- gôttsses hérissées,
et qui se sous-divise en trois petites séries : 1°. les herbes d’O-
rient, sans tige apparente*,- et dont le fruit est composé d’articles
qui portent sur leur face de petits tubercules ou des pointes
très-courtes : tels sont les H . grandiflorum, argenteum et