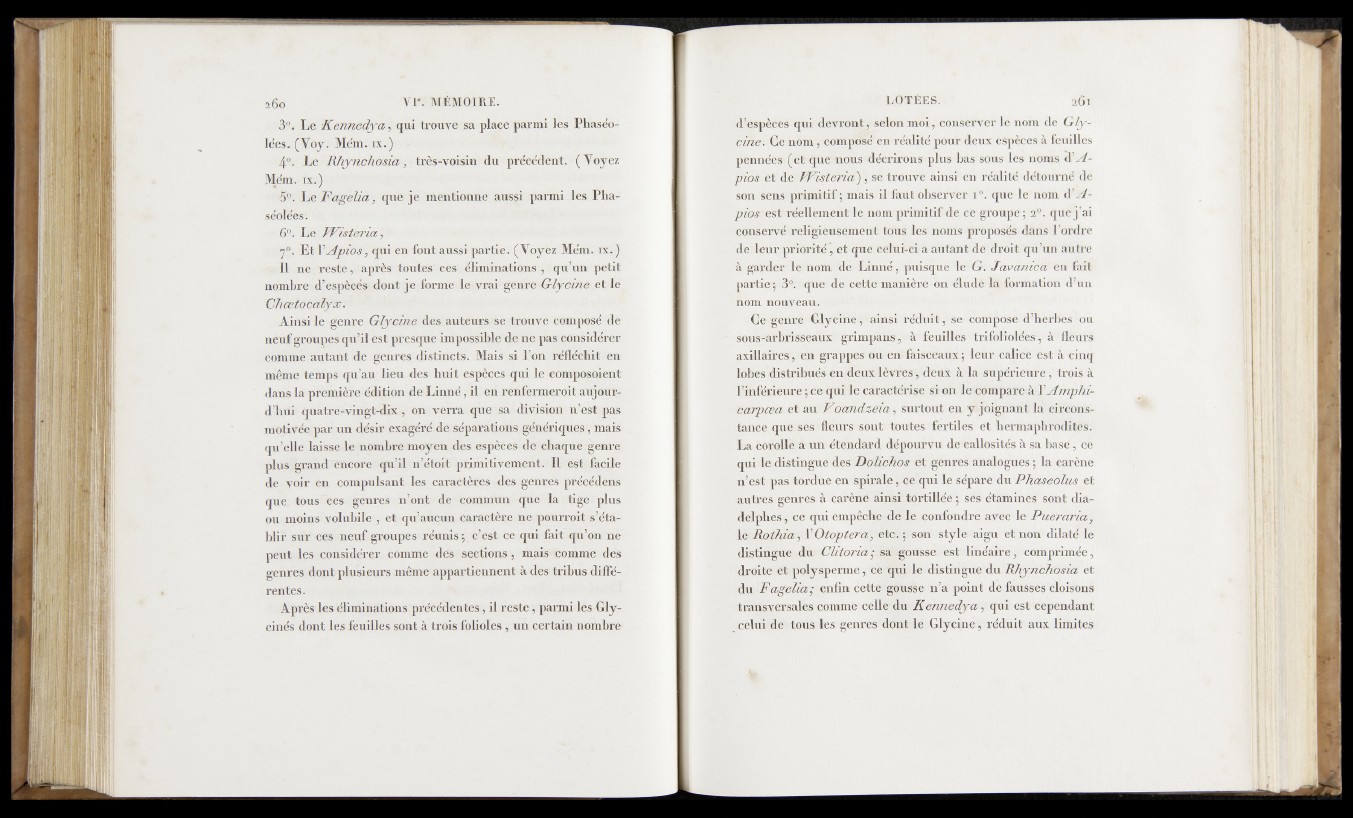
. :-3°* Le K enn edya, qui trouve sa place parmi les Ebaséo-
lées. (Foy: Mém. ixi§y*''|
4a. Le R hynchosia, très-voisin du précédant.'* ( Fôysez
'#V Le F&gëÊa , que je mentionne ausii parmi lesvPha;-
séoMesi jgjjj
ôOLê- JVisteria )
Et qui en- font aussi parti«p» o y è l^ em .. ix. )
Il nèl^vëste^tiprès toutesnces1 éliminbti<pis4*£ qu’un petit
noinbre d’espèce# dont je forme le *vrai“-genre-tGJfSinfcetfié
Cheet&ô'él'fx$9 j
Ainsi le ? genre G ^ éin e des* auteurs-se to u y e composé ;dë
neuf groupes qu’il est presque impossible^dênepas-copsidérer
comme autant de genres, distiûbm 4Mbisw 1,’on Réfléchit (en
même temps qu’au lieu des huit espèces^qui le composoient
dans la première édition de Linné, il. en renfçrmeroit aûjêâiij;
dlfanË! quatre-vingt-dix*-, on yerra£g$ie°'sa » division n’est pas
motrféfipar uU désir exagéré de séparatiq|%,g^ériqu8S', mais
qu’elle laissede nombre moyenfdê^îéspèce&idb chaque IgeUjÈe
plus grand ^encore qu’il u’ëtôit primitivement:'!! est ^facile
de voir eu compulsant les caractères des.genres précédens'
que. tousRjfes: genres n’ont ^de j commun que la J tige- plus?
ou moins volubile , et-qu’aucun caractère -æ pourvoit * s’établir
sur i(S@i4neuf groupes réunis j^è’ustîèe qui fait qu’on ne
peut les considérer comme dés-.sections , mais^omme des
genres dont plusieurs même appartiennent à des? tribus différentes.
y
: Aprèsiles éliminations précédentes, il reste) parmi les-Gly-
cinés dont les feuilles sont à trois folioles, un certain nombre
d’eSpèeês^qüi devrônÆyselon nïoi éëdnëerverde norn de- G'ty* 1
cz>ze. Ce nom, cOm{^ee#^éllÉé^our déu^é^ècès à feuilles
pennées|®b'qùi^n0us?déc^irons^jplUS;bàs-i'sdusfèfé^*noms d’ A -
réalité détourné | dé
so'^f^@xp#iti^tifl^mMsiil'fautlf^erVêh,®^.' que1 lefhoin d^-M-
^©;^t^u»réellemé|tllle,nom primitif d^èë1 groupé1; * j ’ai
canseuvéf,religiéusemênt tous les noms pîpp'os^ dans l ’ordre
deïieTS?n^iS#^fâLque cëluLë^àaütaritidéld’rëi# qu’un autre
à'’gaVdêrr:fe nom de Linné-, le fa it1
parti e^|®^(^e»xpe^étië^’nianière ê'iiëéMd'^ la formation d^Mti
nom ndûyëau. ?
#émuïb,' se»f^)nîp0sé d^Herbes 'ou
-sèrfeFd^^sseaù^^^^pSHiS'-,- -à ^«.niltes* tri fol ffèurs
axillaires.,mnîgràwpes' ou en^faisEéana: 5 leur ctdï|spfiï§te à cinq
lobes<disÉribués en<deuxdèvne&)$4ët^ à la Mpériètorê ^tioi^fà'
l ’ïi&fétfedèéyee qui fê carÉ#éàl^|iiSS: on dèÆémpÿïrelt^r^m^i^
f^éf^eê'kpèâ s u r t o u t en ^bifgnanMa eircons)'
feaskiçi ÿ^^N®uks^sont!,’fôi0tfësitfertiïeét e’t ’ befmàphrodïtës.
La corollë;âpûr£i étendard dépëuÈvu d^Mlcfeit®^^? baW , 'éé
qui le"/bisfingue deS D oïioÂ& i.^ g’enres^àMdogîtes la carène
InSé^!1 pas tordue en 'spirale, ce qui le Répare du PhcÇseëîus et
autres-*genres à caréné ainsiïïthtillée^ses^ étàtnineà sont dia-
delplues,»ce qui empêc-lje^de le .confondre a»vbe le Ptmray'îà-}
lé Roihiïx ^ 'Q to p tera , I été.’ fo-Son <&tjrle%¥g|ufet non dilaté le
distingue du jvâasâgouSSevf'ëst linéairjjSfl comprimée,’
droiteintepolysperme, ©biqui le distingue du Rdiynèfcôstd et
du- P a g e lia ■ *enfin èeftétgèttsïe n’a point de fausses cloisons
transversales comme celle du Kennêdyctf^ qui est Cependant
.jcêluiidig tous des: genrestdont le Glycine ,1 réduit aux limites