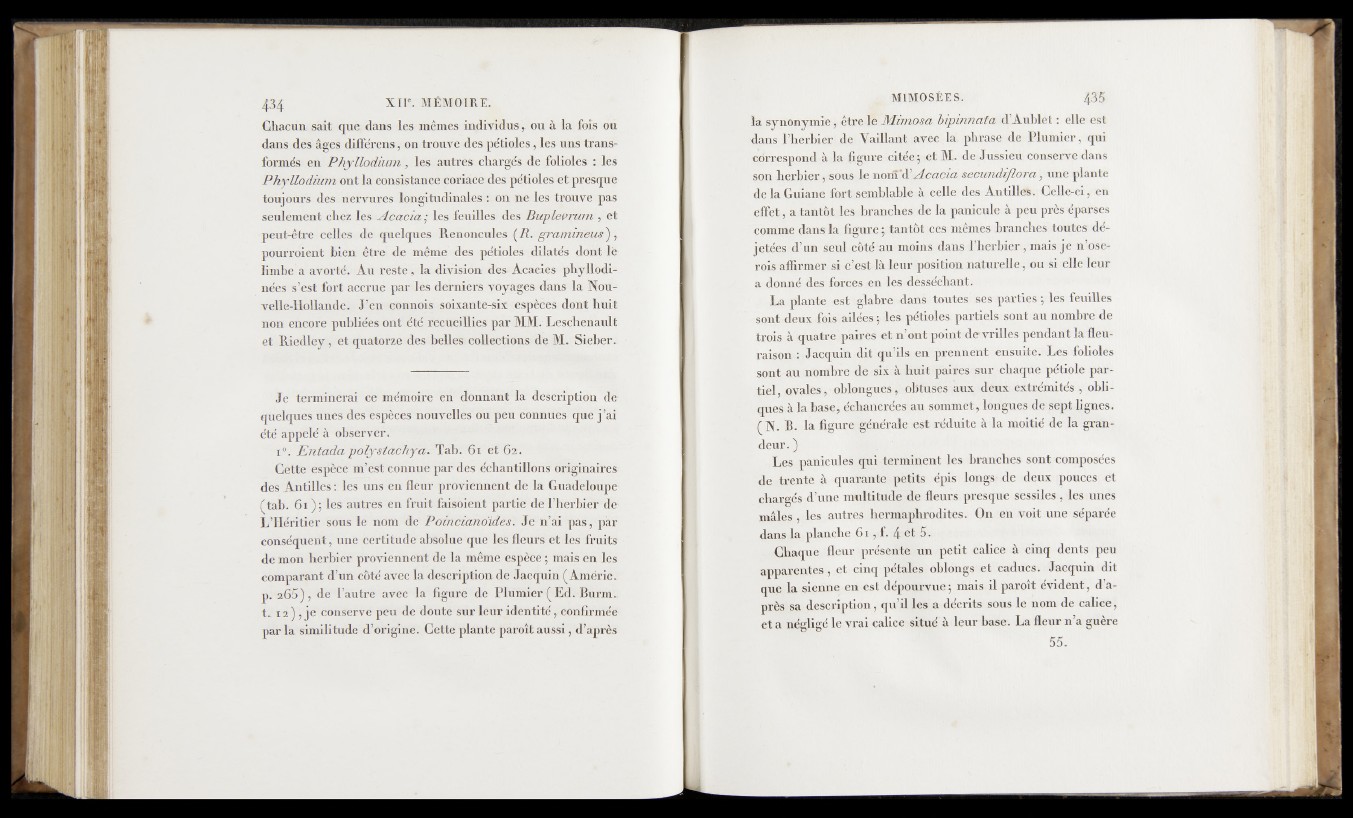
Chacun sait que dans les mêmes individus ou à la fois ou
dans des âges différens, on trouve des pétioles, les uns transformés
en P h jllo d ium , les autres, charges de folioles : les
P kyllodiùm ont la consistance coriace, des pétioles et presque
toujours des nervures longitudinales^on ne les trouve pas
seulement chez \es \Acacia ,* les feuilles des Buplevrum , et
peut-être celles de quelques Henonculés^(i& gramineus'),
pourroient bien être de même des pétioles dilatés dont le
limbe a avorte. Au reste, la division des*Àcacies pbyllodi-
nées s’est fort accrue par les derniers voyages dans la Nouvelle
Hollande. J’en connois soixante-six espèces dont1 huit
non encore publiées ont été recueillies par MM. Lesebehault
et Riedley, et quatorze des belles, collections de -M. Sieber.
Je terminerai ee mémoire eh donnant la- desefri^ptidn de
quelques unes des espèces nouvèlles ou peu connîïés qué j ’ai
été appelé à observer.
i°. Entada pofy&tààhyarlïaib. 6r ef'6^ÎJv ‘
Cette espèce m’esteônnue pardes échantillons Originaires
des Antilles : les uns en fleur proviennent de la Guadeloupe
(tab. 61)5 les autres en fruit faisoient partie de l ’herbiér de-
L ’Héritier sous le nom de Potncicindides. Je n’ai pas, par
conséquent, une certitude absolue que les fleurs et les fruits
de mon herbier proviennent de la même espècé ; mais en les
comparant d’un côté avec la description de Jacquin (Améric.
p. 26S)', de l ’autre avec la figure de Plumier ( Ed. Burm..
t_ 12 ) 5 je conserve peu de doute sur leur identité, confirmée
par la similitude d’origine. Cette plante paroît aussi, d’après
la synonyniie ^ êtrede ^i^twscL'hipiTvnaici d ’Aublet : elle est
dans l ’herbier d^Aaillant avec,la. phrase de Plumier, qui
correspond à la figure icitée;; *et JL de.Jussieu conserve dans
son herbier ,,s.ous4e nom*à^Acaam^eeuTêdiflora, une plante
de la Goiiane fort semblable h, celle des Antilles. Celle-ci, en
e lfe t, a tantôt les-branches-de la panicule à peu près éparses
comme dans la, figure .5 tantôipces) mêmes .branches toutes dé-
jietéps d ’uh seul côté :au moins dans l ’herbier, mais; je n’ose^
rois affirmer sieiestdà leur .position naturelle, ou si elle leur
a donné des forces en -les?desséchant.
La plante -est ; glabre dans tmrfcesijses parties ; les feuilles
sont <#ux ïfeisiâdLées j îles pétioles, partiels ;sont au nombre de
trois.àvqpàtrê .paires et n ’ont point devrilles pendant; la fleu-
raisana Jacquin dit qu’ils en prennént^ènsuite. Les folioles
sont au nonfl^e^rspK à huit paires sur chaque pétiole partiel,
ovales, oblonguejs^ obtuses aux deux extrémités gj obliques
à la .bâsg, échaucrées au sommet, longues de sept lignes.
la figurejîgénérale est réduite à la moitié de la grandeur.,
Les panicules qui terminent les branches sont composées
de trente ^ quarante petits épis longSf .de deux pouces et
changés d’une multitude de fleurs presque sessiles, les unes
mâles , les autres hermaphrodites. On en voit une séparée
dans la planche 61 ,*f. 4fet 5-
;fleur nrésente un petit calice à cinq dents peu
apparentes , ct cinq pétales oblongs et cadues. Jaequin dit
que la sienne en est dépourvue 5 mais il paroît évident , d’après
sa description, qu’il les a-décrits sous le nom de calice,
et a négligé le vrai calice situé à leur base. La fleur n’a guère