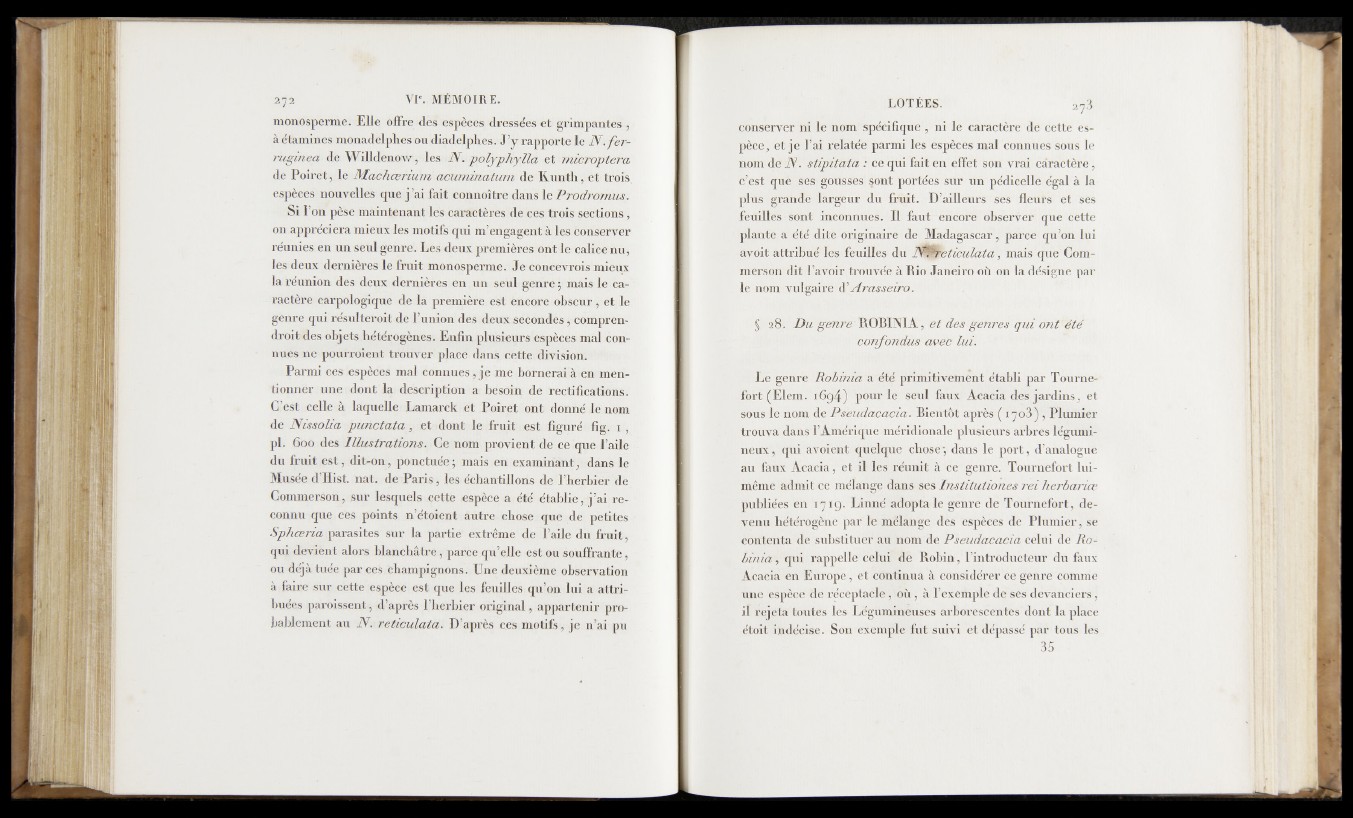
monosperme. Elle offre des;èspèeespdressées et grimpantes:^
à étamines monadélphesou diadelphes. J’y rapporte le
ruginea de Willdenow, ÙBknMmpoljpBy\l^ et iwiictoptera
de Poiret, le Mackmrman acümimttum, de Kunth ÿét' trois,
espèces nouvelleSique.j’ai fait connoître dans le Prodromus.
Si l’oDrpèüse maintenant lés-carfctères>de>ifoes trois seëtidàxs^
on appréciera mieux les motifs qui m’engagent à’les èonserver
réunies en un seul genre. Lestdeux premdèrès^ntll^calÿéë nuj
les-deux dernières le fruit monosperme. Je eoneeyrois mieux
la réunion des deux dernières en pan, seul1 genre*;’ mais le -ca-
^rfittE^Hi^irpolo^ique de la prenûè#éiesténcaretobSenr‘j'tét|4e
génre qm résulteroit de l ’union, des îdeux'nééirodés^rèompren-
droit Ües objets hétérogènes. Ejafin,plusieurs espèces-mal con-
MÉrafepourrdient %r@uv1^ÿlabeldans ^tlSMiÿsislOÈp^iS
Parmi eesdespèees mal eomnvuës'., je ,me .bofneràÜàâèn men-
tiopnftriuiBettdont las description a* besoin de irectificéMtons.
G>’est celle à laquelle Lamarclc ; et .Poiret ont donné Je nom
de NUspüa jpùnctata^tât d o n tle fruit aest figuré'-fig. 1 ,
pl. êpéodes Illu stra tion s. * Ge nom-provient de |sëique,l!aile
du fruit e s t, dit-on, ponctuée ; mais : en examinant/! *dans le
Musée d’His;t.:nat. de-Paris , les-échantillons de l ’herbier*'de
GommersoBç, sur lesquels .cette espèce a été établie ,'ij’aiirede
petites
Spheeriu »parasites sur la partie extrême' de l ’aile dir fruit ,
qui devront alors blanchâtre, parée qu’ elle est ou souffrante,
ou déjà tuée par ces champignons. Une deuxième; observation
à faire sur cette espècerest que les feuilles qu’on lui a attribuées
paroissent-, d ’après l ’herbier original, appartenir probablement
au N .'.reim d'ata. D ’après ces motifs-» je n’ai pu
conserver ni le nom spéci fique ‘, ni le caractère de cette espèce,
e tj'jë j’ai relatée parmi les espèces mal connues sons le
nonrd&el'?.'yffîfijmêtiStBce qui fait en effet son vrai caractère,
efëst qudfffè&fgdüssfes' §ont portées sur un pédicelle égal à la
plus graiide 'largeur du fruit. D ’ailleurs ses fleufs et ses
feiliïlës sont inconnues. Il fautérièorè observer que cette
plante-a été dite-originaire de Madagascar, parce qu’on lui
-avoit attribué les feuilles* du ticu la ta , mais que Gom-
mrër^oh'dit' l ’avoir trouvéê à Rio Janeiro où on la désigne par
& " nom;i vCflgà'Sré 1 d’^rcùsse^j^Pm
D u g e tif& ROBIHIA, \èt âe‘è"genres qu i o n t'é té
^ Wck^oiitiÈéMpèc lui.
Le "genre obitirét'a"éfé primitivement établi par Tourne-
fort (''EIèid.'’i ^ ^ ‘'>pour le seul faux Acacia' des jardins^- et
sous le nom de$il^Bèeùdùcaëia. Bientôt après ( i Plumier
trouva dans l’Amérique méridionale plusieurs arbres légumi-
.nîèiÉc*, qui“âvoient quelque;chose*, dans le port, d’analoguë
au faux Acacia, et? il les réunit à ce genre. Tournefort lui-
même admit ce mélange dans ses Institutiones rei herbarioe
publiées en ii|.19. Linné adopta le genre de Tournefort, de-
venu'hétérogène par le mélange dès Espèces de. Plumier, se
contenta' de substituer au nom de Pseudacaeia celui de Ro-
qui rappelle celui dfe Robin, l ’introducteur du faux
Acacia ’en Europe, ètlcontinua à considérer ëe genre comme
une espèce de réceptacle ,ioù , à l ’exemple de ses devâneiers,
il rejeta toutes les Légumineuses arborescentes dont la place
étoit iûdécise. Son exemple fut suivi et dépassé par tous les
35