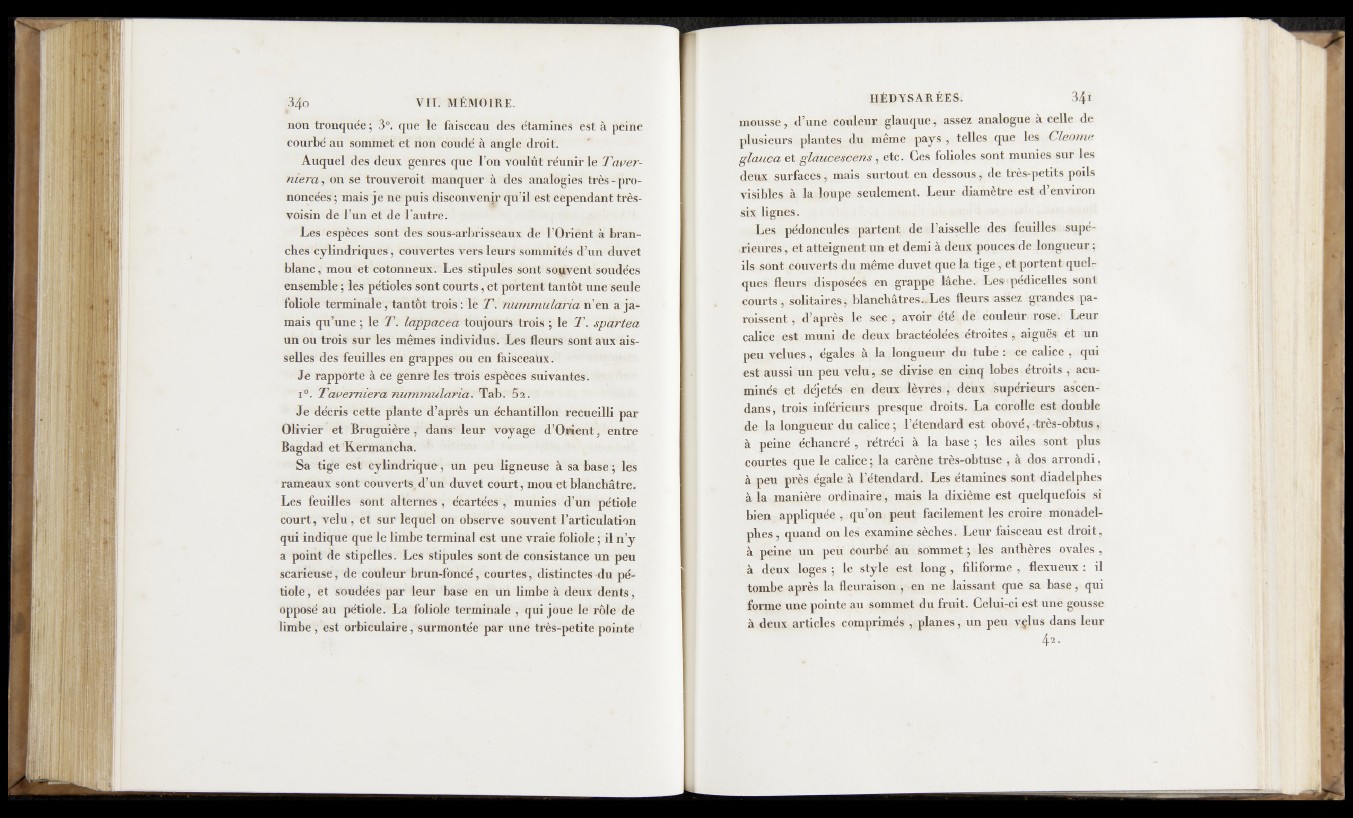
ètMo vu. mémoire.
non tronquée; 3°. que le faisceau dËè étamines est à péine
courbé au sommet èt non. Coudé à‘angle droit.
Auquel'des deux genres que l ’on voulût réunir le Taçer-
n iera , on se trouverait manquer à des analogies très- prononcées
; mais je ne puis disconvenir qü’il est cependant tfès-
voisin de l ’un et de l ’autre.
Les espèces sont des sous^arbrisseaux de l ’Oriênt à branches
cylindriques , couvertes vers'leurssoiiiteés d’un duvet
blanc, mou et cotonneux. Les stipules sont sopvent-sdttdées
ensemble ; les pétioles sont courts, et portent tantôt une seule
foliole terminale’, tantôt trois : lé T . 'numrnuhlria n’en a ja mais
qu’une $ le T . lappUcêa; toujoürs trais ; le T:, spdrtea
un ou trois sur les mêmes individus. ‘Les fleurs sont aUx<Ûis-
selles des feuilles en grappes ou en fkisceahx.
Je rapporte à èe genre les trois éSpètés suivantes.
■ jïo. Tavetriiera numimildtia. Tab: I
Jë décris cettë plante d’après un échantillon* recueilli par
Olivier et B ru gu iè red an s '- leur voyage d’Orient, entre
Bagdad et Kermancha. '
Sa tigë Cst^Êylindrique, un peu ligneuse à sa base ; les
rameaux sont couverts,d’un duvet court, mou et blanchâtre.
Les feuilles sont alternes , écartées', munies d’ufr pétiole
court, Velu, et sur lequel on observe souvent l ’articulation
qui indiqué que le limbe terminal est une vraie foliole ; il n ’y
a point de stipelles. Les stipules sont de consistance un peu
scarieuse, de cotileur brün-foncé, courtes, distinctes *du pétiole,
et soudées par leur base en un limbe à deux dents,
Opposé au pétiole. La foliole terminale , qui joue le rôle de
limbe, est orbicülaire, surmontée par une très-petite pointe '
mousse, d’une couleuijglauque, assez analogue,à celle de
plusieurs plantes du même pays , telles que les nÊleome
g^auca^X.glàuQë^&tfis, etc. Çes folioles,sont munies sur les
deux su r fa is ,, mais, surtout en dessous.,, de très-petits poils
visibles- à la hmpe seulement. Leur diamètre est xi’environ
six lignes.
Les pédoncules partent de faisselle deo ,fenillesHisapé-
»rieurds, et atteignent un et demi à deux pouces’de longueur ;
il®S;Qa#^ipyerts du mêmeiduvetgue la tige y eàportenbquelr
quesi fleurs disposées en grappe lâche.- Les«pedicéUes sont
courts y solitaires j blanchâtipg^Les fleurs sas&ez grandes -.paraissent
, d’après ,1e sec , avoir ét@idfe‘ doml€ïUrj rasei.vLeur
calice est muni de deux braetédée^étroitesi 4 aignës; èt un
peu velues, égalefyàtj la longueur du tubè : ?<fe calice , qui
est aussi Un peu velu,.se divise en cinq lobes » étroits , acu-
minés tjt .déjetés en deux lèvres f déûx supérieurs ascen-
dans, trois intérieurs presque droits. La corolle est double
de la longueur du calice y l’étendard est obové, -très-obtus,
à peine éehancré , «rétréci à la base \ les, ailes sont plus
courtes que le calice y la carène très-obtuse , à dos arrondi,
à peu près,égide, ià l ’étendard. Les-étamines sont diadelpbes
à lu manière ordinaire , mais la dixième est quelquefois si
bien appliquée,, qu’on peut facilement les croire monadel-
phes, quand ;pn les examine sèches. Leur faisceau, est jurait,
à peine un peû dourbîé an sommet jsles anthères ovales,
à deux loges ; le stylç est long , filiforme , flexuenx : il
tombe après la fleuraison»,*en ne laissant que sa base, qui
forme une pointe au sommet du fruit. Celui-ci est une gousse
à deux articles comprimés , planes, un peu vglus dans leur
4v.