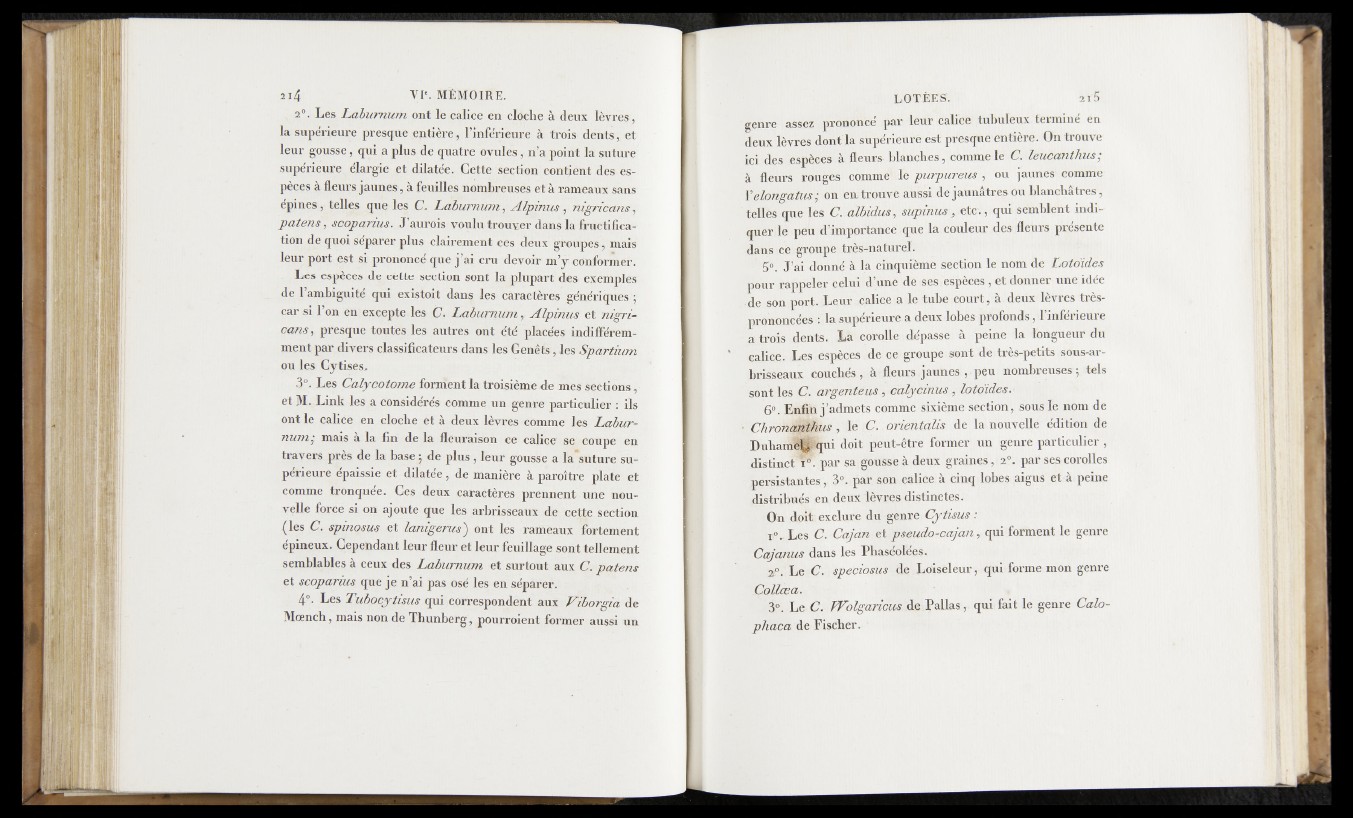
È 2°. Les Labumum ont le calice en cloche à deux lèvres,
la supérieure presque entière , l ’inferieure à trois dents,. et
leur gousse , qui a plus de quatre ovules, n’a point la suture
supérieure élargie et dilatée. Cette section contient desC^s-’
pèces à fleurs jaunes, à feuilles nombreuses et à rameaux sans
épines, telles que les C. Labum um , Alpinus^ nigricans,
p a ten s, seoparius. .J’aurois voulu trouver dansla-fructifica-
tion de quoi séparer plus clairement ces deux groupes, mais
leur port est si prononcé que j ’ai cru devoir m’y conformer.
Les espèces de,cètte sectinn sont la plupart des exemples
de l ’ambiguité qui existait dans les càractères génériques ;
car si l ’on en excepte les C. L abum um , A lp inus éVnigri-
oans, presque toutes les autres ont été ^placées indifféremment
par divers classificateurs dans les Genêés, les Spartium
ou les Cytises,
Les Qafycotome forment la troisième de mes-sjbfetiéns,
et >1. Link les a considérés comme un genre particulier : ils
ont le calice en cloche et à deux lèvres comme les Labur-
num j mais a la fin de la flcuraison ce calice se, coupe f en
travers près de la base ; dë plus, leur gousse a la suture stife
périeure épaissie et dilatée, de manière à paroître pïafe et
comme tjonquee. Ces deux caractères prennent une nouvelle
force si on ajoute que les arbrisseaux de cette, section
(les C. spinosus et lanigerus) eut les rameaux fortement
épineux. Cependant leur fleur et leur feuillage sont tellement
semblables à ceux des Labumum et surtout aux C i patens
et seoparius que je n’ai pas osé les en séparer.
4°- Les Tukpcytisus qui | correspondent aux V B o rg ia de
Moench, mais non de Thunberg, pourroient former aussi un
genre assez prononcé par leur calice tubuleux terminé en
deux lèvres dont la supérieure est presqtie entière. On trouve
ici des espèces ai^eurs blanches, comme le ë,kleucanthus;
à fleurs rôü^s commede. purpur^ux^Êon jaunes1- comme-
l ’ëlongatüs^ on en trouveîùussi de jaunâtres ou blanchâtres,
telles que les C..albidw\ supm&ust,Mcr., quiSemblent indiquer
le tpeu d’importance -qiie la couleur des fleurs présente
dans ce groupe très-jhaturéL
^If-d'onne % la cinquième sëdti'on le nom de L otîm es
pour rappeler celui d’une dè tse^espèces, et donner une idée
de somport. Leur nalicejâtle tube cpurt,fà deux lèvres très-
prononcées : la sppérièure.a deux lobes profonds, l ’inférieure
a trois dents. La ïç^lié-.dépasse à peipedai longueur du
caiiee. Les espèces d e pe groupe sont de,très-petits .sous-arbrisseaux
couchés, à-fleurs faunes , peu nombreuses-; tels
sontdês Æ 'mgeritàus^ » ëül^m uS^lM m des. ■ -
6?. Enfin j ’admets comme sixième section!,;,sousfe nom de
T'ÇhronqjjjÈkus , leM/<P.rimtalis de la n o ü t f é d i t i o n de
Dubamâ0qui doit peut-être former un -genre particulier,
d îs t in c tV p a r sa-gousse à deux graines ,i'a£. parsescorolles
persistantes,-3°. par sonc4licet à , fiinq » lobes aigus e t à peine
distribués en deux lèvresdistinGtes,- .
On doit exclure du genre. Gyiisus :
r°. Les Q .'C ajan eï,p seudo-cajanr qui forment le genre
Cajanus dans les Phaséolegs.
2?. LefÇ. t speciosusi de Loisèleur, qui forme mon genre
G olloe a.
3°. Le C. W b lg am é ts^ Pallas, qui: fait le genre Calo-
p ha ca de Fischer.