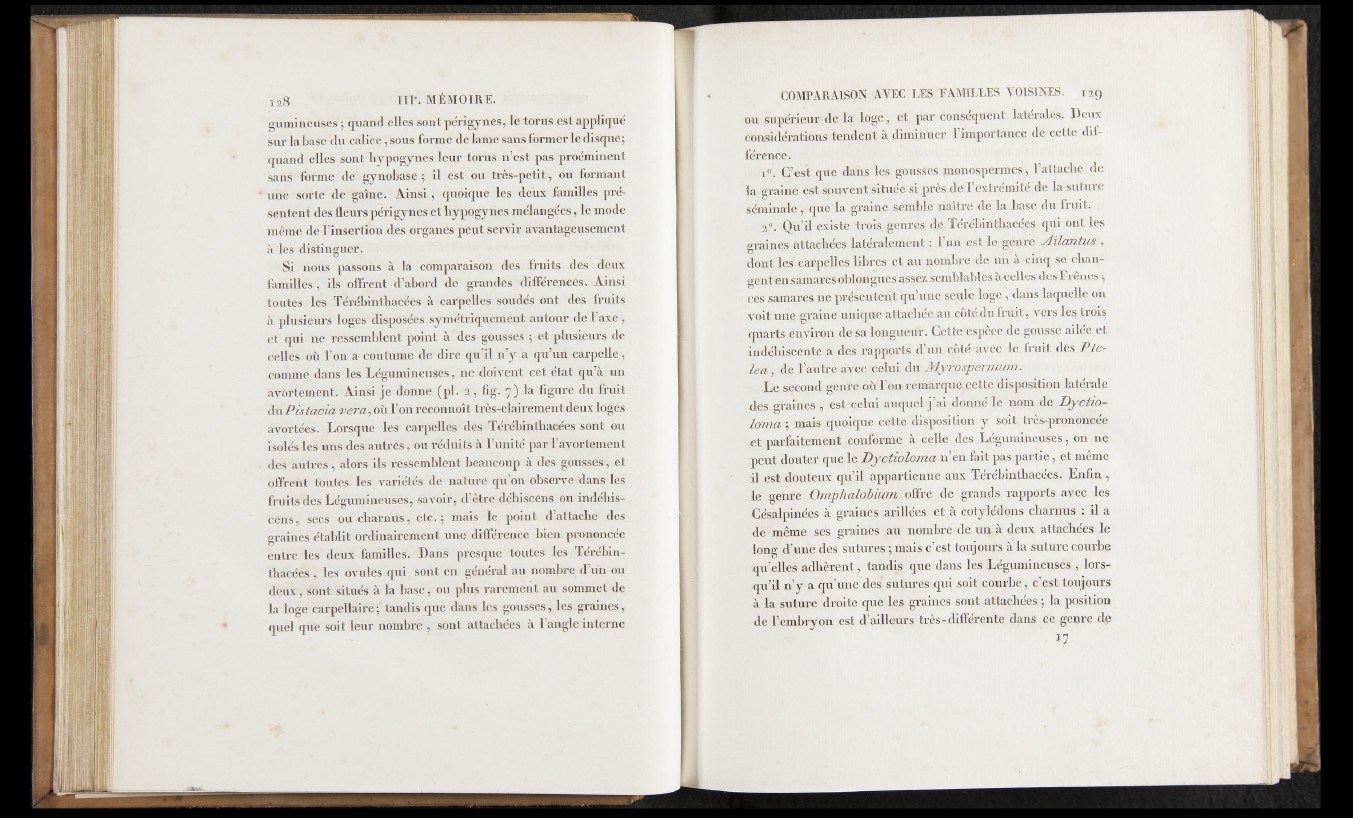
gumineuses; quàndièllf^onît<péra^ïie&, le torus,#st appliqué
sur labasé^èu ètffiëë', sous forme’.lélame sans former le disquef
quand ellbè/ifont hypogynes: leur torus n ’est -,pas;ïproéimnent
sans vforme ^dë <|^m®bas£$i$l-est o|a^1æ,ès^peJtfcfc“5s ou formant
u n e ’sorte' de^gaîne; Ainsi ^quoique les* deù&ufgmilfes présentent
des fleurspërigyneset hy?p®gÿ«es;mélangées, lé mode
même de r in s e r t io n ^ |lM ^ n é l ^ ^ ^ serÿir à\^ntagêusèment
à’les distinguer. 4
^§f- nous*pàSsohsî à la comparaison jd#siffBui|ts --des ■ déux
familles, ils ofFrent'nTâbord de ’gta.M'SMiffërènees^Aànsi
tdùMs ries, Térébi ntha<Éés.s à carpelles soudés ïtkto « t e 1 fruits
à plusieurs loges dispV&ées' symëtri^ètaé^'uutOTM'ÿde^l^j&ë^
èVqui ne' ressemblent point1 et- pfosipspMfêfe
celles où l’on a'coutume -dë-dirè^u’il rf$É~a=qu’urï Carpelle,
comme, dans lës&kégùnfineùses, jne/doiven cet état qu(à un
avortement/’Ainsi je,donne-(pi. la figure du fruit
ddPz’Mfeél^e^fdù^on-reconnoîttrès-.Glàirementdeux.logês'
avortées.-Lorsque les- carpelltes^dês^WéfébiÉtbaigaées sont ou
isolés les uns des autres;, bu^lduitsfâ1'l’unité par l*W@'B%nent-
dek’IftteesV alors ils'ressemblent'béaucbup à dès/goùsèé&^et
offrent tbutesfiles*rvariétés € e nalterè qu’on^bSOryeffians les
fruits tles tégumineusès^:Savoir, d’être déhiscens ouindéhis^
cens/*âbcs ou charnu^,'etc. j mais le point d’attache des
graines établit ordinairément une différence bien, prononcée
entre lés? deiix familles.^Dans presque^tèutes- TérébintbacéeS
^lés nvulesqUL soutenu général au nombre d’un ou
deux,^o’n t situés à la base, où plus'rarement an sommet de
la loge càrpellâiref tandis que dan» leshgousses lesggràines^
quel que soiHeur nombre , sont attachées à l’angle interne
ou supérieur!de Mfoge j ^fïpajE c o n f i e n t latérales; Peux
con&àdératiéns tendentïà diminuer ,1’Importance de cette dif-
férence.
i 0. Æ’çÀfqUbtidpfe les puteestfionôsperirieÿ1, l’attache de
la gEcdntê ,è st-||ù ]v én t;s^ de la Suture
sémdnafté^ïl^|ie la graipp*se%ihle paître d e là base du fruit;su
-Qu’il-, existe?Ctrois^gehres, do >Tér ébinthacces qui ont les
grainesiW^çhées^ latéralement : runsq^t'-lpfîgênfê*Jd'tfiimtup, ,
dont les^ripU'JpSî,libres, el'aulMmbrîe^de un à cinq sé chan-
^ëp^4Â^àmar%*‘€iblori gues.ass|f semblables àcellësi des Frênes ;
;ceS'S,âniai|és ufiprës'eùtenf quune' seul®1 loge, dans laquelle-op.
jÉYiiTttiiTi ijm e unique»attacbée^ati?p|»fo;du fr^it j yej^Ies trois
quarts ej^irqii? dfesa longue ifr. de gousse pile© et.
iudébiscenteKa|doS| rapports d’u ji'^té'a^qc le_frpil des l ^ l ^
,$@&0?sâe l ’a u t ^ é ^ o q ^ j u L d ^ ^ i ÿ ^ ^ W ^
rf^ l e second g en jre^ row ép a^ ÿ^ lfté ld isp o s itio n latérale
tAes’ graidês X§;1 î'Oebnf auquehj|^Üonné le 'nomade ^y_c,tio -
quoique cette'disposji|a;^n|ïr^ soit trèsqorononeée
,et parfaitement conforme àiplfe^des Pjégumineules, on ne
peut(doutep qu| le ;^4siiQ$<$^a?jCL en.fait.pas partie, et même
ikest douteux qu’il appartienne aux* Térébinfehaeées. Enfin ,
le genre Qm phaloM u^ oprevde. grands rapports avec les
Lfésa]q>inées à grainë^^illées»eh;à|.èf^|édons cbarupA: il a
de même i^sps g ra ip ^ au nombre de u%à deux attaehéê&ie
long d’une ,d§js sutures,5 niais c’est toujpqrs$-la suture courbo
qu’elles adhèrent tandis^ qüe dans les! Légumineuses,* lors-
qu’i ln f e a qu’un.e dés* sutures qui soi4courbe r* q^st toujours
u la, suture droite qpe -leA graines sopt attachées ; la position
de l ’embryon esfc d’ailleurs très - différente dans ce genre de