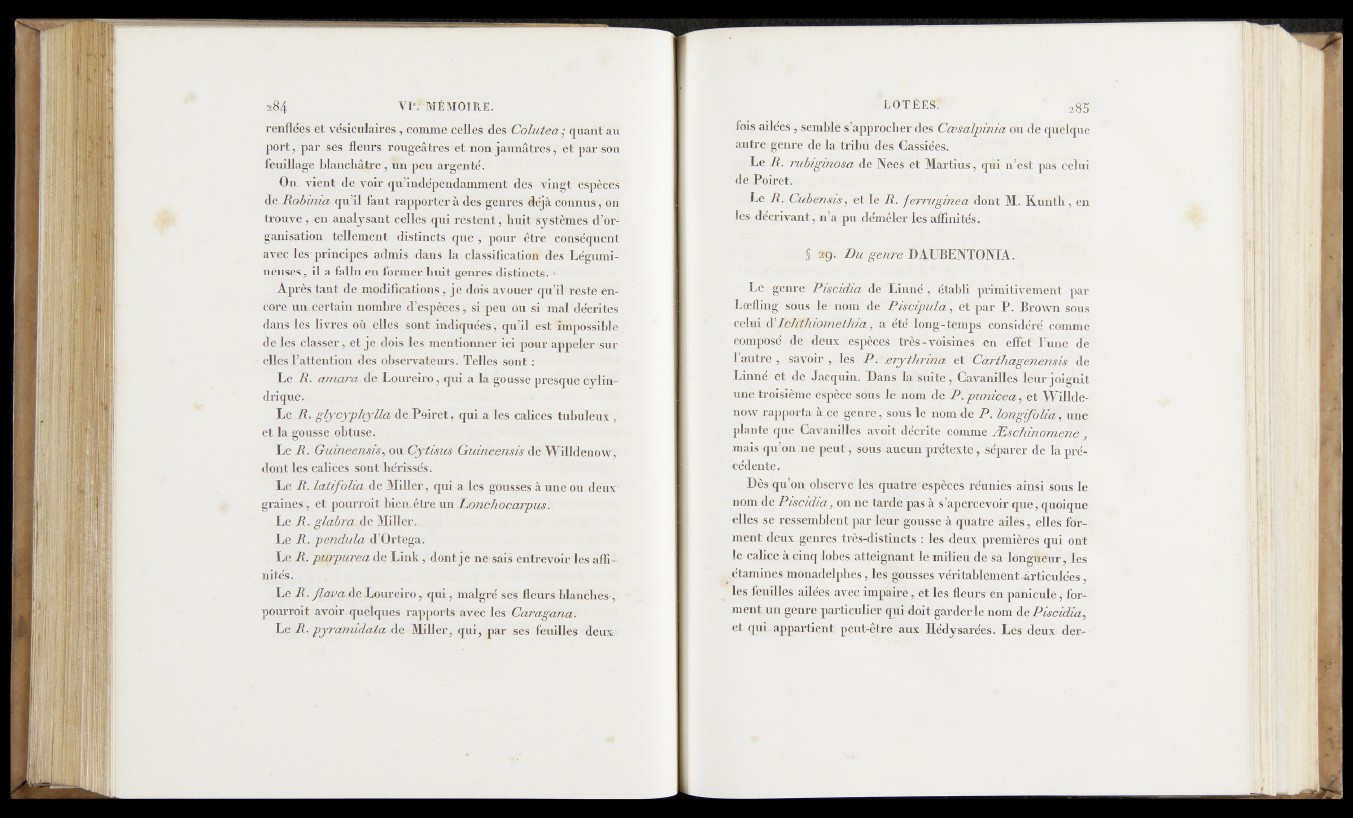
renflées et vésiculaires, comme celles des Càlutea ; quant au
port, par ses fleurs rougeâtres et non jaunâtreS/'etfar son
feuillage blanchâtre, un peu argenté; .;
On. vient de. voir qu’indépendamment des vingt espèces
àeRobima qu’il faut rapporter à des genres #éj à connus l bn
trouve, en analysant celles qui restent, huit systèmes d’organisation
tellement distincts que /pour être conséquent
avec les principes admis dans la classificatiolf dès’ Légumineuses
, il a fallu en former ■ 'huit genres distincts. •
Après tant de modifications/je dois avouer qu’il#esteenJ
core uneertain nombre d’espèces^-si peu~<5k si mal décrites
dans les livres oh. elles spnt indiquées ,ujiuiil est Impossible
d$ les classer, et je dois lès; mentionner ici pour appeler sur
elles l ’attention des observateurs .iTeljes sont :
Le R. amara. èe Loureiro, qui a là gousse presque é^lin-
drique.
Le R ..g ljcy p h y lla de. Poiret, qui .a les calices tubuleux,
e^la gousse obtuse. ■
Le R . Guineensis, ou Oytisus-Guineensisdê Willdenow>
dont les qajicês sont, hérissés.
Le R. la tifolù i.à e Miller, qui a les gousses à une ou detbc
graines ,, et paurroit bien, être un JÈQ^chocarputfi:-
Le R. glabra de Miller...
Le R .p en d u la d’Ortegav
Le R. purpurea de L in k , dont jé meisais entrevoir les affi-
nités..
Le R . ./fujjEf^de Loureiro, q u i, malgré ses fleurstMâttlhès,
pourroit avoir .quelques .rapporter avec les. Caragâna.
Le R .p ^ ram id a ta ^ Miller, qui,.par ses feuilles deux
fois ailees, semblé s’approcher des Ccesdl^îni'a '6u dè qifèlflue
autre'genre de la tribu de’s (üassiées.
*^Le R . "mbigiÆMxddvMéfjiet Martius, qui h’ést pas cèlüi
de.Poiret.
Le R r Gubensjs, et Te 7?. dont Ml E.unth, en
lé§ décrivant, n’a pu démêler les affinités-. |
' s % . D u p « » 4 lBi^TONrA :.
*■ Lé4 gë^e%>PëàpMiw de éEinhé’, établi primitivement par
Leefling’ sous le nonÉ/de par P. Brown sknais
celui ADeJWhiometMià', fa* éteiflèr%-temps ^cntfëidërè comme*
eqi^j|'®&é^’de deux espèces ttrës^voisiû^en effet l ’une de
l ’autre , savoir , îles P . de
Linné et de Jacquin. ’Dans la suffé^ Layanalles lëur j oignit
une.trbi'si'èUie>e§pèfeè^s1f® le mom dW&P. et Willde-
,^bw rapporta ^^^ênSe?,' sdüs'ie nom de P.'7éf|$ffiJJÇiine
planle que*C.T\anilles âVùiTdéiaite? Ymu
mais/qp’on Më>pëh#|>soiisaucunprétexte-, Réparer de la'pré-
'Cêdë|pfef^i;|"
*j >Lès qu’on obseryelès quatrepfpè’cêsîreuniês afnsi^sous le
nom de P iscid ia , onlbé tfæde pas à s’apqfcevoif tpîfê', quoique
elles se ressemblent par leur gousse à ^ a tre ailes, elles forment
deux ^nrqs très-distincts : les deux premières qui ont
le calice à cinq lobes atteignant le milieu dè'àâ longueur, Ifc
étamines' monadelphesj lei|%)usses véritablement-articulées,
les feuilles aidées avec impaire, et Tes fleurs^en pahicule j for/j
ment un genres particulier qui doit garderie nom dePïscidtoei
et qui ..appartient _‘peut-ejtre aux Hédysarées. Les deux der