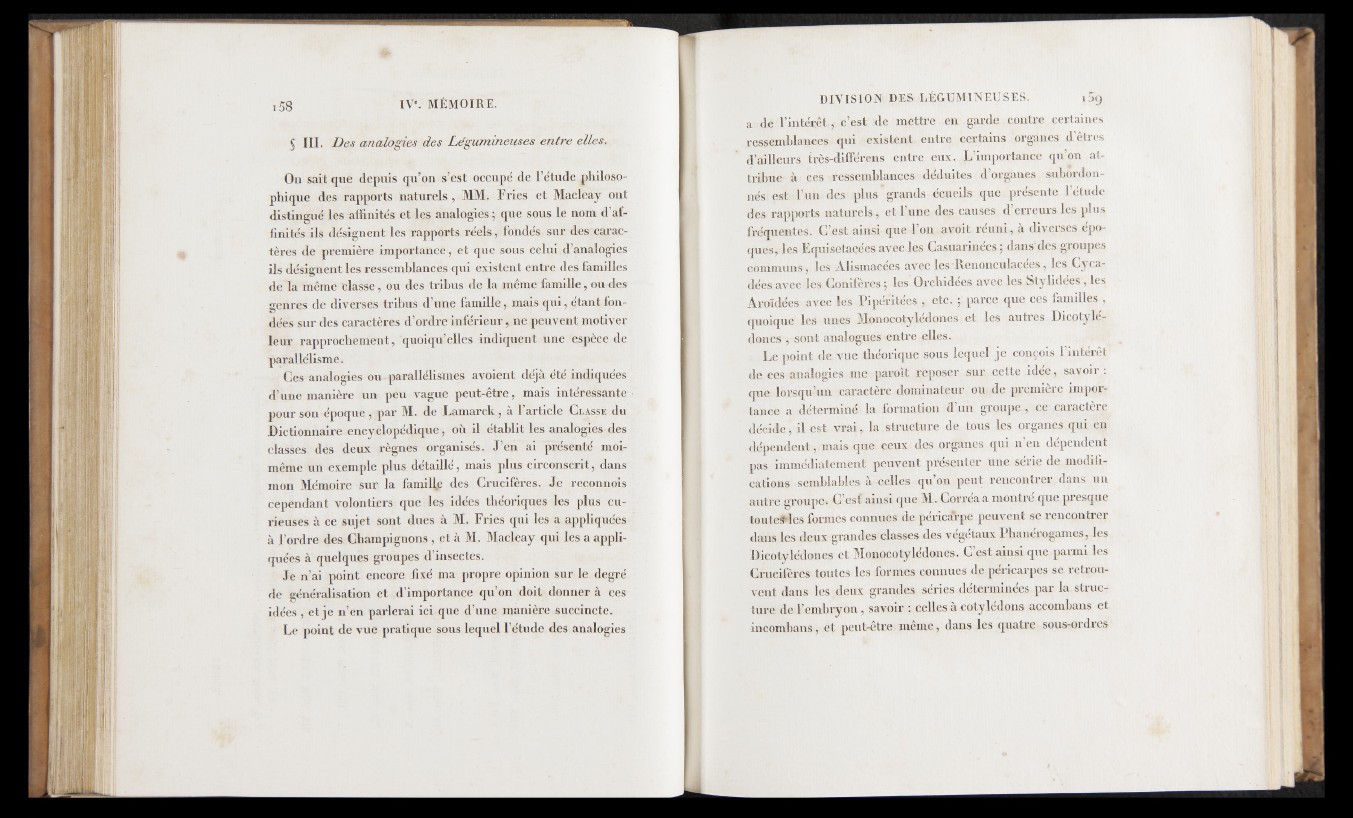
Ï58 IVe. MÉMOIRE.
5 III. D es analogies*des Légumineuses entre elles*/
On sait que depuis qu’on s’est occupé de l ’étude j>hilo,§p-
phique des rapports naturels , MAL Fries et Macleay ont
distingué les affinités «tif es analogies ; que sous le nom d’af-
iinités Jls désignent les Apports réels, fondés* sur des-ïcarac-
tères de première importance, et que sous eelui.d’anaîdgies
ils désignent les ressemblances qui existent eptre des familles
de la même 'classe, ou des tribus de la.^nême famille, ©udes
genres de diversés-tribus d’une famille, mais;qui, étanÿ,fondées
sur des caractères d’ordre inférieur^uïC-jpeuvent motiver
leur rapprochement, 'quoiqu’elles indiquentmne %|pèce_.d,e
parallélisme.
w llé s analo^es ou^parallélisânes avoient ^» lëf^n^îqu ée s
d’une manière -un peu vague peut-etre, mais intéressante'"
pour son époque, par M. de Lamarck,, *à ^article ;Glasse du
Bictionnmreyencyçlopé^que;, où il établit les analogiesrdes
cîassesa ià s deùx vègnesWganisés. J’ep ‘ai'piesenté moi-
même un exemple plus-détaillé, mais plus circonscrit, dans
mon Mémoire sur la familj^ des Crucifères. Je reçonnois
cependant- volontiers que-lGs idées théoriques tes plus ’curieuses
à ëe sujet sont dues à M. Fries qui les a appliquées*
à l ’ordre des Champignons, et à M. Maejbay qui lès a appliquées
à quelques groupes d’ihsectes. ;
Je n’ai point, encore fixé jna propre opinion survie, «degré
de généralisation et d ’importance qu’on doit donner à Ces
idées , et je n’en parlerai icique d’une manière ^succincte.
Le point de vue pratique sous lequel l ’étude, des analogies
DJVISIO1% DES» LÊGÜMI N EUS E S. j «a j
a« de " l ’intérêt, c ’ est de mettre - e n . garde contre certaines
ressemblances qui-existent entra certains organes d’êtres
d’àiÙeurs, très-différens entre, .«eux ..^L’importance qu’on attribue
à ces fressemblances^déduites«-d’organes subordon-
nésî cstisl’iuin des?plus ''grands -éapeils que, présente l’étude
des- rapports naturels., et l ’une d ^ causes, d’erreurs les plus
fréqumtesYéà’nst ainsi queJ’on^avoit réunira diverses époques,
les Equisetacées avec les Casuarinées 5 dans'des groupes
communs, les Âlismacées a^ecl^^énoneul^cées, les,.Cyca-
dées avec les Conifères 3 les'Orchidées avec les Stylidées , les(
Aroïdées .avec leSvPipéritées^ etc', ÿ parce.q^i 'CM familles ,
quoi que’, les unes Mnnoeotylédones, èt. les autrcsnDicpîylé^
doues’-y sont» a n a ^ n ç s« n tr e^ e s ,.;;^
Le point de vue théorique sous lequel je conçois l ’intérêt
de ces analogies me paraît reposer sur cette idée, savoir ^
que»dbrsqWïion .caractère.dominateur fluide .première impppf
tance, a? t déterminé'* la formation d’un .caractère
déajde^dl vrai, la .slruçéure dp, tous les .organes qui en
dépendent, mais que ceux des organes qui n’en dépendent
pas,- immédiâteménf peuvent présenter, une .série d^modifi-
cations »semblables àY^ le s
autr e, groupe^*’esf ainsi- que M^Gorréa a montréquepresque
toute^les formes eonnues depéricsffpe peuvent sç rencontrer
dans lesdeux grandesrclasses des végétaux Phanérogames,.les
Dicotylédones et M o ^ o ty lé d ù n # G ’fs t^ n s iq u e , parmi les
Gtueifères toutes lés formes connues 4 e péricarpes se retrouvent
dans les«leux grandes séries^déterminées par la. structure
ded’embryon, savoir ». celles<a .cotylédons accombans et
incombansyét peut-être* même, dans les quatre: sou&-nrdres